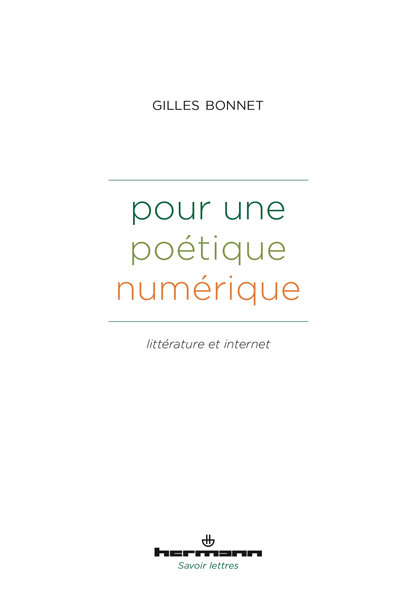France Théoret, Les Querelleurs, La Peuplade, 2018, 133 p.
///
En janvier 2018, les Éditions de la Peuplade annonçaient la parution du douzième roman de France Théoret, Les Querelleurs. Dans ce roman, dont la couverture aux aplats de couleurs vives laisse deviner la silhouette d’un homme à la mâchoire carrée, vêtu d’un complet, Théoret met uniquement en scène des personnages masculins. Pour l’écrivaine établie et la féministe qu’elle est, il s’agit de choix qui ne passent pas inaperçus. Or, dans Les Querelleurs, celle qui a dirigé la revue Spirale jusqu’en 1984 après l’avoir cofondée en 1981 nous offre un roman tout autant féministe que les autres, mais qui se sert de l’ironie pour dénoncer le sexisme du monde littéraire québécois.
« Ils sont les protagonistes, hommes en conflit. »
Les querelleurs, ce sont un auteur et son éditeur, Claude Lanthier et Victor Gill. Leur conflit nait de la réédition de l’unique chef-d’œuvre de Claude Lanthier, Le batailleur, publié au départ dans les années 60. La parution de ce roman, dont le « héros venu de nulle part est le mâle aux forces libérées contre l’emprise de la société », a valu à son auteur d’incarner le symbole d’une révolution littéraire, politique et sociétale, réputation sur laquelle il surfe encore à ce jour. Victor Gill suggère à l’auteur de réécrire Le batailleur, d’en proposer une version augmentée et corrigée, entreprise à laquelle se prête Claude Lanthier. Après avoir déposé sa version remaniée, il se ravise, mais l’éditeur procède tout de même à la publication du livre pour respecter leur contrat. L’auteur entame alors des procédures judiciaires contre son éditeur.
La querelle est vaine, mais tous deux s’y jettent avec toute la force de leur égo, entrainant leur avocat respectif dans un conflit qui durera quinze ans. Dans cette histoire de procès, qui sert aux hommes à réaffirmer leur importance et leur position, c’est à la fois notre milieu littéraire et son sexisme inhérent qui sont mis en procès, à l’insu des protagonistes. En effet, entre ce que les personnages pensent d’eux-mêmes et la manière dont ils agissent et participent au procès se trouve un décalage que l’écriture investit, faisant ressortir les contradictions et les incohérences de leur parole. C’est dans cet écart que l’ironie prend sa force, supportée par un ton mesuré qui reproduit habilement la froideur du discours judiciaire.
L’exemple le plus frappant est celui que fournit l’éditeur. Victor Gill a cette assurance d’être un homme « moderne », fier de son « éthique du succès ». Ce n’est pas la première fois qu’il va en cour, mais il se targue de n’avoir jamais entraîné quiconque dans des procédures judiciaires (ce qu’il ne manquera toutefois pas de faire à la fin du livre en faisant appel au verdict). De même, il dit agir par féminisme : à titre de preuve, il engage d’abord une avocate pour le défendre, puisque « selon lui, il faut aux hommes une révolution personnelle, qu’ils reconnaissent les capacités intellectuelles et professionnelles de femmes. » Finalement, après le décès de cette dernière, il sera heureux de travailler avec Me Benoit, de pouvoir lui donner des conseils sur sa situation maritale, « d’avoir un avocat qui l’écoute et reprend textuellement ses arguments » alors que l’avocate, elle, n’avait pas su utiliser les questions qu’il avait rédigées : elles s’étaient « révélées inutiles, faussées. » Et, « quand il apprendra qu’un juge entendra la cause, l’éditeur pense qu’ils débattront entre hommes. Il y voit un excellent présage. » Les intentions féministes de l’éditeur sont, par le décalage dans son discours, montrées dans toute leur hypocrisie. Ainsi, Victor Gill « préfère dire ma compagne plutôt que ma femme, encore moins mon épouse. Il souligne une distance publique. Cela rejoint l’évolution des femmes, il ne se l’approprie d’aucune manière. La diriger doucement lui convient. Il y arrive par des comparaisons avec les autres femmes. » Par ailleurs, l’éditeur demande à sa compagne « un appui moral » alors qu’il « lutte pour sa survie », exigeant qu’elle « approuve ce qu’il dit sur l’objet du procès ». Le sentiment de l’éditeur d’être à la fois victime d’une injustice tout en dominant la situation et la haute opinion qu’il a de lui-même sont constamment ainsi ridiculisés par la narration qui souligne les contradictions de son discours et nous présente Victor Gill comme un homme gris et chauve, au discours lyrique traversé par des lieux communs.
Le procès du milieu littéraire
Du côté de l’auteur, le décalage se trouve entre sa certitude d’être un génie, confortée par les critiques littéraires, par l’approbation d’une « confrérie d’écrivains » et par les nombreux prix reçus, en opposition à la réalité de son statut d’écrivain daté qui n’a jamais réussi à égaler son premier texte. Théoret met en scène un auteur incapable de s’exprimer sur rien, apathique, et dont toute l’identité repose sur un livre qui l’a élevé au rang de révolutionnaire, mais dans lequel il reconduit un discours réactionnaire sur les femmes. En effet, dans Le Batailleur, le personnage bat sa petite amie : « Elle part, elle revient, attaché par un fil invisible. Quand le jeune forcené n’a plus rien à faire, il détruit avec fracas les seuls objets de leur chambre louée. La belle fille reste, on ne sait pas pourquoi elle tente de l’apaiser. » Ce roman, caricature dans laquelle on reconnait aisément certains de nos chefs-d’œuvre de la littérature post-révolution tranquille, permet à Théoret de poser un regard critique sur l’institution littéraire qui glorifie un écrivain « présum[ant] que les femmes se destinent à l’apaisement de l’homme ». Comme l’affirme Claude Lanthier, à l’époque, « des intellectuelles étaient convaincues que j’étais un phallocrate, que j’avais écrit un livre misogyne et condamnable. Mon argumentation n’allait pas loin tant je suis persuadé que l’écriture nait dans la spontanéité, dans l’instant où elle se fait ». Claude Lanthier se disculpe en accordant une certaine transcendance à l’acte d’écriture, pour laquelle « les féministes cherchaient à [l]e censurer ». Se dédouanant de la responsabilité de l’écriture, refusant de concéder qu’on écrit toujours à partir d’un endroit précis, l’écrivain reste campé sur sa position, regrettant que les femmes qui autrefois se succédaient dans son lit ne soient plus au rendez-vous.
La conception de la littérature de Claude Lanthier est partagée par son avocat, Me Vinet, qui soutient que « l’écrivain, grâce à son imagination, se meut dans un monde parallèle et crée des univers inédits. Ceux-ci sont en rupture avec la réalité telle qu’elle existe et se vit au jour le jour. » La littérature, faisant partie d’un autre monde, peut ainsi n’avoir aucun compte à rendre au niveau des propos qu’elle véhicule. De l’autre côté du conflit, Me Benoit, l’avocat de l’éditeur, base l’ensemble de son argumentaire sur les clauses du contrat, sur une vision de la littérature équivalente à n’importe quel produit dont la marchandisation, assurée par l’éditeur, a été délimitée par un engagement formel.
Ces deux visions opposées se recoupent pourtant dans leur refus de voir la littérature comme portant un discours sur le monde. L’auteur et l’éditeur ne remettent pas en doute leur place comme acteurs et fondateurs d’une littérature québécoise passée et actuelle. Dans Les Querelleurs, France Théoret mène avec brio le procès du milieu littéraire québécois et la prédominance des hommes qui y sont « à la barre » depuis des années. Comme l’affirme Me Benoit à son client : « il faut vous défendre depuis votre position de dominant ». C’est précisément cette position de dominant que France Théoret démolit, avec une économie de mots et une retenue qui rend son propos d’autant plus percutant qu’il n’est pas dépourvu de dérision. Loin de faire preuve d’empathie envers ses protagonistes, l’écriture de Théoret découpe les contradictions des personnages et fait volontiers d’eux des êtres grotesques, aux traits aussi rudimentaires que ceux de l’homme représenté sur la couverture.