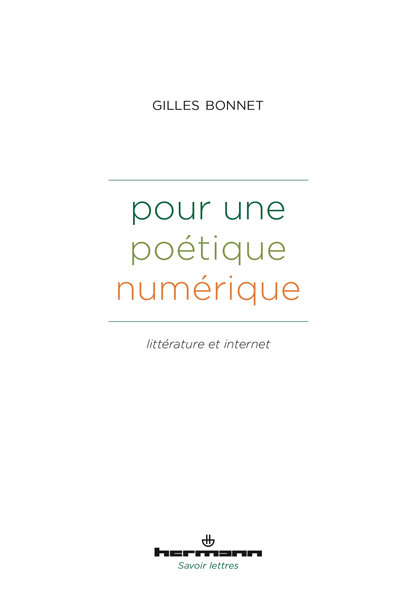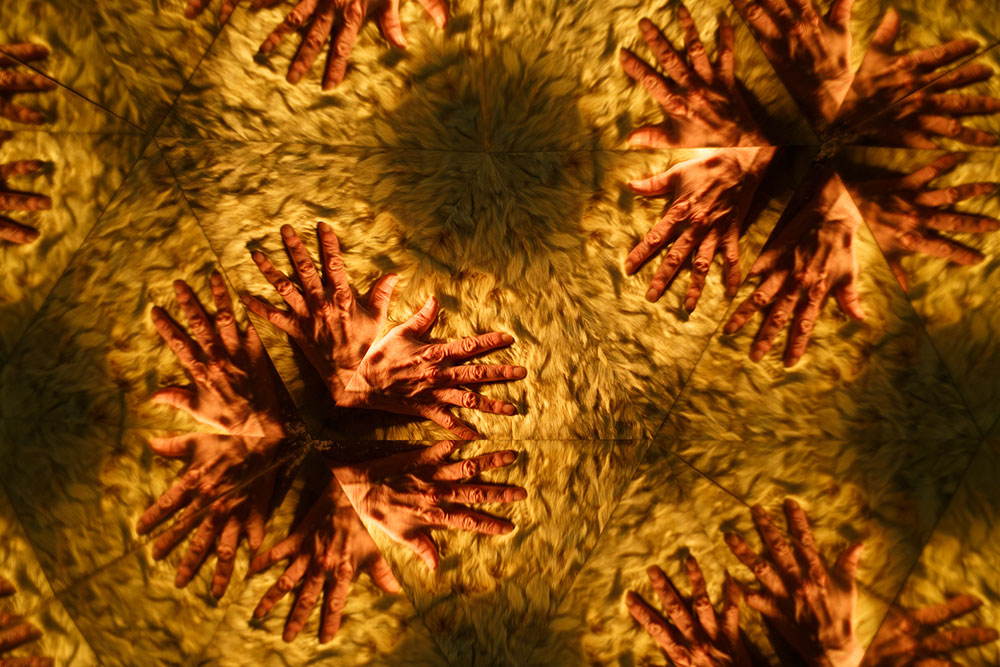Alain Larose, La chanson de ma mère, Moult Éditions, 2018, 56p.
///
Après Harikots et Poèmes pour Pierrette, Alain Larose offre un troisième livre de poésie à la bien belle collection « Critures » de Moult Éditions dirigée par Christian Girard. Avec ce dernier livre, le poor lonesome poet a ouvert son étui de mitraillette pour en sortir un violon. Il nous tire des larmes, ni bleues ni mièvres, seulement simples et belles; sa maman va bientôt mourir. Ce soir, on ne clouera pas le violoneux à la porte du garage.
Destiganrose
J’ai toujours, pour ma part, situé Alain Larose quelque part parmi les bons, entre Desbiens et Brautigan. De Desbiens, il a ce côté poésie de cuisine, cendrier plein et frigo qui ronronne. Harikots porte d’ailleurs en épigraphe cette citation du Franco-Ontarien : « Il réalise soudainement que l’écriture c’est être assis dans le silence en attendant que le réfrigérateur reparte. » Et ce n’est pas qu’une image, La chanson de ma mère commence dans une cuisine : « Un matin comme les autres / je suis dans la cuisine / de mon appartement / rue Saint-Antoine. » Avec Larose et Desbiens, quand on parle de choses, de cuisine par exemple, ce n’est souvent pas qu’une métaphore. Les choses sont bel et bien là. Quand on parle de poésie de cuisine, on parle de plusieurs choses certes, mais aussi de poésie qui se passe dans une cuisine. On est à deux doigts de se faire une toast. Alain Larose écrit :
Elle regarde dehors
pour retrouver
la maison
elle confond
le parking de l’hôpital
avec le fleuve
sans que lui prenne l’envie
de sauter
c’est dans l’absence qu’elle se noie
les poings fermés
Tout est là, pour de « vrai », parking, fleuve, absence et poings avant que les images ne les emportent. On peut les voir, comme dans un film, et Larose partage avec Desbiens ce sens aiguisé de la présence triviale des choses, dans lequel s’ancre le reste de leur poésie. Ainsi, même lorsque Alain Larose crache des dentiers, « le Grand Dentier / des siècles / des siècles » mais aussi « les dentiers / de tous [s]es ancêtres », il les pose à côté de sa mère « qui les lave lave lave / tous / et les pose / délicatement / à sécher / sur le comptoir ».
De Brautigan, Larose tient quelque chose de l’ordre du foutre le camp. Lorsque le poème se twiste en quelque chose de plus qu’une simple ironie tragique glissée dans une belle petite métaphore, lorsque le poème se twiste de mélancolique désinvolture, de n’avoir plus l’envie d’être là; lorsque le poème réalise que finalement il a un peu l’air con et qu’il dit merde, je termine vite et je quitte la scène. En d’autres mots, les deux partagent un certain sens cocasse de la chute :
Je la regarde toujours
en train de ne pas voir
de ne pas faire
ça va vite
mais lentement
nous sommes
tous les deux
en vedette
dans une
vieille vue d’amour
muette
Jusque-là tout va bien. Puis, d’un coup :
le pianiste
devenu fou
est parti
à la pêche
quelque part dans le sud
Le pianiste fout le camp, part à la pêche (à la truite en Amérique?). Le poème se termine sur un vent de fantaisie imprécise « quelque part dans le sud », saisissant tant bien que mal l’ombre en fuite de qui dérobe son émotion. Ces chutes sont synonymes de pudeur et confient une grande part de l’élégiaque au silence de l’implicite. Or, si cela était particulièrement vrai dans Poèmes pour Pierrette, le poème susmentionné est le seul – ou l’un des rares, selon votre sensibilité – de ce genre dans La chanson de ma mère. Ici, la désinvolture est moins sensible, l’émotion moins dérobée; après tout, la mère va mourir.
Comment te dire adieu
Alzheimer, démence sénile, abus d’électrochocs, traumatisme, on ne connaît pas tous les détails, mais il est certain que la mère du poète disparaît, ou plutôt est en train de disparaître, oubliant les choses, les noms, les gens, « il ne reste / plus beaucoup / d’elle à visiter ». Et, comparée à celle de ses deux précédents recueils, la poésie d’Alain Larose se fait ici plus suivie d’un poème à l’autre, plus narrative – biographique même, dans la deuxième partie du livre –, chaque partie s’unifiant en un tout pour gagner en stabilité et en profondeur, pour devenir ce qui reste quand, précisément, le reste fout le camp.
La première partie offre une magnifique introduction : le poète et sa mère dans la cuisine, le poète traversé par les dentiers que la mère lave, les deux vedettes d’un film muet, l’ouverture impossible vers le ciel, retombant au niveau des balançoires à vieux et de la lumière qui s’écrase au pied du mur de la cuisine, laissant une grande trace de freinage sur le plancher.
Je ne me rappelle plus
Comment la vue finit
je me rappelle
seulement
que quand je me réveille
elle n’est plus là
et qu’il faut vider
les cendriers froids
La deuxième partie est biographique et revient par suggestions et autres diagonales poétiques sur la vie de la mère, sur cette « vie minuscule » comme l’écrirait Pierre Michon, celle d’une femme fragile et frêle, dont la vérité dernière est d’avoir « toujours eu / sept ans ».
[…] ma naissance
cache ses bleus
sous ta jaquette
d’hôpital
La troisième partie est la relecture par le poète d’un ancien carnet de comptes de la mère, retour au terreau trivial de la poétique de Larose, de celui qui écrivait, dans Harikots, « Saint-Vallier Comptant / m’en dira toujours plus long / que Saint-John Perse ».
J’ai ta bouche
j’ai tes yeux
J’ai ta vie
de jeune femme
dans un petit
carnet de comptes
le livre
me crie
par la tête
Enfin, pour finir vient l’adieu, sur le seuil du rien, de qui disparaît, dans la vie puis dans la mort, laissant derrière elle quelques mots rescapés par son fils. Assez patient pour attendre la fin, il lui tient la main au bord du gouffre, jusqu’au dernier moment, afin d’en recueillir l’amour, « la dernière chose à partir ».
Le livre alors se tait car il n’y a plus rien à dire. Perceval, dans Le conte du Graal, a commis la faute d’abandonner sa mère sans se retourner, sans s’être enquis de sa douleur. Elle s’effondre sur le pont levis du domaine familial pour y mourir, et le Royaume du Roi Arthur en est condamné à jamais. Alain Larose, lui, se retourne, attend, accompagne, pour finalement laisser partir. Il n’y a pas trente-six façons de jouer à l’Orphée.