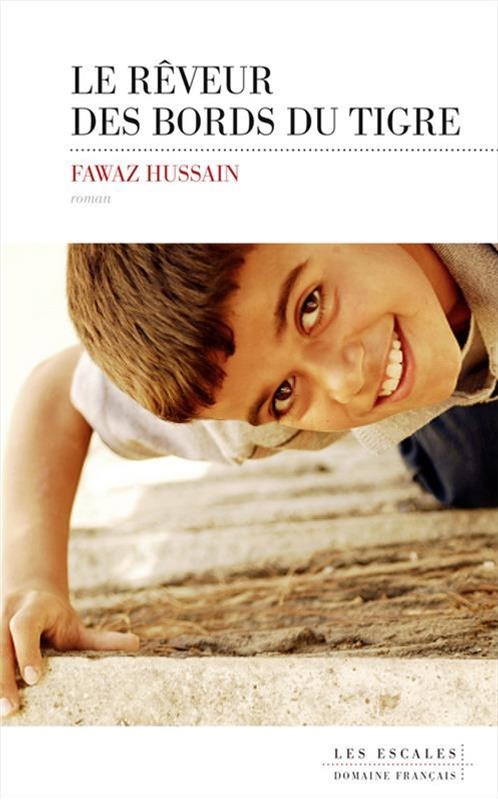L’Iliade, texte d’Homère librement adapté par Marc Beaupré, d’après Homère, Iliade d’Alessandro Baricco ; mise en scène de Marc Beaupré ; avec Stéfan Boucher, Maya Kuroki, Olivier Landry-Gagnon, Justin Laramée, Catherine Larochelle, Louis-Olivier Maufette, Jean-François Nadeau, Emile Schneider, Emmanuel Schwartz et Guillaume Tremblay ; composition et direction musicale : Stéfan Boucher et Olivier Landry-Gagnon ; présenté au Théâtre Denise-Pelletier du 8 novembre au 6 décembre 2017.
///
Pour la première fois de sa carrière, Marc Beaupré propose une création (texte et mise en scène) hors des murs de La Chapelle, pour migrer cette fois dans la grande salle du Théâtre Denise-Pelletier. On pouvait peut-être s’inquiéter que le metteur en scène perde son goût pour la recherche formelle en optant pour un théâtre plus institutionnalisé ; c’était sans compter sur l’ouverture à l’expérimentation qui anime le théâtre de la rue Sainte-Catherine, depuis trois ans placé sous la direction artistique de Claude Poissant.

À la différence, cette fois, que le parti-pris vocal de Beaupré est en rupture flagrante avec les attentes spectaculaires qu’une adaptation de L’Iliade pouvait créer, avec tout ce que le texte suppose de batailles violentes et meurtrières ; les spectacles précédents s’échafaudaient sur des textes (Caligula_remix, Dom Juan_uncensored et Hamlet_director’s cut) qui reposent sur une violence plus intime, contrairement au grand déploiement qu’on s’imagine à la mention du poème homérique. L’Iliade donne aussi à Beaupré l’occasion d’amplifier son exploration vocale avec une musique live (composée et jouée par Stéfan Boucher et Olivier Landry-Gagnon, mais aussi par Maya Kuroki et les autres comédiens, qui amplifient le texte à coups d’instruments percussifs).
Décharge énergétique
La proposition est certes touffue et il ne faut pas se surprendre que Beaupré emprunte des idées visuelles ça et là, un peu comme il le fait pour son écriture, toujours « à partir de » textes majeurs. L’univers scénique rappelle à priori celui de Peter Brook (tapis orientaux au sol, jeu sur les couleurs, présence de quelques accessoires ou instruments de musique sur scène), sans pour autant garder l’aspect ritualisé, cher à Brook, du début à la fin du spectacle. Travaillant visiblement avec un peu plus de moyens, le metteur en scène peut diversifier ses trouvailles scéniques, comme les objets de bronze suspendus ou ce miroir triangulaire, qui monte et redescend du plafond pour multiplier les angles de vue sur la scène, sans pour autant renier son goût du homemade et du ludique, comme ce petit cheval de bois format jouet pour enfant figurant le cheval de Troie.
L’Iliade est aussi l’occasion d’explorer divers genres et registres vocaux et musicaux, du spoken word au rock industriel en passant par le rap et le chant à connotation plus lyrique. La recherche formelle semble d’ailleurs retourner à une certaine idée du poème épique, fait pour être narré et chanté, accompagné d’une musique qui s’inspire du peu qu’on connaît de la musique de l’époque. De même, le jeu est exacerbé, voire maniéré, alors que les paroles sont amplifiées par des mouvements chorégraphiques et des gestes qui relèvent du langage des signes. Le spectacle repose surtout sur une dépense énergique folle, puisque Beaupré demande à ses comédiens une intensité physique et corporelle de presque tous les instants. De ce jeu, certains tirent mieux leur épingle que d’autres, étant donné que le chant et la performance vocale ne réussissent pas à tous de manière égale.

Le spectacle prend tout son sens dans le dernier tiers, alors que les pertes humaines s’individualisent et que les émotions affleurent. Avant, on profite de l’énergie dépensée et jouée sur scène, en se demandant toujours un peu quoi en retirer. Mais peut-être faut-il voir L’Iliade comme un parcours : on passerait du plaisir formel à voir Beaupré et ses interprètes chercher, essayer des choses et prendre des risques (avec ce que ça comporte de segments moins réussis que d’autres) – bref, de l’énergie et des passions qui bouillent – à l’éclatement de ces forces pulsionnelles dans la colère d’Achille, rendue par un Emmanuel Schwartz qui révèle son Marilyn Manson intérieur dans une séquence endiablée qui n’est pas sans évoquer, vocalement et musicalement, le chanteur américain.

crédit photos: Gunther Gamper