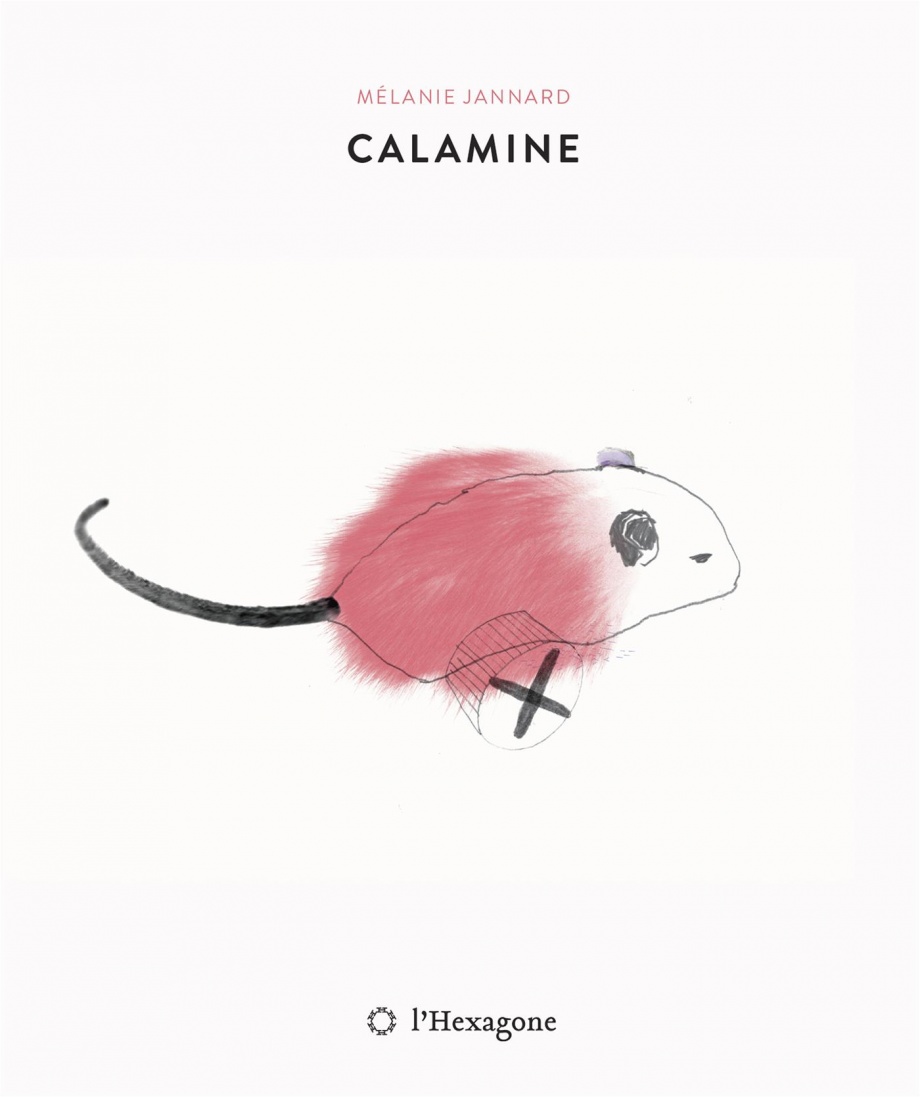Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, texte et mise en scène : Angela Konrad; interprétation : Éric Bernier ; danseurs : Marilyn Daoust, Luc Bouchard Boissonneault, Sébastien Provencher, Nicolas Patry, Emmanuel Proulx ; assistance à la mise en scène : William Durbau ; chorégraphie : Marilyn Daoust ; lumières : Cédric Delorme-Bouchard ; costumes : Linda Brunelle, Marie-Audrey Jacques ; scénographie : Anick La Bissonière ; maquillage : Angelo Barsetti ; son : Simon Gauthier ; vidéo : Julien Blais ; coproduction : Compagnie La Fabrik et Angela Konrad. Présenté du 10 au 21 octobre à l’Usine C (Montréal).
///
Dans les bras des idoles absentes
Le long monologue de réflexions philosophiques, adressé au spectateur dans Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, ponctué de chansons populaires, est appuyé par les interventions de quatre danseurs, que le livret décrit comme des « incarnations du sublime « incarnations du sublime », dont la fonction (en plus d’interpréter les différents liens entretenus avec le personnage principal) est surtout de nous consoler, un peu comme le ferait le chœur au sein d’une tragédie. C’est d’ailleurs comme une tragédie narcissique que se profile l’histoire du personnage joué par Éric Bernier, à travers, entre autres, la figure de Morrissey; l’impasse de celui qui, coincé entre les narcissismes – le je narcissique, le narcissisme de l’autre et le nous narcissique – cherche sans trouver le bonheur, l’amour, la jeunesse perdue.

Une ronde de conquêtes sur une trame sonore parfaite
La quête se poursuit et prend à témoin les danseurs comme s’ils étaient de potentielles rencontres, des amants du passé, des amours déchus, les chansons de Shirley Bassey « Somehow » et « Something » établissant, lorsque les paroles du sujet manquent, un relais dans la trame narrative de la pièce. La rencontre est toujours brève, l’autre toujours rejeté, ne rencontrant pas les exigences du sujet. Tous semblent résister à l’attraction réelle, passer outre la lucidité proclamée de l’acteur, trop penché sur son reflet pour accepter le narcissisme des autres. Même la danse plutôt lascive et particulièrement réussie (et assurément narcissique!) de Nicholas Patry le laisse dans la distance d’un songe le ramenant à lui-même. Il se noie alors dans les paroles du groupe The Smiths, qui figurent dans le titre de la pièce: « Last night I dreamt that somebody loved me / No hope, no harm / Just another false alarm / Last night I felt / Real arms around me / No hope, no harm / Just another false alarm / So, tell me how long / Before the last one? / And tell me how long / Before the right one? / The story is old – I know / But it goes on / The story is old – I know / But it goes on / Oh, goes on / And on / Oh, goes on / And on.»

Écrasement à la surface de l’eau
Très beau, souvent très touchant, le texte, tricoté autours des chansons des Smiths, ramène cependant la réflexion sur le plancher du pathétique, sans vraiment atteindre ni le déchirement, ni le sublime du tragique. L’acteur, fort habile, habillé à la Morrissey (chemise ouverte, pantalon moulant), pleure le malheur qui s’abat sur sa condition d’être narcissique et on y croit; on a tous voulu l’écrire, cette chanson, et on s’y noie tous avec lui. On a cependant envie de brasser un peu ce personnage. On aimerait le voir s’ouvrir au-delà de la peine et de des frustrations qu’il énumère. C’est un peu comme si le narcissisme dans cette pièce devenait la surface d’un étang, s’érigeant dans la salle, entre le public et les interprètes. Les larmes ne traversent pas le miroir de l’eau, ne se rendent pas jusqu’à nous. Reste une plainte à la fois touchante et pathétique.
Si l’on se sent exclu, (et je soupçonne que ce soit par la force de notre propre narcissisme, qui n’est pas reconnu) cette longue jérémiade arrive toutefois à nous faire éprouver de l’empathie. Et c’est bien ce qui fonctionne dans cette pièce, c’est-à-dire son aspect pathétique, son humour qui frôle souvent le grotesque, mais que le sublime ne parvient pas à rattraper, situé trop loin de l’autre côté de la surface. C’est un rire jaune qui est provoqué – et réussi. C’est ce corps-à-corps formidable entre l’acteur et les danseurs, qui verse lui aussi dans le pathétique, dans le grotesque, qui repousse parfois l’envie de regarder, ramène à son propre narcissisme de celui qui roule des yeux dans son siège. C’est la vieillesse perdue : celle de Morrissey, écrasé sur le sol, les dents cassées parce qu’il a voulu plonger dans la foule, que la foule ne l’a pas rattrapé. C’est la blessure narcissique d’une idole vieillissante.

As-tu du cœur, Narcisse?
Mais qu’en est-il d’Écho? Si toutes ces tentatives se révèlent être de fausses alarmes, que reste-il de la prémisse? Que reste-il de la quête du bonheur et la recherche de l’autre? Devant cette démonstration ambitieuse de narcissisme, face à l’honnêteté et à la générosité du personnage interprété brillamment par Éric Bernier, appuyé par son chœur de danseurs, une version du narcissisme de l’autre nous est offerte et il nous incombe d’y réfléchir. Même s’il faut prendre un moment de répit en sortant de la salle pour être en mesure de l’accepter. Même si, pour le dire avec Derrida, « il n’y a pas le narcissisme et le non-narcissisme; il y a des narcissismes plus ou moins compréhensifs, généreux, ouverts, étendus. » Cette pièce s’offre comme une porte ouverte, prête à éclairer les pas d’un(e) inconnu(e) en posant d’emblée la question de ses contours. La question de l’amour, alors, peut advenir, car, comme répondait le philosophe dans ses entretiens avec Didier Cahen, elle nous rappelle que « [l]’amour est narcissique. Alors il y a des petits narcissismes, il y a des grands narcissismes, et il y a la mort au bout, qui est la limite. Dans l’expérience – si c’en est une- de la mort même, le narcissisme n’abdique pas absolument. »
This story is old, but it goes on and on…
crédit photos : Maxime Robert Lachaine (répétitions) et Le Pigeon