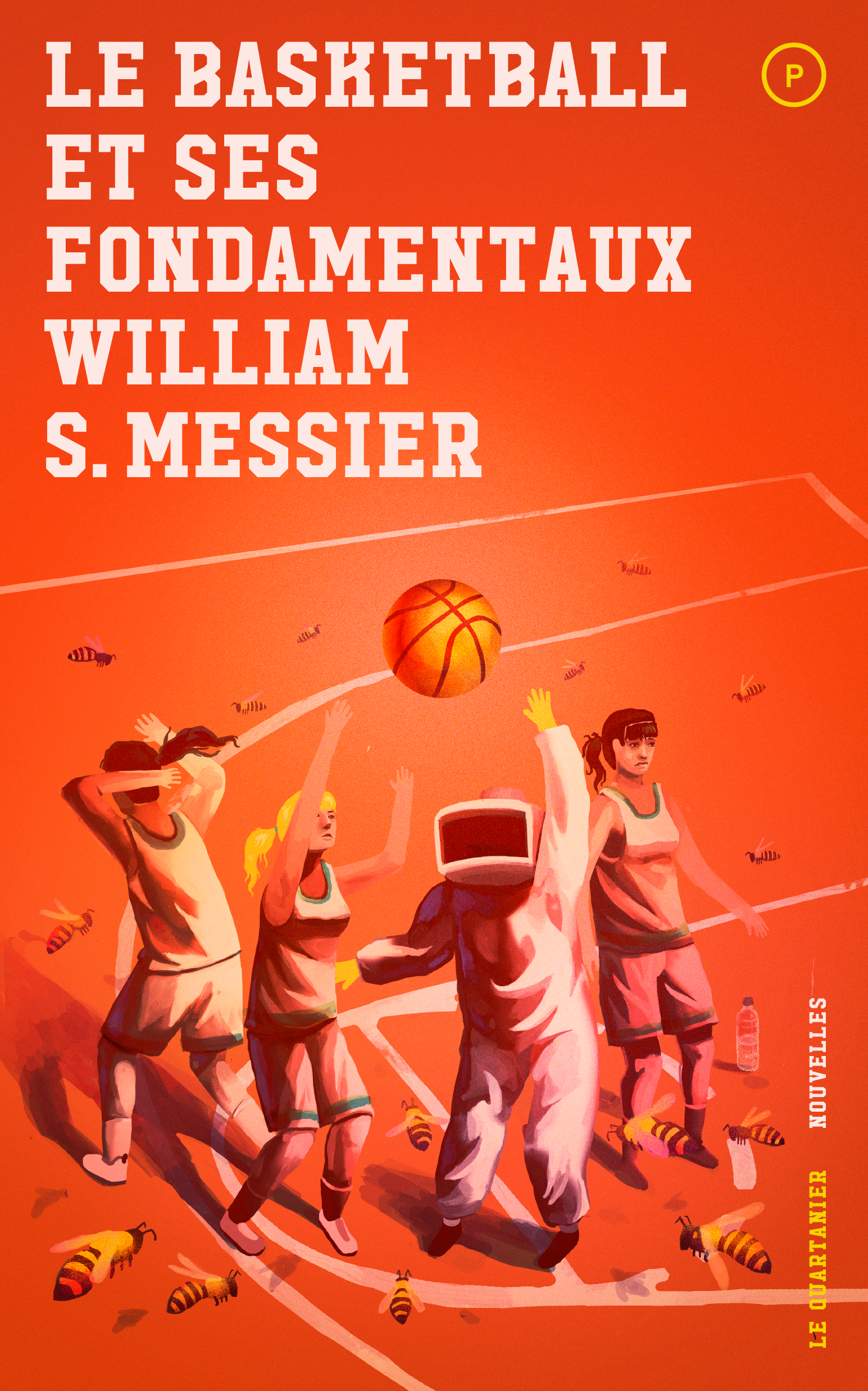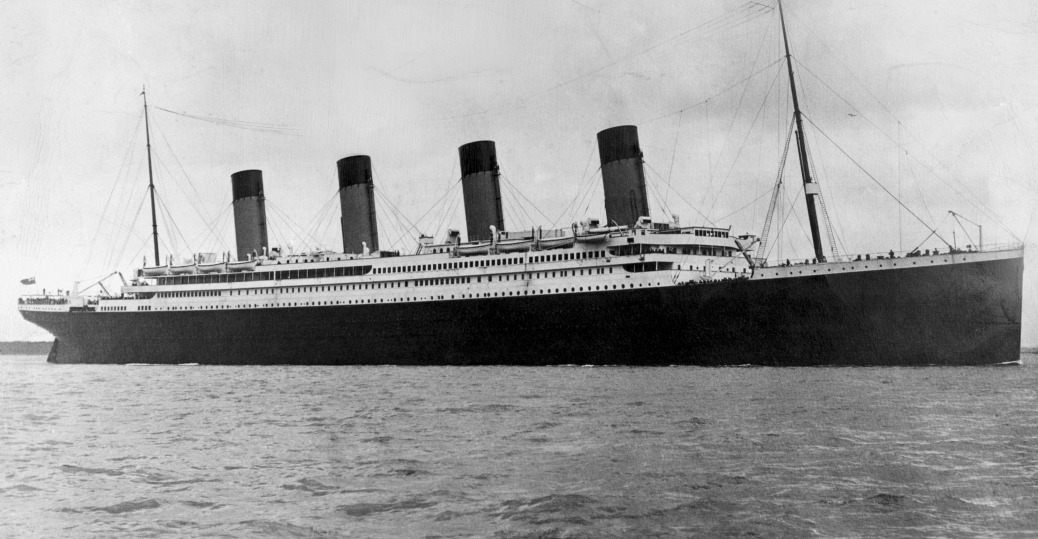William S. Messier, Le basketball et ses fondamentaux, Montréal, Le Quartanier, 2017, 240 p.
///
Si William S. Messier avait préféré le baseball au basket – un sport qui est à la ruralité ce que le basket est à l’urbanité, précise-t-il –, nul doute qu’il aurait joué champ gauche. C’est, à tout le moins, la position qu’occupe son imaginaire dans le champ littéraire, à plus forte raison avec son dernier recueil qui oscille entre le réalisme périurbain et la fable apocalyptique. Quels liens peuvent en effet unir l’univers de la banlieue, des nuées d’abeilles africanisées qui prennent soudain d’assaut la population de Granby et les rimes dévastatrices du Wu-Tang Clan ? A priori, aucun. Messier relève néanmoins le défi, et de brillante façon, d’établir un terrain commun pour ces éléments disparates, un espace de vingt-huit mètres sur quinze, circonscrit par un ensemble de lignes blanches, de fond, médianes et de tirs.
Avec « Glossaire », l’auteur sert d’ailleurs une remarquable entrée en matière. Rédigée, comme son titre le laisse entendre, sous forme de glossaire terminologique du basketball, cette première nouvelle correspond en réalité – cela prend un moment pour le comprendre – à une collection de textes que le jeune Dave Langevin rédige à l’attention de son psychothérapeute. Son quotidien est ainsi décrit à l’aide de détails, disséminés parmi les explications sportives, sur sa vie depuis que sa mère est partie, sur ses amours (imaginaires) et ses « ostiques » de rivalités avec les gars de son club de basket. C’est donc sous les heureux auspices de l’inventivité formelle que se présente cette chose joyeusement déroutante intitulée Le basketball et ses fondamentaux, quatrième publication de son auteur après Townships (2009), Épique (2010) et Dixie (2013), tous trois parus aux éditions Marchand de feuilles.
Connaissant l’intérêt de Messier pour la littérature américaine, et compte tenu ici de la parenté évidente de ses sujets de prédilection, on ne peut que songer, à la lecture de certaines de ses créations, au fameux Cœur de lièvre de John Updike, à la routine anesthésiante que mène son antihéros, Harry « Rabbit » Angstrom, au beau milieu de Brewer, quintessence de la banlieue triste qui reste jusqu’alors – on est en 1960 – une tache aveugle de la fiction américaine. Et bien qu’un temps considérable sépare les deux œuvres, un jeu d’échos – ceux du gymnase, entre autres – les unit par-delà les époques. À l’instar d’Updike, Messier réfléchit notamment sur ce moment inévitable où l’homme se fait à l’idée que la réalisation de ses aspirations n’aura jamais lieu. Voilà, pour l’essentiel, où le mènent basket et banlieue.
Le basket, la banlieue : les fondamentaux de William S. Messier
Si la banlieue des Cantons-de-l’Est n’a certes pas cette valeur mortifère qu’Updike attribue à la banlieue pennsylvanienne, elle n’en détient pas moins chez Messier le pouvoir d’endormir les ambitions inavouées de chacun. Plusieurs de ses personnages les plus importants, tous masculins, ont un jour ou l’autre à faire le deuil de leurs rêves de jeunesse : « C’est là que j’ai cessé de rêver à différents destins sportifs », constate le narrateur du tout premier fondamental à la suite d’une cinglante déconfiture, « ou que j’ai arrêté de me faire croire que je pourrais un jour atteindre la grâce d’un Michael Jordan ». Est-ce le même genre de démission précoce qui conduit le narrateur de « Les deltaplanes » à végéter dans ce poste de téléphoniste à la solde d’Estrie Data Plus ? Ou qui pousse Big Dawg (« La défaite de Big Dawg »), jeune trentenaire vêtu comme l’adolescent qu’il souhaite demeurer, à se contenter d’un boulot dans l’aménagement paysager plutôt que d’enseigner ?
Tous les personnages de Messier connaissent, à des degrés divers, ce que « s’enfarger les pieds dans la vie » veut dire. Les ellipses temporelles et la réapparition de mêmes personnages au fil de différentes nouvelles permettent de le constater. Ainsi de ce sympathique Dave Langevin que l’on retrouve (« Wu-Tang »), longtemps après la rédaction de son glossaire, co-entraîneur de l’équipe féminine de basket de son ancienne école, en plus d’y être animateur de pastorale. Une façon, peut-on penser, de s’accrocher à sa vie désormais lointaine de basketteur étoile, nostalgie également entretenue par la fréquentation de son ancien entraîneur, Robert Côté, dont l’existence n’est guère plus inspirante. Et encore une fois, devant le duo formé par Langevin et celui que l’on surnomme « Bob Side », Rabbit Angstrom et Marty Tothero, son mentor mal vieilli, s’imposent à l’esprit.
La banlieue n’est donc pas tout à fait cette « capitale du bonheur » ironiquement baptisée par l’essai de clôture du recueil, seul texte à s’éloigner de la fiction. En une vingtaine de pages, Messier propose une réflexion bien personnelle sur les sujets centraux qui l’ont précédemment inspiré, soit le basketball et la banlieue, mais aussi le hip-hop et son rapport à l’oralité. On comprend alors que pour l’écrivain, l’oralité est à l’écriture ce que le basketball de rue est au basketball organisé : « L’un est fondé sur un cadre strict, sanctionné, et valorise le respect d’un ensemble de règles, tandis que l’autre recherche constamment des moyens de contourner ces mêmes règles ». Dribler les mots en esquivant la rigidité d’un cadre normé, faire en sorte de leur insuffler cette part vivante de la réalité brute et quotidienne, voilà l’une des leçons que le hip-hop a enseignées à Messier. Parfois dur comme l’un de ces « sandwichs aux jointures » distribués dans les vestiaires des Griffons de l’école Sacré-Cœur, souvent drôle et touchant, l’ouvrage de William S. Messier est sans contredit l’un des fondamentaux de la cuvée printanière.