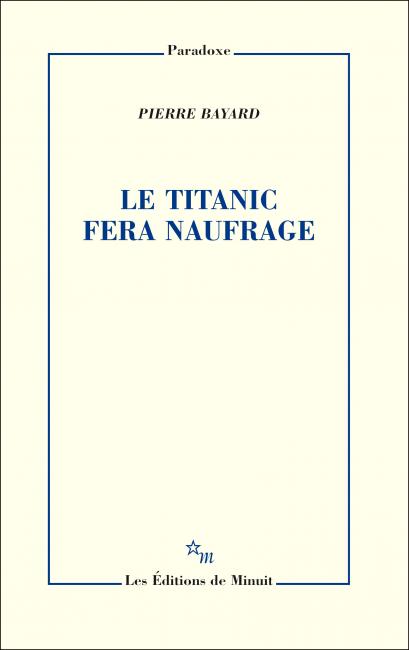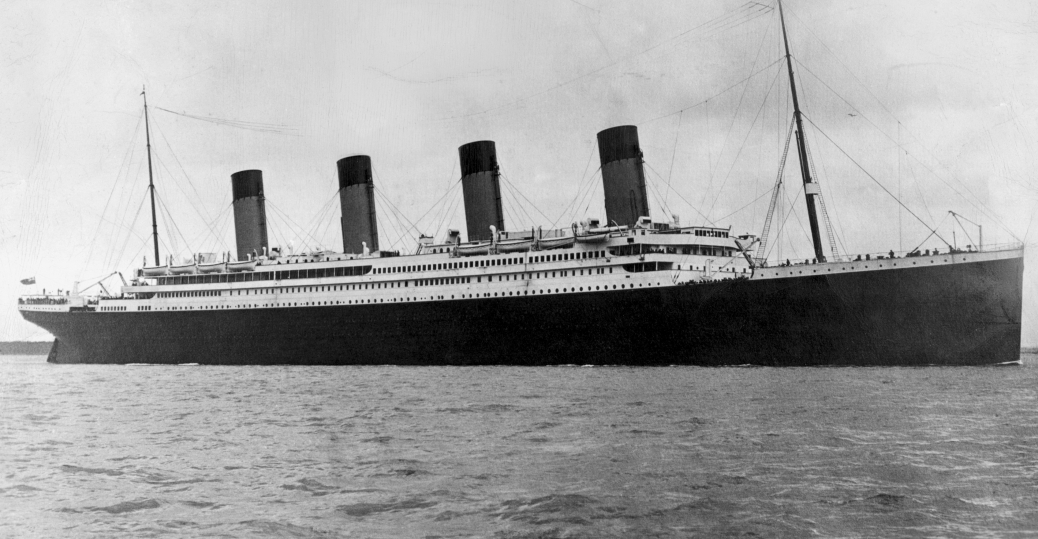Pierre Bayard, Le Titanic fera naufrage, Paris, Éditions de Minuit, 2016, 176 p.
///
La manière de Pierre Bayard est confortablement installée entre deux chaises : d’un côté, une pensée qui ouvre l’œuvre, qui l’ouvre encore plus – car bien évidemment, Umberto Eco en avait déjà diagnostiqué l’ouverture. Cette pensée est sensible aux manques, aux surplus, mais aussi bien aux virtualités ; la théorie de la lecture a déjà répété à quel point tout texte appelle l’actualisation du lecteur, Bayard fait un tour de plus au manège, il va jusqu’à modifier la portée des textes, en inverse les résonances, en écartèle le sens. Ainsi, d’un autre côté, plutôt qu’une pensée nous avons une œuvre, une création : c’est la grande aventure de la lecture pour biaiser l’expression de Jean Ricardou. À cet effet, chaque parution de Pierre Bayard constitue un joyeux coup de pied dans ce que les études littéraires peuvent avoir de morne rigueur. Le Titanic fera naufrage est la dernière savate à ce jour.
Une rhétorique
Le dernier livre de Pierre Bayard s’inscrit en droite ligne avec son chantier mis en branle il y a déjà plus de dix ans. En effet, depuis Demain est écrit (2005), le critique visite ce lien pour le moins mystique unissant la création littéraire au futur ; en d’autres mots, l’écrivain pressent-il le monde en potentiel, entrevoit-il le devenir humain ? Avec Le plagiat par anticipation (2009) ou encore Il existe d’autres mondes (2014), l’hypothèse est modifiée, nuancée ou radicalisée, observée sous une autre facette, s’éclaire d’un nouveau corpus. Le Titanic se propose moins de démystifier le phénomène que de permettre de l’appréhender, d’en comprendre les limites et les possibles – en ce sens il fait œuvre de critique. Mais très vite la rigueur théorique laisse place au jeu de la lecture. Il faut voir le présupposé rhétorique rencontré dès l’introduction pour mesurer l’écart au cœur même du projet :
[La surprise] tient au fait que personne, surtout parmi ceux qui détiennent une forme de pouvoir, ne semble tirer de conséquences pratiques de la capacité annonciatrice de la littérature. Devenue un lieu commun, cette prescience demeure en effet un fait abstrait dont un grand nombre d’observateurs reconnaît l’existence, mais sans que lui soit octroyé pour autant le statut de découverte scientifique à part entière.
On peut aisément constater une tension dans ce projet. Il faut d’abord prouver l’évidence, il faut ensuite légitimer ce qui, évident, n’a jamais pu être pris au sérieux. Cette tension invite à une rhétorique particulière, ainsi, qui consiste à appeler les diagnostics critiques de prescience – les critiques furent nombreux à constater la prémonition d’œuvres chez Franz Kafka, mais aussi chez Jules Verne jusque chez Jean-Luc Godard –, à les détricoter ensuite pour contredire l’évidence et, enfin, à les réaffirmer selon de nouvelles bases théoriques. Cette rhétorique, comme c’est le cas dans tous les livres de Bayard, s’inscrit directement dans le paradoxe, et a pour résultat moins de convaincre d’un système de lecture rigoureux que de constater l’habile – et fascinant – mouvement des idées.
De la preuve à la méthode
Pour légitimer, donc, il faut prouver. Comment prouver ce qui, de l’avis général, participe d’une lecture quasi-spirite de la littérature ? Rien de mieux qu’un jeu, fait d’affirmations et récusations, de nuances et de radicalisation. À ce jeu, Bayard est passé maître. Ainsi de la première phrase du livre : « L’écrivain américain Morgan Robertson n’a jamais dissimulé qu’il s’était inspiré dans son roman Futility, pour décrire l’odyssée dramatique de son navire imaginaire, le Titan, du naufrage du Titanic survenu quatorze années plus tard. » La mystique de cette inspiration du futur paraît intenable, et loin de la nier complètement, l’essai navigue sur ses eaux menaçantes. Certes, comme dans Il existe d’autres mondes, il fait appel à tout un appareil de science et de règles logiques qui lui permettent de rester les pieds au sec – décidemment –, mais jamais en lui donnant l’absolue rigueur capable de tenir loin la cartomancie et les boules de cristal.
Un exemple sert habilement à la fois de preuve et de méthode. Dans un chapitre intitulé « Le besoin de confirmation », Bayard présente une analyse de Dette d’honneur (1995) de Tom Clancy, roman ayant la réputation d’avoir prévu les attentats du 11 septembre : l’œuvre est finement décrite, la description s’affine de scènes évocatrices, la fascination agit, car l’anticipation du 11 septembre saute aux yeux plus avance la démonstration. Mais Bayard a tôt fait de freiner l’enthousiasme : « Aussi impressionnante soit l’anticipation dont ce roman fait preuve, écrit-il, […] il importe cependant de noter que la ressemblance majeure (un terroriste utilise un avion pour détruire un bâtiment américain à forte valeur symbolique) dissimule un nombre non négligeable de différences. » Le mouvement du chapitre sert bien à démontrer, s’appuyant en cela sur notre propre fascination de lecteur, vite convaincu de l’anticipation réussie dont témoigne le résumé du livre de Tom Clancy, que le sentiment naïf d’une « prémonition » littéraire est miné d’avance. Nous sommes trompés, lecteurs, car, dans notre « besoin de confirmation », nous procédons à « la suppression discrète de tout ce qui n’entre pas dans le cadre choisi ». Le concept, alors, permet bien de nommer le fol enthousiasme des lecteurs, avides de trouver des signes, des annonces, là où il n’y aurait que du texte, mais permet-il vraiment de mettre des mots sur l’anticipation réussie de la fiction ? Au contraire. C’est pourquoi le chapitre ne s’arrête pas là ; Bayard, alors, débarrassé de l’idée mystique selon laquelle Tom Clancy aurait prévu le 11 septembre 2001 – les points de divergence entre les deux trames sont effectivement très nombreux –, peut analyser plus rationnellement le fait que Dette d’honneur a mis en scène un attentat semblable – par avion – à celui ayant eu cours six ans plus tard. Trois pistes sont envisagées : 1) la ressemblance ne serait que coïncidence, 2) Ben Laden aurait lu ou entendu parler du roman, 3) hypothèse intermédiaire : « l’idée [a] pu venir en même temps à Tom Clancy et à Ben Laden, ainsi qu’à toute une série de créateurs isolés, dont certains animés d’intentions moins louables que celle de distraire les lecteurs. » C’est à cette dernière idée que Bayard donnera son crédit ; elle semble pourtant moins rationnelle que les autres, moins sceptique, voilà en fait ce à quoi mène la méthode de Bayard. Il lui faut démystifier une idée naïve, imposer un principe logique pour enfin le dépasser, revenir à une idée tremblante, hantée par l’extraordinaire et le paranormal. En effet, concevoir que l’idée de l’attentat vient à la fois à Ben Laden, à Clancy et à d’autres – il traite de bandes dessinées ayant elles aussi présenté de tels attentats – amène, comme l’indique l’essayiste, à « se demander ce que signifie avoir une idée, mécanisme de création individuelle ou collective qu’il n’est pas si facile de décrire ». Et de là, plutôt que de référer à une sorte de dialogisme dans lequel les discours et inter-discours finissent par créer du dicible et du pensable dans une culture – c’est la notion d’imaginaire –, Bayard préfère retourner dans ses réflexions qui constituent vraiment son cabinet d’écriture, entre atelier d’artiste et laboratoire logique : « [Ce cas de figure] conduit à remettre en cause la conception de la causalité telle que nous l’avons à l’esprit quand nous tentons de préciser quel événement précède l’autre, puisque c’est cette fois l’idée, élaborée simultanément en plusieurs lieux, qui constitue l’événement. » Les idées deviennent les événements, permettant à Bayard d’affirmer, plus tard, que les œuvres sont donc un peu moins des anticipations que des événements elles-mêmes du possible de notre monde.
Une poétique
L’envoûtement qu’exerce l’œuvre de Bayard se fait au prix d’une rigueur de raisonnement. Pour mieux dire, il faut que ses essais acceptent de rompre avec l’esprit de la preuve, de l’argument, d’une structure imparable pour exercer sur le lecteur tout son magnétisme. Car à la fin, on est moins tenté de suivre son conseil consistant à reconnaître dans les livres ce qui nous permettra de « nous préparer, avec un temps d’avance sur l’irrémédiable, à accueillir le pire et prendre, sans se fier à l’illusoire protection de ceux qui nous gouvernent, les mesures nous permettant d’y échapper », qu’à chercher dans d’autres livres ces signes plurivoques capables de laisser imaginer le futur ; moins donc pour se préparer au pire que pour le frisson qu’exerce cette relation transgressive, rendue lisible par Bayard, entre texte et événement. Moins suivre la rhétorique de ses démonstrations, donc, qu’embrasser la poétique de sa lecture.