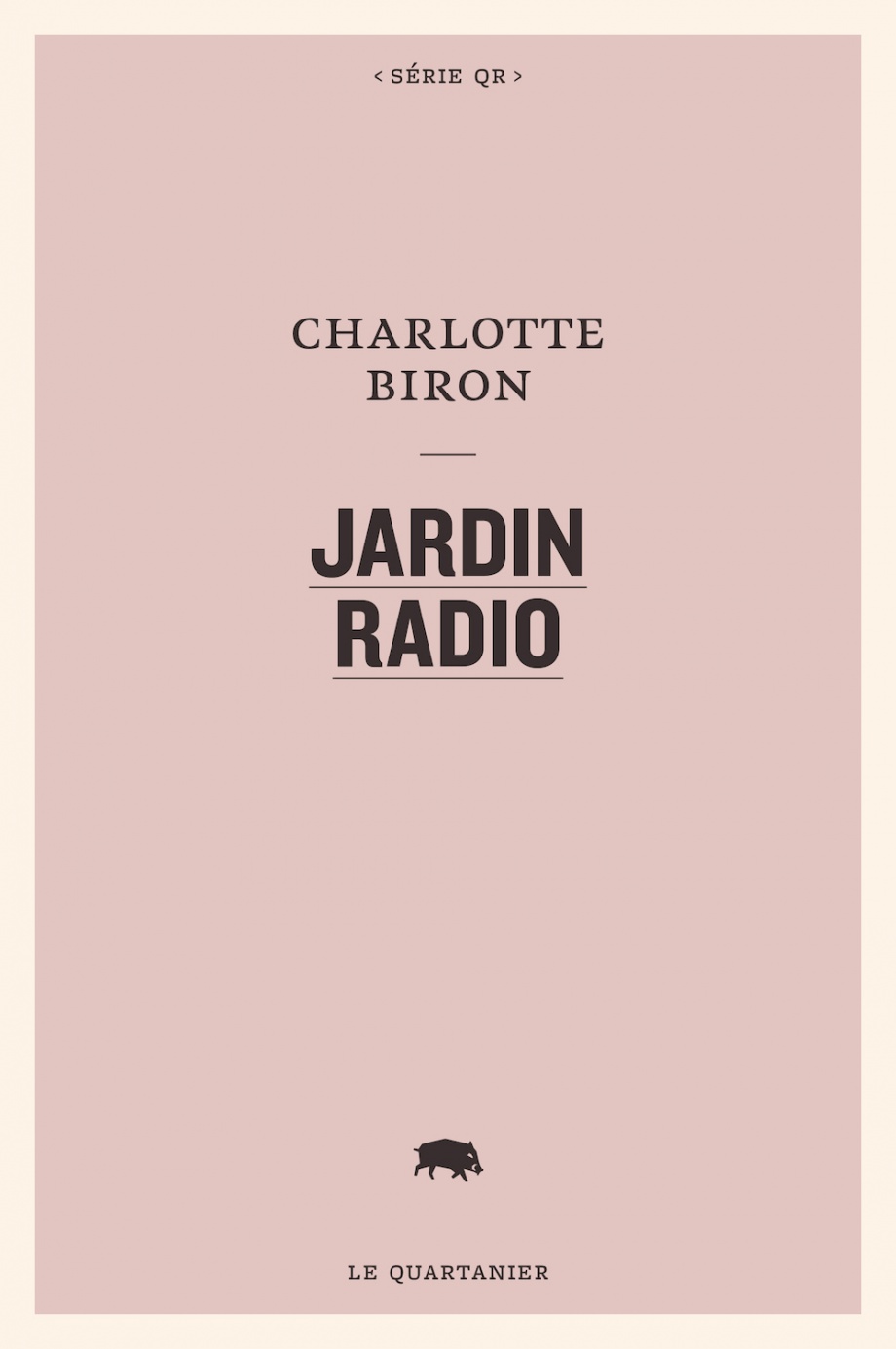Manque. Texte : Sarah Kane, trad. par Philippe Ducros ; Mise en scène : Alexa-Jeanne Dubé et Patrick R. Lacharité ; Production : La Fratrie ; Présenté à l’Usine C du 5 au 9 avril 2022.
///
Un homme fait son entrée sur scène. Il porte une femme sur ses épaules et la dépose au sol : le geste est brusque, sans égard. Il traîne ensuite le corps jusqu’au centre de la scène, produisant un crissement insupportable. Je crois alors qu’il l’a tuée et s’apprête maintenant à l’enterrer. Mais il la retourne et le cadavre se recroqueville ; son visage se retrouve projeté en gros plan sur un rideau suspendu à quelques mètres de la scène (sur laquelle on ne retrouve qu’une chaise en bois recouverte d’une veste beige). Un homme et une femme plus âgés surgissent alors.
Quatre voiles blancs sont suspendus au-dessus de cette scène cernée par le public. Une légère brume nous enveloppe et crée une atmosphère spectrale qui perdurera tout au long de la pièce. Dans Manque, un voile flotte perpétuellement entre l’individu et le monde — auquel il est pourtant imperméable, envahi par une souffrance universelle qui le dépasse —, rendant ce premier étranger aux autres comme à lui-même.
Personne ne parle
La mise en scène d’Alexa-Jeanne Dubé et de Patrick R. Lacharité parvient à donner vie aux blancs de la page qu’investissent si bien les textes dramatiques de Kane. La multiplicité des prises de parole s’illustre dans un dispositif choral qui, sur scène, prend également corps dans ces personnages ne se regardant pas, ou rarement, mais dont la parole semble tenter de rejoindre celle des autres dans le partage d’une souffrance collective, traversée par un silence innommable. Les répliques fusent de partout et ne coïncident jamais totalement avec le sujet qui les émet. Lorsque les personnages amorcent un dialogue, créant un pont entre leurs souffrances intimes au milieu du chaos, un non-sens le rompt et confine de nouveau les personnages à leur solitude.

Une jeune femme évoque ainsi le traumatisme d’un viol, d’un amour destructeur et de la mort de sa mère (décédée en lui donnant naissance). L’un des hommes, dont les interventions se font presque toujours sur le ton de l’agressivité, est d’abord désigné comme le violeur de cette femme, puis comme un pédophile. Le deuxième homme souffre vraisemblablement de diverses addictions et ses répliques glissent constamment vers des notes aiguës qui traduisent son angoisse. Le quatrième personnage est une femme aux cheveux blancs dont la vie semble avoir été marquée par les agressions sexuelles, la honte et le silence. Bien que l’on puisse associer certains personnages à une histoire plutôt qu’une autre, le dispositif choral diffracte constamment leur voix en ne leur permettant pas de se cristalliser sous le couvert d’une identité bien définie.
Ce que ces identités imprécises, contradictoires et pathologisées nous dévoilent, c’est que toute psyché est fondamentalement fragmentée, ne serait-ce que par cette parole qui la traverse en ne lui appartenant jamais entièrement. Et la mort qui plane depuis le début de la pièce est sans cesse repoussée par les prises de parole, qui sont aussi une torture pour le corps : « J’hais ces mots-là qui me gardent en vie. J’hais ces mots-là qui ne laissent pas mourir. » Le manque universel dont souffrent les quatre personnages s’agglomère ainsi en formant un trou dans le réel, trou au sein duquel s’engouffre, au fur et à mesure, le sens. C’est que « la vérité n’a rien à voir avec la réalité », et le manque ne se comblera que dans la mort. En effet, comme l’écrit Derrida en 1969 : « la propriété absolue, la proximité indifférenciée de soi à soi est un autre nom de la mort ». Les corps ne cessent de s’effondrer au sol, illustrant leur désir de s’y incruster. Or, ils finissent toujours par se redresser, incapables de faire cesser le flux des mots, sinon par des cris (certes un peu stéréotypés) qui demeurent étouffés au fond des gorges, même s’ils résonnent en écho dans l’espace.
Une souffrance universelle
Le visage de la jeune femme projeté sur le rideau blanc endosse une souffrance universelle : c’est un Visage-Monde
/01
/01
Je m’inspire ici des propos d’Élisabeth Angel-Perez qui parle, dans un article intitulé « La scène traumatique de Sarah Kane » (2015), d’un « moi-monde » dans le théâtre de Kane : « le sujet lyrique devient un sujet-chorique, un sujet-monde, un sujet qui ne fait plus la différence entre ses propres frontières et le monde. »
qui porte le poids du traumatisme collectif de la mort d’autrui, de la violence, de la honte. Les mimiques que l’on observe en gros plan deviennent le miroir dans lequel se regardent la victime et le bourreau, ne formant alors plus qu’un. Dans ce dispositif réside sans aucun doute toute la force de la mise en scène, qui parvient à incarner l’intime dans le collectif sans pour autant effacer la subjectivité des individus.

Loin d’être passive face à ce déferlement de violences, celle qui regarde et qui est regardée est avant tout sujet. Son agentivité va d’ailleurs s’accroître tout au long de la pièce, à mesure que la tristesse laisse la place à la colère. Elle se filme d’abord, se regardant à la caméra comme dans un miroir, pour être ensuite filmée par l’un des hommes qui déverse sur elle son fiel déguisé en amour, avant de finalement reprendre possession de la caméra. Enragée, révoltée, elle renvoie aux autres protagonistes la violence du regard.
C’est uniquement dans la rébellion que la parole semble susceptible de se libérer, s’approchant de l’amour tant désiré qui ne trouve refuge nulle part, et surtout pas dans la romance, théâtre de toutes les violences. Lorsque, finalement, les personnages se taisent, après un ultime écroulement des corps, le public n’ose pas applaudir. C’est que l’arrêt subit de cette parole étourdissante nous laisse pantois. La pièce est-elle bel et bien terminée ? La mise en scène aurait pu bénéficier d’un élément de rupture permettant de clore plus nettement le spectacle. Les effets sonores — tel le crissement qui, au début de la pièce, m’avait donné des frissons — auraient selon moi gagnés à être investis de manière plus soutenue. Quoiqu’il en soit, au terme d’un long silence, un.e spectateur.ice applaudit enfin, mettant le point final au spectacle.
crédits photos : Maxime Cormier