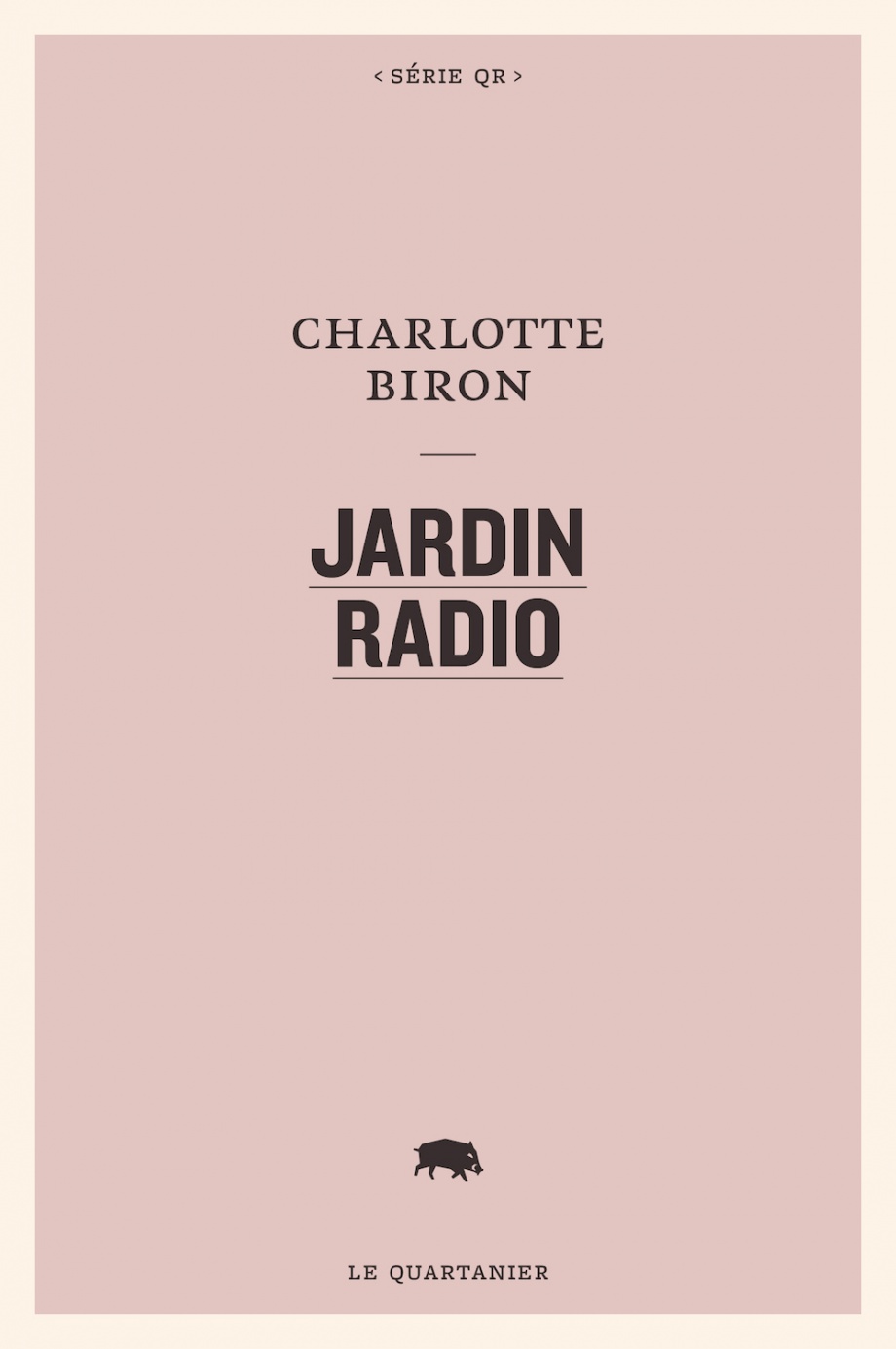La disparition des choses. Chorégraphie : Amélie Rajotte ; Danseuses : Amélie Rajotte et Marie-Philippe Santerre ; Réalisation et performance sonore : Stephanie Castonguay et Olivier Landry-Gagnon ; Conceptrice vidéo : Nelly-Ève Rajotte ; Production : Lorganisme ; Coproduction : Agora de la danse. Présentée à l’Agora de la danse du 30 mars au 2 avril 2022.
///
Que fait-on quand la nature qui nous entoure a disparu ? C’est la question qui est au fondement de La disparition des choses, chorégraphie d’Amélie Rajotte performée en duo avec Marie-Philippe Santerre et présentée dans l’intimité de l’Agora de la danse (j’écris chorégraphie, mais le rôle de la musique composée et performée en direct par Olivier Landry-Gendron et Stephanie Castonguay est essentiel, de même que celui des projections-paysages numériques créées par Nelly-Ève Rajotte – j’y reviendrai). La scène est complètement nue, annonçant ce monde vide de toute chose dans lequel on sera entraîné·e. Sur le mur du fond, un écran géant aussi large que la scène. Discrets de part et d’autre de celle-ci, les musicien·ne·s et l’artiste multidisciplinaire.
La performance commence très lentement. Pendant un long moment, on n’entendra que ce qui rappelle le souffle du vent, le sable qui se déverse dans un sablier, des craquements, des crépitements – toutes choses qui évoquent le délitement, la disparition. Sur l’écran, dans des tons plutôt doux de vert, de gris, une forêt se perd graduellement dans la pixellisation, le travail de contraste et de colorisation, les effets de montage. Notre compréhension de ce qui se trouve devant nous s’en trouve brouillée ; on perd nos repères, comme les danseuses. Celles-ci sont séparées, l’une d’elles à l’avant de la scène, l’autre à l’arrière. Elles ne semblent pas savoir qu’elles ne sont pas seules. Lentement, elles s’étirent, bougent leurs doigts, essaient de prendre la mesure de l’espace autour d’elles, de positionner leur corps dans ce vide. Parfois, alors que l’une paraît tenter de s’adapter, de découvrir les possibles de son corps dans ce nouvel environnement, l’autre paraît creuser, attraper, ramener à elle la matière disparue.

La deuxième partie de la performance est marquée par un changement de ton musical et visuel qui entraîne avec lui les danseuses. C’est, à mon sens, la partie la plus réussie de la performance. Pour quelqu’un comme moi dont l’imaginaire a été marqué par les trames sonores de films d’anticipation, le crescendo de la musique alliant sonorités synthétiques aiguës, grinçantes, à une basse scandée et rapide rappelle les affects provoqués par ces films qui nous propulsent dans des mondes déconcertants et anxiogènes. Sur l’écran du fond, ce sont maintenant des torrents qu’on voit se déchaîner. Les danseuses semblent prises dans ceux-ci, elles s’y débattent, emportées par le rythme de la musique, écrasées par les trombes d’eau. Mais un changement se produit graduellement, que je ne remarquerai que lorsqu’il sera pleinement réalisé (je noterai d’ailleurs ce renversement des plus intéressants à plusieurs moments de la performance) : les danseuses qui paraissaient jusque-là réagir aux événements extérieurs semblent maintenant les diriger. J’ai l’impression soudainement que ce sont elles qui animent le torrent – testament à la plasticité du corps et des choses, mais aussi au travail organique des différent·e·s artistes qui font de cette performance quelque chose de complet.
Remplir le vide par la présence
J’aimerais proposer une réponse à la question initiale : que fait-on quand notre environnement a disparu ? On se rassemble, on met à contribution les forces de chacun·e, on tente, on improvise, et on remplit le vide de présence. C’est ce que cette création fait, et c’est selon moi sa plus grande qualité. La chorégraphie d’Amélie Rajotte ne pourrait être sans le travail des autres artistes, discret·ète·s en bordure de scène mais bien présent·e·s, répondant aux corps des deux danseuses. Côté jardin, Stephanie Castonguay et ses instruments trafiqués contribuent à l’ambiance post-apocalyptique ; côté cour, Olivier Landry-Gagnon, dont les synthétiseurs modulaires imposent son rythme à la pièce, guette les mouvements des danseuses et le jeu de l’autre musicienne, se tenant prêt à répondre à cette conversation muette qui se déroule devant nous. À ses côtés, Nelly-Ève Rajotte surveille l’écran sur lequel se succèdent les fonds visuels, complexes, changeants, teintant l’atmosphère à la fois par les images plus ou moins claires qui y sont évoquées, les couleurs qui y prédominent, le mouvement et le rythme de l’image, le mode de la déconstruction (brisure, spirale psychédélique, chute, pixellisation)…
À un certain point de la performance, je me suis demandé comment et pourquoi l’espace, cette scène vide à l’exception des deux danseuses qui étaient à ce moment rassemblées dans un coin arrière de la scène, me paraissait aussi rempli. C’est en cet instant que j’ai remarqué cette présence des musicien·ne·s et de l’artiste, la complétude créée par la somme de toutes ces parties faussement isolées. L’écran géant en fond de scène, les musicien·ne·s qui se répondent de part et d’autre, les danseuses : tout cela se parle. Au moment de terminer cette critique, je tombe sur ces mots d’Amélie Rajotte : « Par un contact provenant de l’intérieur et des vibrations sonores et visuelles, nous avons donné chair à l’espace. Nos mains, comme des antennes innervées, ont cherché à capter des mémoires sensorielles enfouies. À travers l’émergence de ces petites fictions pour combler le vide, l’autre est apparu. » Peut-être doit-on de même considérer le public comme partie prenante de cet « autre » : après tout, on se prend nous aussi à créer des « petites fictions » pour faire signifier et relier entre elles les différentes parties de cette performance. Aussi déstabilisant soit-il, cet espace interprétatif qui nous engage à la suite des artistes dans la disparition des choses est aussi tout à fait stimulant.
crédits photos: Justine Latour