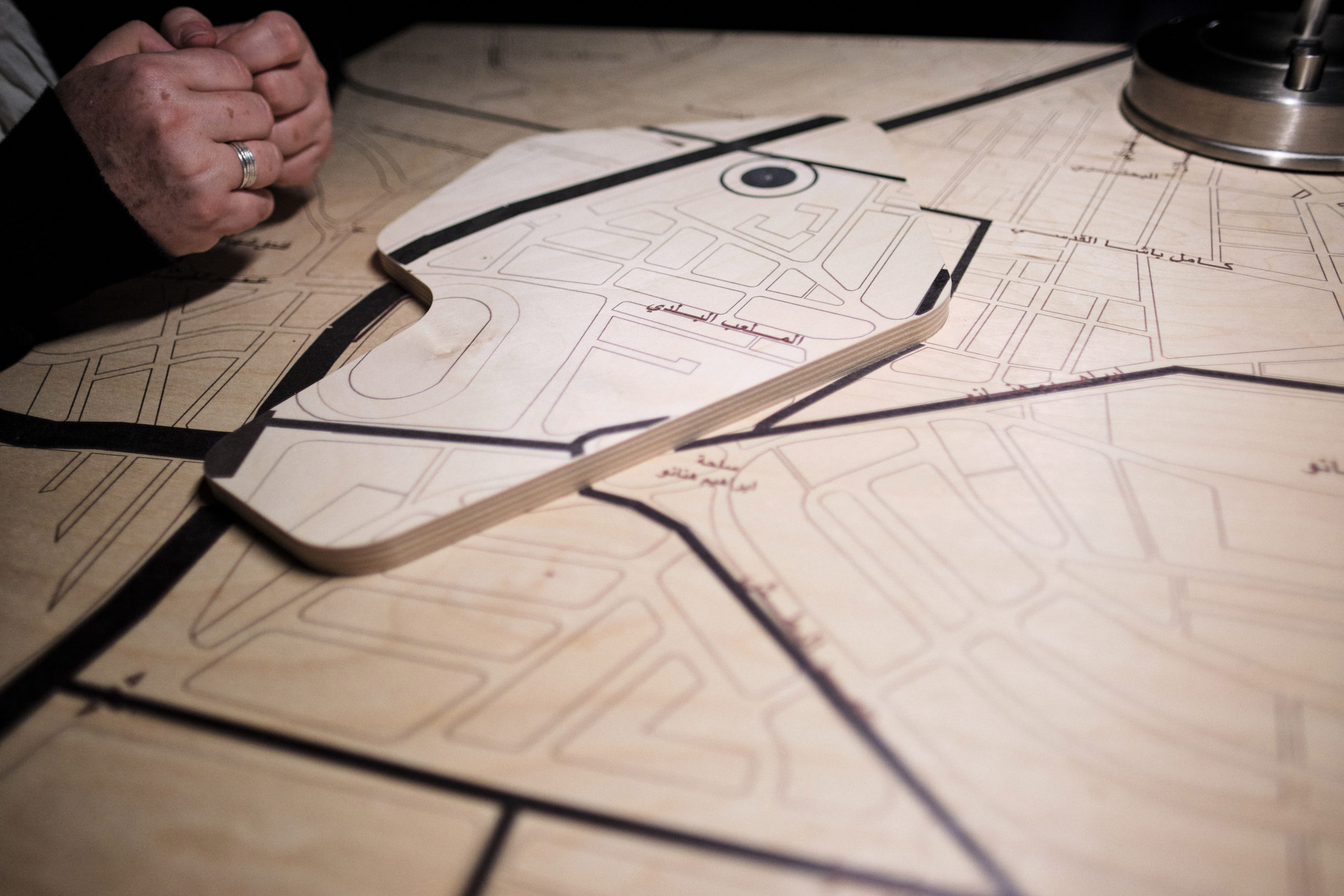Le club Vinland, Benoit Pilon, Productions Avenida et Les Films Opale, 2021, 125 minutes.
///
Marchez, pendant que vous avez la lumière.
— L’Évangile selon Jean
« Un enseignement terne, fade, morne, dépourvu de joie et de plaisir, un enseignement reposant sur l’humiliation et la punition – sur la “correction” –, un enseignement qui nous prépare à tout sauf à penser, à développer notre sens critique, à exercer notre jugement et à remettre en question les structures mêmes qui le permettent », phénomène qui concerne malheureusement aussi bien le Québec d’aujourd’hui que celui d’antan : voilà ce contre quoi Limoges, en enseignant-vengeur, est parti en croisade avec son essai, Victor et moi. Enseigner pour se venger, fraîchement publié dans la bien nommée collection « Liberté grande » chez Boréal. C’est également contre cette force obscure de l’inertie, de la paresse intellectuelle et du manque de curiosité que lutte le Frère Jean – interprété par un Sébastien Ricard inspiré –, dans le dernier film de Benoit Pilon, Le club Vinland (de retour en salle depuis le début du mois d’août après différents hiatus liés à la COVID).

« L’apprentissage n’a pas à être quelque chose d’amusant. Le travail de l’enseignant sera toujours d’apprendre l’effort à ses élèves », lance le Frère Visiteur (Guy Thauvette) à Frère Jean, professeur dans un petit collège de Charlevoix à la fin des années 1940. Dans la représentation théâtrale qui ouvre le film –où se joue une découverte de l’Amérique par les Vikings – un groupe de jeunes avec leurs épées en bois et leur drakkar en carton va réécrire l’Histoire, coupant l’herbe sous le pied à Christophe Colomb et autres « grands explorateurs » de ce monde. « C’est vrai. Mais c’est aussi de les contaminer de l’envie d’apprendre. Une fois qu’ils ont ça, ils y mettent l’effort », répond le jeune Frère à son supérieur, toutefois peu convaincu par l’idée. C’est que, avec sa pièce, Jean s’est attaqué à un double problème : d’abord, à celui de l’irréductible binarité entre l’enseignement et le plaisir, le labeur et la frivolité ; puis, au problème, peut-être encore plus grave, de l’hégémonie de l’Histoire « officielle », avec ses mythes fondateurs présentés comme des vérités éternelles. Filmée dans un savant jeu d’ombres et de lumières par François Gamache, cette confrontation initiale entre Frère Visiteur et Frère Jean nous livre le cœur du film, soit la thématique de la transmission, tandis que l’enseignement novateur de Jean l’éclectique s’oppose aux dogmes immuables de l’Église.

Comme il le proposait déjà, du côté du documentaire, avec Nestor et les oubliés (2006) ou, du côté de la fiction, avec Ce qu’il faut pour vivre (2008), Pilon plonge à nouveau dans la période de la « Grande Noirceur » pour revisiter un pan sombre de notre histoire collective. Son approche, cependant, est tout sauf austère. À l’image de son personnage principal, Le club Vinland est une œuvre lumineuse et généreuse, où la grammaire du cinéma classique, loin de nous endoctriner ou de nous livrer des mots d’ordre, nous invite à voir ce monde noir dans sa beauté et sa poésie.

Cinéma orphelin
« Filme. Filme les gens que tu aimes. Filme les choses qui méritent que l’on ne les oublie pas ». C’est ainsi que Jean, relégué aux archives à Québec après avoir été renvoyé par ses supérieurs, s’adresse à Émile Lacombe (Arnaud Vachon), l’élève par qui s’est focalisée notre découverte du collège et de son milieu. Le clin d’œil à Lacombe Lucien (1974), grand film de Louis Malle sur l’école et l’enseignement, semble explicite, de même que les liens évidents avec Dead Poets Society (Peter Weir, 1989). Enfant difficile, en raison de l’absence de son père mort à la guerre, Émile a eu de la difficulté à s’intégrer au groupe et à se faire accepter par ses camarades. Le système d’éducation mis en place, basé sur la peur de la faute, ne lui convient pas. Trimballé d’école en école par sa mère, il semble destiné à un triste avenir. Puis il rencontre Jean, qui le comprend, l’apprivoise. Le déclic – c’est le mot – qui sauvera le jeune garçon d’un avenir morose se fait lors d’une séance de projection (rythmée par une musique originale de Pierre Lapointe), alors que Jean présente à sa classe la captation cinématographique d’une fouille archéologique à laquelle il a participé.

Tournées avec une caméra 8 mm, ces images ont pour but de préparer le groupe à l’expédition qu’il est lui-même sur le point d’entreprendre. Car Jean vient de découvrir les nouvelles traductions des sagas islandaises. Grâce à elles, il croit pouvoir prouver que l’emplacement exact du mythique « Vinland », nom donné par le Viking Leif Erikson au territoire découvert lors de ses explorations maritimes autour de l’an 1000, serait situé au Québec, sur la Côte-Nord, à quelques lieues du collège. Alors que ses camarades sont fascinés par le contenu de légendes scandinaves, qui offrent tout à coup un horizon féerique aux familières rives du Saint-Laurent, Émile, lui, est interloqué par le dispositif de projection, que Pilon va filmer en gros plans et sous tous ses angles, montrant toute la poésie de l’objet technique. Éclairée seulement par le faisceau lumineux du projecteur, cette scène illustre métaphoriquement le propos du film : même de la nuit la plus noire, une lumière peut émerger et nous servir de guide. De Jean l’illuminé, bientôt prêtre défroqué, on passe aux illuminations du projecteur. Par la suite, on verra toujours Émile caméra au poing ou devant un appareil de montage, les mains pleines de colle et de bouts de pellicule. D’où, justement, la dimension réflexive de Vinland : comme Pilon avant lui
/01
/01
: « Moi-même, j’ai vécu ça en secondaire 5, avec Pierre Ménard, un professeur de français qui a fait que j’ai voulu plus tard faire du cinéma. C’était un jeune frère enseignant au Collège Saint-Paul de Varennes, et il nous a fait monter une pièce de Michel Tremblay dont j’ai pu faire la mise en scène. Ça a été une révélation ! On m’avait inoculé le désir de travailler des textes, avec des acteurs! […] On a tous eu un professeur marquant ; tout le monde a eu quelqu’un qui l’a allumé au cours de son parcours ! », confie le réalisateur en entrevue avec Helen Faradji, montrant par là le lien qui l’unit au personnage d’Émile.
, Émile est un documentariste en herbe.

« J’étais conscient de prendre des scènes rares, des gestes quotidiens de cultivateurs, de travailleurs qui disparaîtraient dans quelques années. J’étais alors très heureux et fier de filmer de telles scènes sur le point de disparaître », explique l’abbé Maurice Proulx, documentariste considéré à bon droit comme l’un des premiers réalisateurs canadiens-français. Relecture symbolique de l’histoire du cinéma au Québec – média qui s’est d’abord développé sous la tutelle éminemment retorse du clergé –, Le club Vinland, avec le personnage du frère Jean, rend hommage à cette figure de pionnier, dont il est difficile de ne pas reconnaître la hardiesse. Les propos de Proulx sur le métier du documentariste résonnent toujours aujourd’hui, de même qu’ils résument une des leçons du cinéma de Pilon : les êtres et les choses qui nous entourent ne cessent de disparaître, parfois drastiquement, parfois de manière quasi imperceptible – et il est urgent d’en rendre compte. Dès Rosaire et la Petite-Nation (1997), son premier long métrage, Pilon fait du documentaire un art de la durée, aussi bien sur le plan du contenu que de la forme : être documentariste, c’est à la fois savoir situer son sujet dans le Temps – celui de l’Histoire – tout en laissant le temps – celui du film – pénétrer chaque plan. Il en va de la responsabilité du documentariste de ne pas couper trop rapidement, par peur d’échapper un geste orphelin, vestige d’un autre temps, qui apparaissait peut-être à l’écran pour la dernière fois. L’ironie du sort est que, dans cet éloge du documentaire par la fiction qu’est Le club Vinland, ce monde qui est en train de disparaître est celui du clergé, du catéchisme et de la religion. Même la Grande Noirceur, dans toute sa fragilité, a droit de cité sur le celluloïd.

Le monde entier change
« Vous avez raison, notre société change et on ne pourra pas l’empêcher. Parce que le monde entier change. L’église peut continuer à penser qu’elle peut arrêter ça, que tout peut revenir comme avant, mais le monde va changer pareil, avec ou sans nous » répond Jean au Frère Directeur (Rémy Girard), qui le réprimande pour ses idées progressistes ainsi que son intérêt envers la science et l’histoire. Que l’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas là d’une croyance aveugle dans le progrès – Le club Vinland ne fait pas l’apologie de la naïveté –, mais de la reconnaissance que rien, même les certitudes millénaires, n’est à l’abri du changement. L’Histoire n’est pas une suite de croyances inébranlables, mais, à l’image de ces Vikings qui auraient découvert l’Amérique, un inévitable processus de réécriture. D’ailleurs, lors de cette discussion entre Frère Jean et Frère Directeur, on aperçoit en arrière-plan le mannequin d’un guerrier autochtone, utilisé plus tôt dans le film lors de la représentation théâtrale des élèves. Aucune histoire, aussi éclairée et bienveillante soit-elle, n’est à l’abri des stéréotypes, des clichés et des réductions outrancières. Tout regard historique, donc, a son point aveugle, qui ne demande qu’à refaire surface, comme ces artefacts vikings que l’on attend toujours sur les rives du Saint-Laurent.

Procédé récurrent chez lui, Pilon veut réécrire la grande Histoire en racontant les vies minuscules de quelques illuminés qui ont su en percevoir le point aveugle, pour ensuite s’y diriger comme le papillon vers la flamme d’une chandelle. Tout professeur – « ces enseignants qui changent des vies », comme on lit dans le générique du Club Vinland – devrait savoir nous entraîner avec lui ou elle dans un tel voyage.