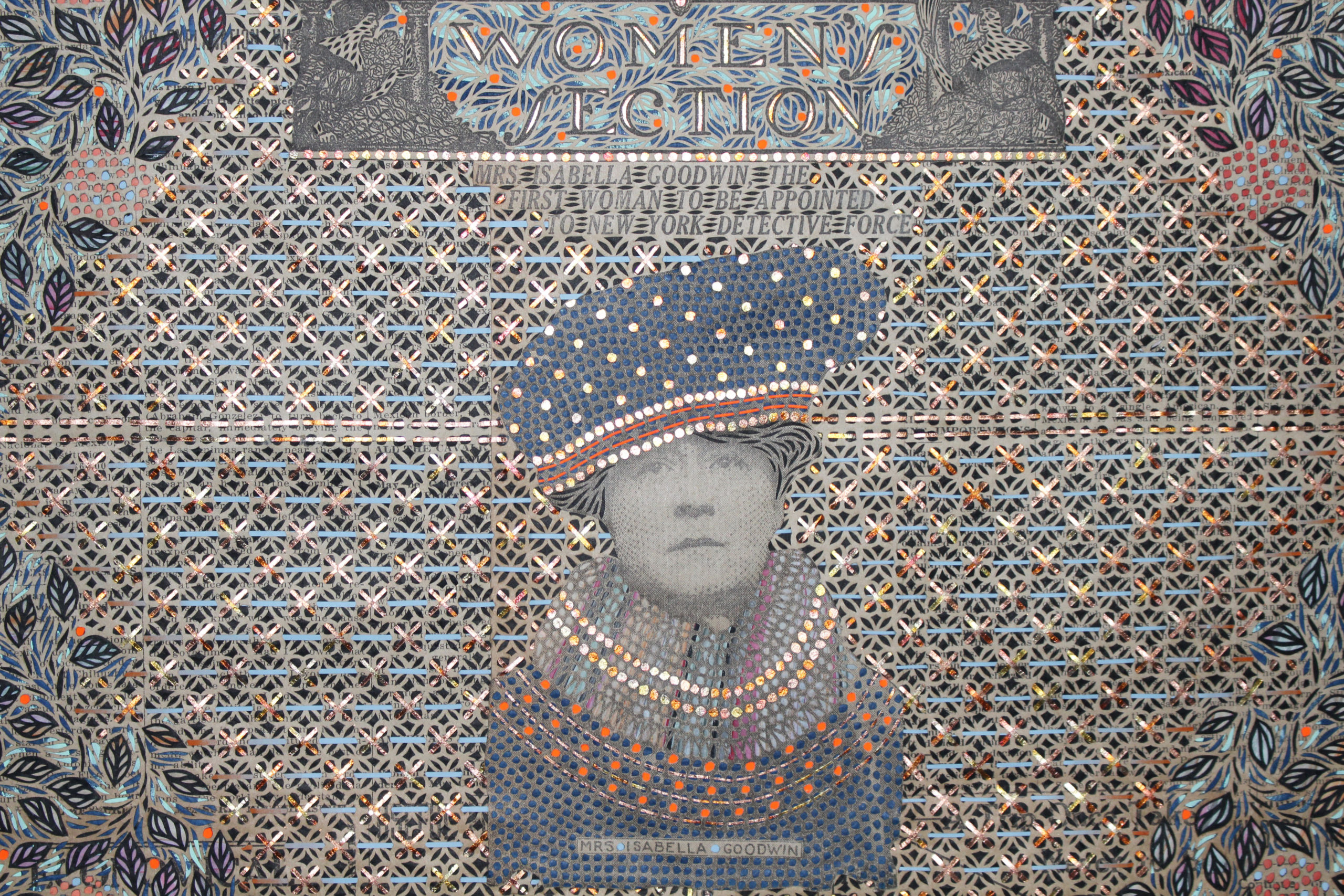Je m’appelle humain, Kim O’Bomsawin, Maison 4:3 et Terre Innue, 2020, 78 minutes.
///
Nous autres en un mot :
territoire.
— Marie-Andrée Gill, Frayer
De la poésie au cinéma
« Il n’existe pas de dictionnaire d’images. Aucune image n’est classée et prête à l’usage. Si d’aventure nous voulions imaginer un dictionnaire des images, il nous faudrait imaginer un dictionnaire infini, tout comme demeure infini le dictionnaire des mots possibles », écrit le poète et réalisateur italien Pier Paolo Pasolini dans « Le cinéma de poésie ». Les plus grandes questions à avoir habité le cinéaste sont sans contredit celles des rapports, extrinsèques et intrinsèques, entre le cinéma et la poésie : existe-t-il un cinéma poétique ? comment définir la poésie propre au cinéma ? le cinéma peut-il être la langue de la poésie ? par la poésie, le cinéma peut-il devenir une langue universelle ? Face à un tel chantier, il faut à nouveau reconnaître l’inévitable échec de tout désir, indubitablement péremptoire, de synthèse : peu importe le média qui lui donne forme, la poésie n’est pas un système, mais, précisément, la négation positive de tout système à travers la possibilité sans cesse renouvelée de leur ouverture. La poésie revient, encore et toujours, à ouvrir ce dictionnaire infini auquel nos vies et nos rencontres continuent d’ajouter des pages.

C’est à travers le prisme d’une telle considération, à la fois atemporelle et urgente, sur la nature poétique de l’image cinématographique que gagne à être compris – et apprécié – le dernier film de la réalisatrice Kim O’Bomsawin, Je m’appelle humain (dont une version écourtée est actuellement disponible sur ICI TOU.TV). Compilant les prix et les honneurs depuis sa sortie à l’automne dernier, ce film cherche à définir ce qu’est la poésie à travers une figure singulière, celle de l’artiste innue Joséphine Bacon, personnalité-phare de la culture autochtone, dont l’œuvre rayonne aujourd’hui de tous ses feux. Après des années nomades à travailler comme traductrice et interprète, après avoir frayé avec le milieu du cinéma et de la télévision, Bacon n’est arrivée que tardivement, et presque par accident, à l’écriture poétique. Ayant d’abord signé une contribution à Aimititau ! Parlons-nous ! (2008), ouvrage dirigé par Laure Morali où s’entremêlent des correspondances poétiques entre vingt-neuf auteurs du Québec et des Premières Nations, Bacon publie Bâtons à message/Tshissinuatshitakana, son premier recueil de poésie (ouvrage bilingue français/innu, comme tous ses livres subséquents) en 2009, à plus de soixante ans. Or, comme le démontre avec un mélange de force et de subtilité Je m’appelle humain, la poésie ne se trouve pas seulement – et même pas principalement – dans les livres, mais dans une série d’expériences vécues : celles de la langue, du territoire, des amitiés, de la douleur, de l’oubli et du renouveau.

S’inscrivant naturellement dans la filmographie d’O’Bomsawin, qui, du petit au grand écran et de la salle de cinéma au Web, propose une réflexion sur l’identité autochtone, Je m’appelle humain est aussi, en date d’aujourd’hui, l’œuvre la plus cinématographique et la plus achevée sur le plan stylistique de la jeune réalisatrice. En effet, alors que son précédent film, Ce silence qui tue (2018), optait pour un didactisme télévisuel qui laissait toute la place au sujet du documentaire, soit la violence faite aux femmes autochtones, Je m’appelle humain met à profit toutes les ressources de la production cinématographique afin de proposer une expérience sensorielle, esthétique et éthique qui ne prend tout son sens que sur l’opulence de la toile tendue d’un écran de cinéma (contexte de visionnement dont, malheureusement, la pandémie priva le film…). Par la magnificence du grand écran et grâce aux moyens d’une mise en scène ostensiblement cinématographique (gros plans, ralentis, accélérés, plans aériens, animation, format cinémascope, etc.), O’Bomsawin et Bacon – qui n’est pas seulement le « sujet » du film, mais son âme, son cœur et sa voix – orchestrent ainsi un triple questionnement sur les liens irréductibles qui se tissent entre la poésie, le cinéma, les Premières Nations ainsi que sur les différentes manières d’être au monde qu’ils proposent.
Du portrait au paysage
« Tout le temps que j’ai travaillé avec les vieux, je les ai toujours vus assis face à l’horizon. […] J’imagine qu’ils voyaient une partie de leur vie quand ils étaient nomades. Et ils devaient voir de la poésie aussi. […] Le mot “poésie”, en innu, est un mot qui n’existe pas. C’est un mot que l’on a inventé. Je pense que l’on n’avait pas besoin d’avoir les mots “poème” ou “poésie” dans notre langue, parce qu’on était poètes juste à vivre en harmonie avec l’eau, avec la terre. Dans leur silence, c’étaient de grands poètes », raconte Bacon à O’Bomsawin lors de la première scène du film. Déjà, tout est dit : assise sur les rives du fleuve Saint-Laurent, dans le territoire innu Mushuau-nipi, la tête dans les nuages et les pieds dans le sable, Bacon décrit la poésie non pas comme un jeu formel avec le langage, la recherche d’un style ou la création d’effets littéraires, mais, de façon en apparence plus simple – et pourtant ô combien plus complexe – comme un certain rapport au vécu, à l’espace, au temps et à la parole. On retrouve l’idée pasolinienne du dictionnaire infini, car tout, en innu, même le silence, même un regard, même un horizon, a le potentiel de devenir poétique.

Or, dans cette poésie, point de message, de clé ou de secret à décoder, mais une expérience transductive où l’enjeu est d’arriver à voir le monde par les yeux de l’autre, de l’entendre avec son ouïe, de le toucher à travers ses mots, afin de vivre une autre vie que la nôtre et, chemin faisant, gagner un supplément d’âme. Œuvre intimiste, construite sur une suite non dramatique de confidences, de souvenirs, de pérégrinations et de contemplations, Je m’appelle humain, comme le montre bien son ouverture, est à la fois un film-portrait et un film-paysage : du visage lumineux de Bacon, sur lequel le temps a gravé ses joies et ses peines, on passe à la beauté du territoire, lui aussi fait de nuances, de détails et de surprises, que la caméra prendra plaisir à découvrir pour nous. Parfaite coexistence de l’intime et du collectif, du proche et du lointain, du corps et du territoire, le film repose aussi sur l’harmonie des images et des sons, au point où l’on ne sait plus si ce sont les plans d’O’Bomsawin qui bercent les paroles de Bacon ou si c’est l’inverse. Maillage entre la cinéaste et son personnage, entre la lentille de l’objectif et le grain de la voix, entre un espace et ce qui l’habite, entre l’humain et le non-humain, Je m’appelle humain supprime la distance entre le documentaire et la poésie pour nous donner à expérimenter le monde – celui de Bacon, d’abord, mais aussi celui de tout spectateur – dans toute la diversité de ses rapports et de ses rimes.
De la disparition à la transmission
Pendant près de quatre-vingts minutes, nous accompagnons Bacon dans ses rencontres, son vagabondage, ses rêveries, ses souvenirs. Toujours, nous serons fascinés par son sourire, signe de la force avec laquelle cette « femme-ancêtre » (comme elle se décrit elle-même) traverse l’existence, le dos courbé non seulement par le poids des années, mais aussi par celui de toutes ces vies, ces cultures et ces mémoires que sa poésie a permis de sauver.

Nous verrons Bacon se livrer à différents exercices médiatiques et mondains (émission de radio, réception d’un prix, causerie littéraire, etc.) pour assurer la passation de son œuvre et de son désir d’écrire. Nous découvrirons son entourage, ses amis et ses proches, dont, bien sûr, Laure Morali et Marie-Andrée Gill, jeune auteure innue et québécoise, symbole de la nouvelle génération d’écrivaines et d’écrivains des Premières Nations, qui, dans une scène qui rappelle ostensiblement La ballade de Narayama, portera la grande poétesse sur son dos pour l’amener jusqu’à un sommet rocheux à partir duquel elles contempleront l’horizon.
Nous la suivrons aussi dans les rues de Montréal, alors qu’elle revient sur ses années d’itinérance, ses premiers logements, les rues qu’elle a arpentées à son arrivée dans la métropole. Nous l’entendrons commenter le caractère transitoire et la modernisation des grandes villes, sa fascination pour les gratte-ciel, pour ensuite, grâce à la magie du cinéma, la voir dans des espaces complètement différents, ceux des territoires des Premières Nations et d’autres lieux de son enfance encore, dont elle tentera aussi de dire la beauté. Alors que la critique a plutôt loué le sujet du film que sa forme, il semble qu’il faille surtout ici rendre crédit à O’Bomsawin, qui, avec maîtrise, propose une œuvre d’une étonnante densité, grand voyage dans le temps et dans l’espace qui, sans édification inutile, raconte dans un savant mélange de simplicité et d’humanité l’histoire d’une vie, d’un peuple, d’une langue.

Dans le sillage de La ligne rouge (2014) et Du Teweikan à l’électro (2018), deux autres films lumineux de l’œuvre d’O’Bomsawin, Je m’appelle humain fait le choix de raconter la réalité autochtone de manière éminemment positive – sans pour autant enfiler les proverbiales lunettes roses –, mettant ainsi l’emphase sur l’espoir, la résilience (mot que la réalisatrice dit ne pas aimer, mais qui convient pourtant tout à fait à sa démarche) et le futur. Mais le film n’esquivera pas pour autant les sujets noirs difficiles, à commencer par celui des tristement célèbres pensionnats mis en place par le Département des affaires indiennes au XIXe siècle pour assimiler les enfants autochtones, dont la dernière institution n’a fermé ses portes qu’au milieu des années 1990. Également centrale dans Ce silence qui tue, cette dure réalité sera montrée par des images d’archives inédites, de même qu’en revisitant les lieux et les bâtiments (certains détruits, d’autres toujours en place) qui étaient utilisés par les autorités canadiennes. Mais ce qui est encore plus fort que ce témoignage par l’image, c’est la difficulté qu’a Bacon, interrogée par Gill qui lui demande si elle a de la colère d’y avoir passé près de quinze ans, de revenir sur ces événements. « J’aime pas beaucoup parler du pensionnat, je dois t’avouer. […] C’est comme si j’avais été privée de voir c’est quoi une famille, la tendresse, l’affection. […] C’est comme si on m’avait vidée de ça, en venant au pensionnat. C’est un vide que j’essaie de combler maintenant, avec mes petits-fils. […] Ça fait mal d’en parler » dit Bacon, dont la voix, pour un rare moment dans le film, hésite et tremble. O’Bomsawin fait ici preuve d’une des plus grandes qualités qu’une documentariste peut avoir : la retenue. Œuvre solaire, totale, rayonnante, Je m’appelle humain porte en son centre les traces et les séquelles de ce vide que Bacon refuse de décrire. Au même titre qu’il n’y a pas de mot en innu pour dire « poème » ou « poésie », aucune langue n’a les ressources pour qualifier, et encore moins pour tenter d’expliquer, une telle expérience de dépossession. Alors que tout le film est dans l’affirmation et la positivité, on se bute ici, sans pour autant tomber dans le didactisme ou la moralité, à une forme de négation et de refus. D’un point de vue dialectique, ce sont bien ce vide et cette noirceur installés au cœur de l’œuvre qui rendent possible la pure luminosité de ses multiples horizons.

Le gai savoir
Dans un entretien accordé à La Presse en mai 2019 à la suite de l’obtention du Prix des libraires pour son dernier recueil, Uiesh / Quelque part, Bacon est appelée à identifier certaines choses qui la définissent, tels un livre, une cause, une phrase, un personnage contemporain. On apprend ainsi que son film préféré est Les temps modernes (1936) et que Chaplin est son « idole ». D’apparence anodine ou inattendue, cette déclaration nous permet, rétrospectivement, de mieux comprendre la qualité photogénique si particulière de Bacon dans Je m’appelle humain. Comme Charlot, la poétesse est une vagabonde, une nomade, une troubadour. Comme lui, elle se déplace avec une canne, parcourt l’espace de son corps hors-norme et magnifique. Surtout, elle résiste à l’aliénation du monde moderne, défend la mémoire des aînés et des traditions, tout en créant des communautés, des agencements identitaires et des lignes de fuite. Ses yeux et son sourire sont sans malice, manifestant seulement le bonheur d’être ici et un certain émerveillement. Toutes les scènes du film, même les plus solennelles, même les plus tristes, seront teintées de cette aura positive qui se dégage des grandes figures comiques. Et c’est d’abord par sa monstration du corps de la poétesse, par le soin que la caméra met à suivre ses gestes et ses déambulations, par les moyens que la mise en scène utilise pour nous faire habiter l’espace avec elle et pour nous transporter dans son horizon que Je m’appelle humain est un film important. Sans tomber dans la pédagogie ou l’esthétisme, le fade ou le grandiloquent, O’Bomsawin, grâce à et avec Bacon, a su réaliser l’idéal de tout cinéma poétique : le gai savoir.