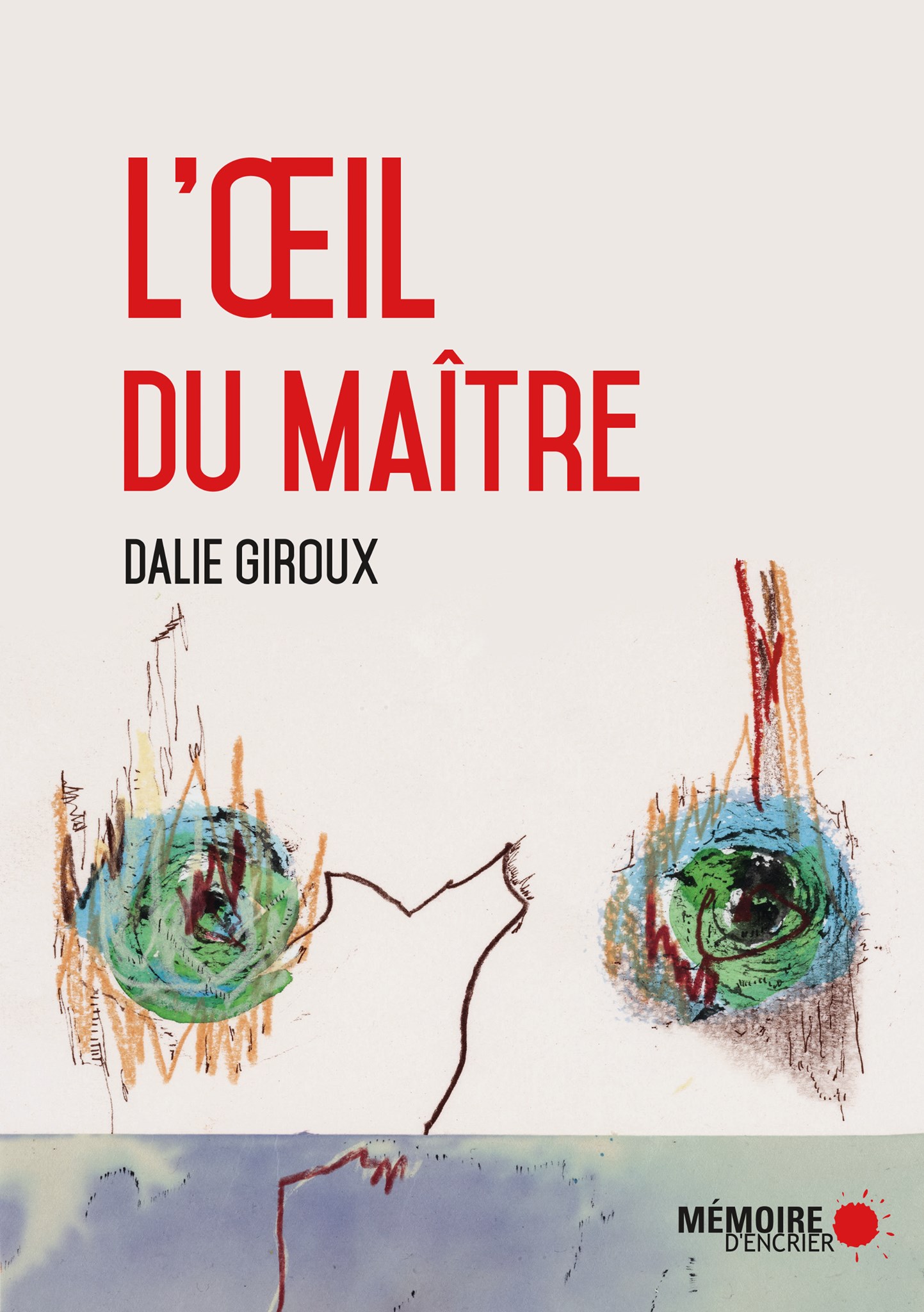Marion Zilio, Le livre des larves : comment nous sommes devenu.e.s nos proies, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Perspectives critiques », 2020, 195 p.
///
Moi, ça m’intéresse qu’une page fuie par tous les bouts,
et pourtant qu’elle soit bien fermée sur soi comme un œuf.
Et puis, qu’il y ait des rétentions, des résonances,
des précipitations, et plein de larves dans un livre.
Gilles Deleuze, Pourparlers (1972-1990)
Un titre au magnétisme singulier, dont l’effet répulsif est à la mesure de la curiosité qu’il suscite. Cette dialectique tient en partie au genre littéraire de l’ouvrage adopté par la docteure en esthétique et critique d’art Marion Zilio : non pas un manuel d’entomologie ou de biologie, qui nous laisserait sans surprise devant le sujet choisi, mais bien un essai, soit une écriture de la mise à l’épreuve qui fuit par tous les bouts, se risque à quelque chose comme un dévoiement des ontologies relationnelles en frayant au sol de la pensée des avenues volontairement incertaines, voire rétives aux vues homogènes jetées sur le réel. Porteur de multiplicités, l’essai malmène l’axiome, tente plutôt les résonances et les précipitations de tous ordres à faire nœud par la compénétration des régimes de compréhension de ce par quoi nous sommes cernés, traversés. Il creuse des chemins de savoir en défaut d’alignement, par lesquels pointent d’autres manières de faire monde.
Et pour éclaireuse dans ces corridors souterrains de la réflexion où le connu se pare d’atours étrangers, où, à suivre Zilio, l’humain est sommé de céder le passage au vivant : la larve, figure peu ragoûtante s’il en est, souvent associée à des univers interlopes, mais élevée ici à la dignité humaine, en tant que son égal en droits et privilèges, car, soutient l’auteure, « nous ne sommes rien de plus, en réalité, que des larves parmi les autres », c’est-à-dire des êtres non finis, métamorphiques, en transformation ou, pour parler avec Giorgio Agamben, des « singularités quelconques » à l’identité fuyante, composite. Inflexible dans sa volonté d’assigner l’homme aux bas-côtés du monde pour accorder la place centrale aux autres étants, le paradigme larvaire façonné par Zilio a de quoi soulever l’étonnement sans brouiller, toutefois, les linéaments traditionnels des anthropologies du décentrement qui ont fait des formes de vie non humaines les leviers de renégociation de notre exceptionnalité
/01
/01
La thèse de l’exception humaine a été brillamment analysée par Jean-Marie Schaeffer dans La fin de l’exception humaine, Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 2007. 464 p.
.
Dans le vivarium
Pour être saisi, le réel doit pouvoir trouver dans la pensée des points d’ancrage, une manière d’écho qui dispose au dialogue morphologies réflexives et sensibles. C’est pourquoi Deleuze soutenait que « [f]ictifs ou réels, animés ou inanimés, il faut fabriquer ses intercesseurs. » (Pourparlers (1972-1990), 2003) Comme en acquiescement à cet impératif, Zilio s’est dotée d’un guide pour le moins insolite, qu’elle souhaite à même de répondre à la « nécessité de décentrer notre regard ». La larve et son mode d’être parasitaire s’offrent ainsi tel un contre-récit, une façon de se déprendre d’une posture dominante autant que forclose qui serait dorénavant intenable et dans laquelle s’est établi l’humain. La mise en procès de cette hégémonie délétère, encline à l’inconsidération de toute altérité inhumaine, est énoncée sans ambages : « De l’humanisme au Chthulu, il s’agit de renverser la pyramide en haut de laquelle un certain homme blanc occidental s’était installé, afin de recouvrer une place parmi les autres. » S’appréhender comme en décroché, pour mieux briser le refus de « s’individuer par contacts et transformations réciproques », pour réintégrer le maillage du vivant et le principe de coexistence qui le fonde. « Nous sommes le parasite d’un autre, relève Zilio, et ce parasitisme est à l’origine de l’intersubjectivité du monde ».
La croyance en notre prééminence nous aurait ainsi fait déchoir de ce métissage naturel composé de « rencontres virales et parasitaires […] au cours desquelles nous sommes inventé.e.s comme « humains » ». La répudiation de cette dimension inclusive, qui nous rend vulnérable – autant que redevable – à l’autre, serait tributaire, nous dit l’auteure, d’une soif inextinguible de voir. L’homme est celui qui se plaît à enclocher à la fois son semblable et ce qui dissemble de lui. Il épingle son prochain, humain ou non-humain, tel l’entomologiste et ses insectes, à des fins d’études, de surveillance, pour se l’approprier, sinon le plier à sa volonté. Élaboré au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le vivarium, fabriqué pour « compos[er] et exhib[er] des possibilités de vie », a pris depuis les proportions de nos demeures, de nos villes, du monde lui-même : du drone aux réseaux sociaux en passant par les architectures de verre qui sortent toujours plus nombreuses de terre, nous avons cherché à déployer nos facultés d’exposition, à nourrir « un régime de visibilité prédatrice ». À cet égard, Zilio rappelle que « l’humain s’est inventé en se dévoilant. Si bien que l’homme, cet « animal supérieur », construit sa distinction prédatrice en s’inventant comme proie, c’est-à-dire comme cible. » Ce diagnostic peu reluisant posé à l’endroit du monde contemporain suscite la levée d’une question : comment faire pour que le regard ne possède, ne mette en boîte ? Pour que du désir de voir ne résultent des captures, des enfermements ? Sans doute faudrait-il travailler à reconnaître ce que peut la dissemblance en termes de puissance cohésive …
Défaut d’origine
La posthumanité a si bien pénétré la pensée contemporaine du corps qu’il est désormais presque impossible de considérer notre chair autrement que comme une enveloppe de peau entravante, inefficace, « morceau de contingence […] révél[ant] notre part maudite, la limite à notre capacité d’être », notait Maxime Coulombe (Imaginer le posthumain : sociologie de l’art et archéologie d’un vertige, 2009). Ce discours n’a eu de cesse d’en étarquer les manques, les faillibilités autant que les limitations et les insuffisances. Si Zilio déplace quelque peu la teneur du point de vue posthumain sur la défaillance corporelle, elle en conserve le ton : « L’homme se considère comme un individu supérieur, mais il demeure un être dont la déficience biologique fait de lui un animal à la naissance prématurée. […] Ce défaut d’origine accrédite la thèse néoténique, celle d’un être essentiellement inachevé, qui doit, pour pallier son incomplétude, se doter d’outils et d’organes artificiels. » N’est incomplet ou perçu en défaut de nature que ce sur quoi a été projeté des attentes incompatibles avec ce que peut, constitutivement, un être donné. Contrairement à l’homme, souligne l’auteure, l’asticot jouit d’une autonomie nourricière dès sa venue au monde et l’axolotl, cet animal venu des lacs du Mexique, possède la capacité de se reproduire à l’état larvaire. Le réquisitoire que mène Zilio contre la pensée d’une suprématie de l’humain se montre certes généreux en exemples issus de modes d’existences d’autres espèces et en théories interdisciplinaires visant à déboulonner les schémas anthropomorphes, mais laisse songeur quant à la possibilité même ténue de vivre sainement avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes, c’est-à-dire des êtres faits de fragilités. Ces brisures qui nous constituent, ces failles dont nous sommes parcourus, se montrent belles, malgré tout. Les reconnaître telles, enfin, est peut-être ce qui nous rendra plus respectueux des entités autres avec lesquelles nous partageons le monde.