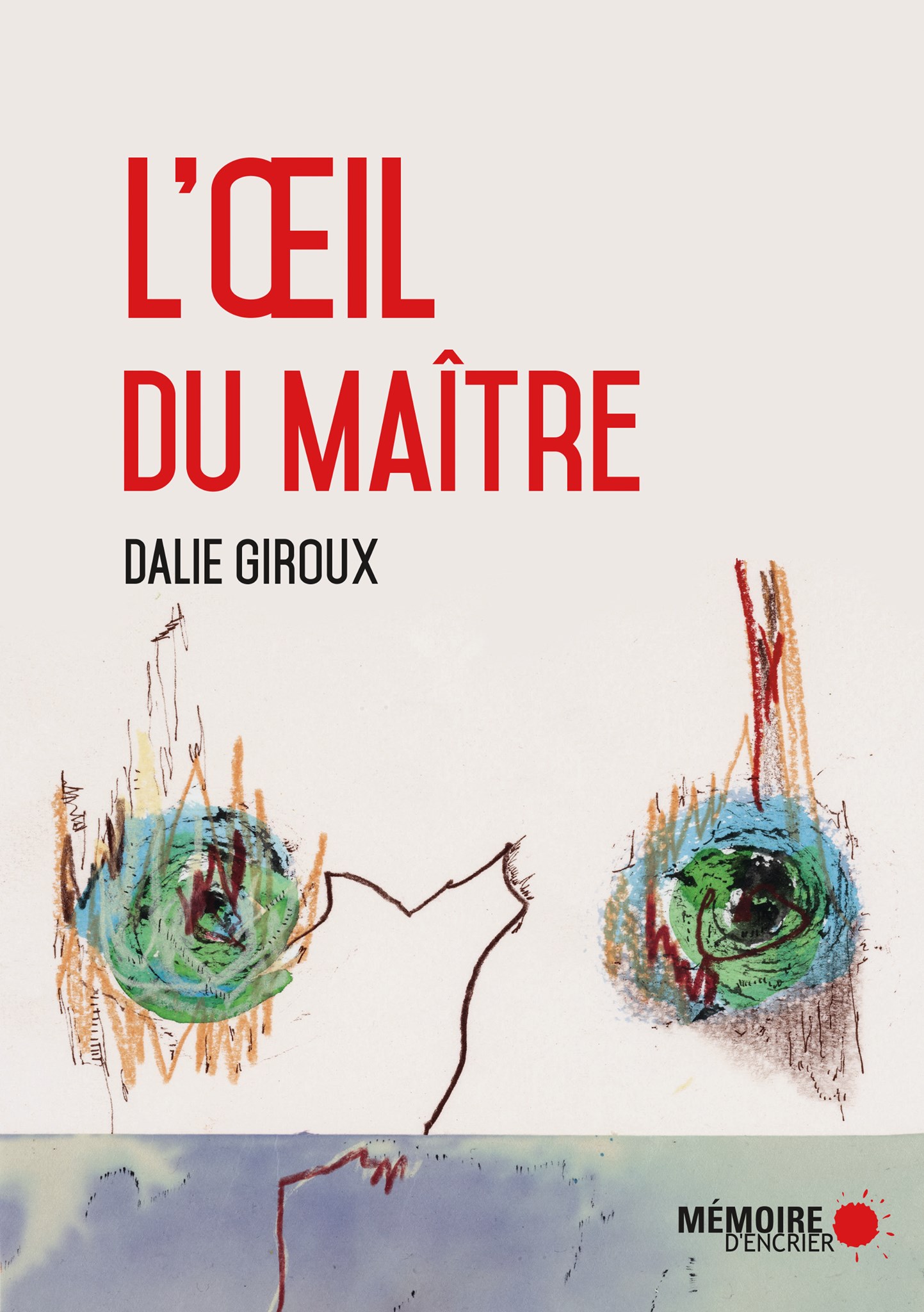Nadia, Butterfly, Pascal Plante, Maison 4:3, 2020, 107 minutes.
///
Pour certaines âmes, l’eau est la matière du désespoir.
— Gaston Bachelard, L’eau et les rêves
La chose du monde la mieux partagée
« Un enfant champion […] apprend très vite que l’effort suscite une douleur physique, que la mobilisation du corps est en première ligne et qu’elle requerra une force psychologique pour pallier toutes les fragilités », écrit Isabelle Queval dans son très beau livre Philosophie de l’effort. Devenir champion et athlète de haut niveau, en somme, revient à renoncer à une sorte d’innocence et de normalité pour plonger – ici, c’est le cas de le dire – dans une permanente conscience de soi. S’il est pratiqué à un certain niveau d’intensité et avec l’espoir reconnu d’améliorer constamment ses performances, le sport devient le plus intransigeant des miroirs. Cette conscience de soi atrophiée qui est la conséquence d’une vie normale sacrifiée pour atteindre une excellence atypique qui est à la fois son propre objet et sa propre fin est le sujet du dernier film de Pascal Plante, Nadia, Butterfly. Initialement sélectionné pour l’édition 2020 du Festival de Cannes, Nadia, Butterfly est un film sur le changement, l’amitié, la rupture, le rêve, la métamorphose.

Deuxième long métrage du réalisateur, après Les faux tatouages (2017) – sorte de Before Sunrise (Richard Linklater, 1995) adolescent, d’une lumineuse poésie –, Nadia, Butterfly est ce qu’il convient d’appeler un « film de sport ». Il s’agit d’un genre particulièrement bien représenté dans la filmographie québécoise, en particulier lors de la grande époque du cinéma direct : Le sport et les hommes (1959), Golden Gloves (1961), La lutte (1961), 36, 000 brasses (1962), Patinoire (1962), Le coureur (1962), Un jeu si simple (1964), Curling, quand tu nous tiens (1964), 60 cycles (1965), Volleyball (1966), Sabre et fleuret (1966). Pourquoi une telle effervescence ? Au-delà des raisons sociales (dans les années 1970, ce corpus augmentera avec l’arrivée des Jeux olympiques à Montréal) et médiatiques (ces films étaient souvent des reportages destinés à la télévision, à une époque où le langage audiovisuel du cinéma était le seul moyen pour transmettre l’expérience du sport et de la compétition), il existe aussi une raison esthétique : âge d’or du documentaire au Québec, le corpus des années 1960 offrait le type de représentation idoine pour capter le sport (l’effort, la performance, la course, le match) et le transformer en récit. Tout film de sport est, par nature, un film à dominante documentaire. Même si l’enregistrement, la mise en scène et le montage d’une compétition sportive demandent toujours un certain travail et une certaine vision, il n’en demeure pas moins que la valeur primordiale demeure l’effet de réel, le sentiment que nous assistons véritablement à quelque chose d’unique, qu’aucun artifice ne peut remplacer.

Essentiellement placé du côté de la fiction cinématographique (voire de la poésie), Nadia, Butterfly repose tout de même sur un solide socle documentaire : celui, d’abord, du réalisateur Pascal Plante lui-même, qui a fait de la natation de haut niveau pendant une dizaine d’années, puis, évidemment, de ses comédiennes principales, Katerine Savard – initialement approchée à titre de consultante, et qui interprétera finalement le personnage éponyme du film –, Ariane Mainville et Cailin McMurray, qui évoluent toujours dans cet univers aujourd’hui. Il en va de même pour Hilary Caldwell, Pierre-Hugo Caron-Cantin et d’autres comédiens du film, qui ont passé plusieurs années dans le monde de la natation et qui renfilent ici leur maillot pour l’occasion. Ce maillage entre documentaire et fiction qui caractérise l’origine et la production du film est également au cœur de son esthétique et de son rapport à l’énonciation cinématographique.
Automatisme et onirisme
Fasciné par les êtres marginaux qui, avec passion, font des choses hors de l’ordinaire et suivent leurs rêves jusqu’au bout, Plante est un cinéaste dont tous les films, courts ou longs métrages, en plus de leur côté profondément humain, affichent une réflexion sur la dimension technique du cinéma. On y remarque justement une représentation constante de la musique et de la photographie – le son et l’image –, qui s’incrustent au centre des histoires que le cinéaste veut raconter : après une comédie musicale extravagante dans une maison de retraite (La fleur de l’âge, 2011), un récit centré autour d’une chanson de karaoké (Baby Blues, 2012) ou d’une pratique musicale (Drum de marde !, 2015), Les faux tatouages est une œuvre éminemment nostalgique qui, à travers les photographies en particulier et par les procédés de reproductibilité technique en général, médite sur la perte. Dans Nadia, Butterfly, on ne compte plus les scènes qui représentent l’acte photographique ainsi qu’une monstration des écrans comme mémoire en continu d’un monde, celui du sport, où tout est archivé, classé, remontré. Réalisateur qui pense les relations interpersonnelles ainsi que les parcours de vie à partir d’une inventivité technique constante, Plante – héritier en cela du cinéma de John Cassavetes – accorde une place centrale à la notion de performance : choisissant un rythme basé sur la subjectivité de l’émotion et le temps intérieur plutôt que sur la logique strictement narrative, il construit ses films autour de plans séquences qui mettent en valeur un moment clé ou symbolique d’une vie – le concours de mini-miss, la rencontre de Théophile et de Marguerite, la dernière course de Nadia, etc. –, dont l’impact psychoaffectif deviendra ensuite un défi pour la mise en scène. Documentaires en raison de leur qualité de trace ainsi que par leur démarche qui consiste à rendre compte d’un moment critique d’une vie, les films de Plante s’affichent toutefois comme éminemment fictionnels. La vie est une performance que le cinéma doit capter pour mieux se traduire en expérience poétique.

Film qui met en scène les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 – de manière d’emblée souhaitée comme fictionnelle mais, depuis la pandémie, de manière involontairement anachronique –, Nadia, Butterfly est assurément l’œuvre de Plante qui pousse le plus loin ce maillage entre documentaire et fiction, performance et poésie, tranche de vie et réalité technique. Ce jeu entre deux modes d’énonciation cinématographique prend forme ici dans l’oscillation qui nous amène de l’automatisme à l’onirisme : automatisme des mouvements des nageuses de l’équipe canadienne dont, depuis le point de vue de Nadia, nous suivons l’histoire lors de ces jeux, puis onirisme des pensées qui envahissent Nadia alors qu’elle se met à réfléchir à son après-carrière, car Tokyo est d’emblée présentée comme la dernière destination de son parcours d’athlète professionnelle. À 24 ans, Nadia a décidé de changer de vie. Elle ne veut plus consacrer l’entièreté de son existence à la seule et même chose, qui n’a aucun sens à l’extérieur du cercle fermé des compétitions de natation : améliorer son temps au cent mètres de deux dixièmes de secondes…

À la précision millimétrique des gestes de l’effort, que la mise en scène de Plante arrive à rendre avec inventivité, s’oppose ainsi l’incertitude de l’existence d’une jeune femme qui désire le renouveau, sans savoir pour autant ce que cette rupture lui réserve. Alors que les films de sport sont souvent remplis de bons sentiments et passent par des montagnes russes d’émotions plus ou moins identiques (entraînement, défaite, nouvel entraînement, épreuve, victoire), Nadia, Butterfly, sans faire passer la compétition au second degré (Plante crée réellement une tension dramatique avec le sport), joue d’emblée un autre jeu : portrait psychologique d’un personnage qui se cherche, relecture symbolique du monde du sport depuis les affects incertains et impulsifs d’une athlète qui a pris la décision de quitter alors même qu’elle tente une dernière fois de prouver sa valeur sur la plus grande scène du monde, le film de Plante, par sa double maîtrise des codes du documentaire et de la fiction, a cette qualité de nous faire entrer dans un univers mental. Il propose un « voyage onirique » comme l’écrit Bachelard dans L’eau et les rêves, qui débouche sur une question : qui es-tu ?

« Sèche tes pleurs »
« Pour que j’aie du fun en faisant quelque chose, il faut vraiment que je sois bon. Pour être bon à la guitare, ça prend comme dix ans, et j’ai pas le temps pour ça » dit Théo à Mag dans Les faux tatouages après que celle-ci ait interprété de façon minimaliste « Sèche tes pleurs » de Daniel Bélanger, ce à quoi la jeune fille répond : « Pas besoin d’être bon pour avoir du fun. » Et Théo de conclure : « Ben moi oui… ». Ce syndrome, bien contemporain, du overachiever est omniprésent dans l’œuvre de Plante. Évidemment, Nadia en est aussi affectée, d’où l’enjeu du film qui porte son nom : que faire alors que l’on décide de ne plus faire la seule chose dans laquelle on excelle vraiment ? Comment vivre sa vie sans le filtre et le garde-fou de son plus grand talent, aussi ciblé soit-il ? Que peut devenir Nadia Beaudry sans la natation ?

Nadia, Butterfly : déjà le titre dit tout, mais sans pour autant révéler son mystère. Certes, le récit sera celui d’un passage, mais est-ce celui de la chenille vers le papillon ou celui, non moins inévitable, du papillon vers la mort, à la fin de sa courte vie ? Ayant consacré l’exclusivité des dix dernières années de sa vie à la nage, la seconde option semble d’emblée la plus logique, car l’intensité d’une carrière de nageuse se compare aisément à la brièveté de la vie d’un papillon. Toutefois, ce n’est pas ce que dit la mise en scène qui, au contraire, insiste de plusieurs façons sur la création d’un cocon : par le son d’abord, qui crée un fort effet d’immersion, puis par tous ces plans où Nadia est seule dans l’image, généralement dans une petite pièce, et où son corps se contorsionne, se disloque même, comme si l’on assistait physiquement à sa transformation. En complément au mélange de documentaire et de fiction, de sport et de poésie, Plante, pour illustrer les processus que traverse son personnage principal, œuvre aussi sur le double plan du sonore et du visuel, créant ainsi un univers d’une grande richesse. Il ira même jusqu’à confectionner, de manière artisanale, un format d’image qui n’existe pas, le 1.5 :1, choix hybride entre le classique 4 :3 et le moderne 16 :9. Unique par nature, chaque crise existentielle demande son propre format, son propre cadre.

L’amitié, celle entre Nadia et Marie-Pierre, sera ce qui unit tous ces éléments et ces motifs, en plus de leur donner leur véritable force émotive. « Au fond tu avais raison : les athlètes c’est selfish. Toi c’est ben beau, t’as tes projets, ça continue, médecine… mais moi, moi je me ramasse toute seule. Avec qui je vais racer, en pratique ? Avec qui je vais être en chambre, en compé ? Avec qui je vais bitcher ? Avec qui je vais déconner ? Pis avec qui je vais brailler ? » dit Marie-Pierre, celle qui reste, à Nadia, celle qui part. Ces questions, on s’en doute, lui feront verser une larme. Le sport, ce n’est pas seulement un trophée et une série de règles, mais, d’abord et avant tout, des relations humaines d’une rare intensité. Pendant cette scène, moment clé du film, où les deux jeunes femmes viennent de terminer leur entraînement sur la plage à Tokyo alors que le soleil est sur le point de se lever – on croit bien percevoir à nouveau l’influence de Linklater –, on comprend que le portrait psychologique était en fait un portrait de famille : Nadia n’est pas la seule à être affectée par sa transformation. Voulant sortir du monde égoïste du sport, qui demande de tout sacrifier pour atteindre momentanément l’excellence, Nadia redécouvre à la dérobée toutes celles et ceux qui l’entourent et qu’elle s’apprête à quitter. Elle sortira son téléphone, pour enregistrer leurs voix, à commencer par celle de Marie-Pierre. Film sur le présent, via l’intensité des compétitions sportives, film sur le futur, avec l’incertitude que provoquent les choix draconiens d’une vie, Nadia, Butterfly est également un film sur le passé, que l’on ne verra pourtant jamais, mais qui jaillit par intermittence dans presque toutes les scènes, à travers un geste, un regard, une larme. Préférant ne pas trancher entre la joie et la tristesse, l’euphorie et le désespoir, Plante a fait de la natation la métaphore de la vie dans ce qu’elle a de plus complexe et de plus beau.