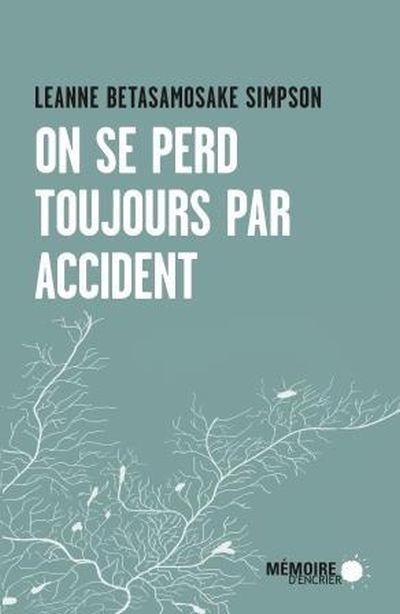Entretien avec Lorrie Jean-Louis autour de La Femme cent couleurs, Mémoire d’encrier, 2020, 104 p.
///
Il ne faut que quelques jours, écrit Christina Sharpe, pour que le corps d’une baleine sans vie atteigne le fond de la mer et soit intégralement consommé par les organismes benthiques qui s’y trouvent. Le corps humain, celui des esclaves comme celui des migrants Africains qui n’ont pas complété la traversée, n’a quant à lui que peu de chances d’atteindre le plancher marin – en eaux salées, il sera complètement effacé par le processus d’absorption bien avant. La « durée de séjour » d’une substance organique dans l’océan (la période entre son entrée et sa sortie) varie ; celle du sang humain, salé, est de 260 millions d’années. La vie noire habite donc la mer : elle y est restée et, en retour, elle est marquée par la violence et la distance qui s’y structurent mais aussi, nécessairement et conséquemment, par les résistances qui en émergent.
Je l’espérais ce jour-là ou le suivant quand il est arrivé : dans ma boite aux lettres m’attendait La femme cent couleurs, le premier recueil de Lorrie Jean-Louis tout juste paru chez Mémoire d’encrier. À partir de la surface inquiétante, dangereuse de la mer, à partir de ce qu’elle dit et nous dit, et jusque dans ses substances profondes, noyées, jusque dans ce qu’elle fait et nous fait, Lorrie Jean-Louis pratique une intervention fine avec la distance. La femme cents couleurs épelle cette texture et ce mouvement et je voulais en parler avec Lorrie.
Philippe Néméh-Nombré : Tu te souviens, Lorrie, je voulais commencer avec la mer. Je me suis demandé à toutes les quelques pages de La Femme cent couleurs : quand Lorrie va à la plage, quand elle est devant une étendue d’eau immense, est-ce qu’elle se baigne, est-ce qu’elle s’y aventure ?
Lorrie Jean-Louis : Oui, mais je ne sais pas bien nager, donc je ne vais pas loin. Mais je crois que même si je savais bien nager, je n’irais pas plus loin. La mer oblige à l’humilité.
PNN : Je trouve qu’une des matrices du recueil, c’est vraiment l’eau, autant comme possibilité que comme forme de violence.
LJL : J’aime ta lecture. C’est vrai. Il y a quelque chose de très attrayant, et à la fois quelque chose de très effrayant, je trouve, dans la mer. C’est une trop grande bouche. C’est tellement beau, mais en même temps…
PNN : C’est ce qui crée l’envers, aussi, de cette expérience afro-diasporique, de l’expérience noire. La beauté de ce dont on ne peut pas voir la limite, et en même temps le lieu de la perte.
LJL : Tout à fait. Si tu me demandes ce qu’est la mer pour moi, eh bien la réponse, elle est aussi dévastatrice. Je ne sais pas comment dire ça très clairement, mais la mer est irrévérencieuse. Quand on la voit pour la première fois, on la reconnait comme si la mémoire de la rencontre était dans les annales d’un temps jamais tout à fait révolu. Insolente, elle dit : « Oui, c’est bien moi. »
PNN : Ce qu’on y trouve va dans tous les sens, toutes les directions. Tu as tissé de cette manière, dans le recueil, ton rapport à la mer, mais sans le construire consciemment, au départ, n’est-ce pas ?
LJL : Exactement, ce n’était pas réfléchi. Je crois que je me laissais porter par les courants. C’est un risque à prendre quand on prend la mer. En écrivant, je savais que mon pouvoir était très limité.
PNN : La manière dont le recueil est organisé, en trois courants, c’est donc arrivé à la fin, après coup, en organisant un ensemble de poèmes qui se situaient déjà entre les différentes expériences et significations de la mer. Est-ce que ce sont des courants qui se frappent, qui se choquent, ou ce sont des courants qui plutôt se caressent, dansent ensemble ?
LJL : Je dirais plutôt que ce sont des courants qui dansent ensemble et qui se choquent. C’est le mouvement parfois harmonieux, parfois fracassant que je cherchais à atteindre. Dans la poésie, la beauté c’est le mouvement. Il n’y a rien de statique : lorsqu’on regarde la mer et qu’elle nous parait statique, elle bouge quand même, elle bouge toujours. On a l’impression, ou plutôt on sait qu’il s’y passe beaucoup de choses, mais on ne les voit pas. Je suis allée à Ouessant deux fois et la dernière fois, je me suis installée sur un petit monticule très loin des rives et je regardais. Il n’y a rien d’équivalent à la mer, qui existe à la fois avec une telle profondeur et en même temps une telle surface. Elle n’a pas de synonyme.
PNN : À qui, Lorrie, s’adresse La Femme cent couleurs ?
LJL : J’y ai pensé plusieurs fois. Ma première réponse serait qu’elle s’adresse à la jeune fille que j’étais, qui se posait des questions et qui n’avait aucune réponse. Par extension, ça s’adresse aux jeunes femmes, c’est-à-dire à celles qui commencent, si on veut, à avoir une conscience sociale, politique, de soi dans le monde, au milieu de l’adolescence. Ce sont les premières personnes à qui j’ai pensé.
Je ne sais pas si ça paraît bien, mais ce recueil est un dialogue avec beaucoup d’éléments. Je m’adresse aux oiseaux comme aux mauvaises herbes. Je ne voulais être indifférente à rien. Avec La Femme cent couleurs, j’ai voulu être à la hauteur des roches, des feuilles, de la louve, des femmes exclues, de la sève, des enfants maltraités, d’un ensemble d’éléments qu’on ne regarde jamais assez bien.
J’aimerais que tout le monde se retrouve, d’une façon ou d’une autre, dans toute cette complexité.
PNN : Plus je t’écoute et plus je suis fasciné que la continuité ne se soit pas profilée dès le départ, que la forme ne se soit pas présentée au moins en filigrane dès le début. J’aimerais te poser la même question autrement, ou plutôt la déplacer par rapport non pas à la forme mais à la substance de ce que tu voulais et veux dire. Les poèmes ont pris forme ensemble, en courants, a posteriori. Mais l’intention, les intentions, ce que les mots contiennent, ce qui est traduit dans la forme ?
LJL : Pour moi, écrire est une aventure. Je ne sais pas ce qui m’attend la phrase d’après. Je commence avec très peu de matériel et j’avance lentement. J’aime beaucoup que la vitalité de ces divers « objets » se révèle à moi au fur et à mesure. Écrire exige beaucoup d’humilité parce qu’il faut être attentive aux formes et au contenu. Je ne savais pas comment traduire ce mouvement. Par exemple, le poème qui est sur la quatrième de couverture m’a sauté à l’oreille alors que j’étais en Martinique. J’étais hantée et il fallait que je fasse un chemin pour cette voix qui est aussi la mienne.
Quand j’ai commencé à écrire, j’étais à la recherche d’un emploi stable dans mon domaine, en bibliothéconomie. Les nombreuses portes fermées qui se sont dressées devant moi m’ont plongée dans un désarroi social. Je donne rétrospectivement un sens à mon aventure ; j’y allais à l’aveugle. Quand j’ai commencé à écrire, je voulais trouver les moyens de comprendre ma place et ma voix.
PNN : Écrire pour comprendre le désarroi, pour y répondre, c’est un peu ce que la première ligne du prologue exprime : « Pour dire le feu sans brûler, j’écris des poèmes ».
LJL : Trouver sa place et sa voix est extrêmement difficile. J’adore faire de l’introspection et la souffrance des autres m’interpelle beaucoup. Je voulais aller là et j’y ai trouvé du feu. Le recueil est une traduction de ma route à travers ma peine. C’est de prendre acte de la situation dans laquelle je me retrouve et de me demander quelles sont ces voix, quelles sont ces voies que je ne connais pas et qui pourraient m’aider. C’est cela que dit, aussi, la dédicace. « À toutes ces femmes qui ont porté mes mères et mes pères ».
PNN : Qui est-elle ? Qui est la Femme cent couleurs ?
LJL : C’est une femme qui traverse le temps, qui traverse les lieux avec une couleur de peau noire. C’est une femme qui n’a pas d’espace où s’épancher, la Femme cent couleurs c’est toutes les femmes sans sépulture, toutes les femmes qui sont mortes noyées, qui sont mortes battues, en train de donner naissance. C’est toutes les voix de ces femmes qui arrivent jusqu’à moi.
C’est l’une de ces femmes dont parle Robyn Maynard dans NoirEs sous surveillance qui étaient femmes de ménage à Montréal parce qu’on ne leur laissait pas occuper d’autres postes et qu’on payait avec des vêtements usagés. Ce savoir m’attriste énormément et je cherche ces yeux qui pleurent en silence. Ces femmes qui sont humiliées génération après génération.
J’ai toujours écrit, mais quand la Femme cent couleurs est arrivée jusqu’à moi, le geste est devenu essentiel. Avec elle, il fallait traverser les lieux, les temps, aborder le continent Américain, le génocide des peuples autochtones, l’esclavage et l’État colonial ; tout cela en regardant l’océan.
PNN : En lisant le titre, avant de traverser le recueil, je me suis demandé s’il était question des femmes noires précisément, principalement.
LJL : Oui, mais très vite, pas seulement. Je déteste l’expression « femme de couleur ». Elle abîme parce qu’elle ne veut rien dire réellement. Je me suis demandé quelle réponse offrir à cette expression insensée ; une femme plurielle.
C’est dans cette pluralité de voix que je vais vers ces autres femmes qui n’entrent pas dans la catégorie « femmes de couleur ».
PNN : Comment crois-tu que ce sera, ou que ça pourra être lu différemment ici, dans les Caraïbes, en Europe ?
LJL : Je me dis que puisque le sujet principal de mon questionnement est une femme arrachée de l’Afrique qui se retrouve indistinctement sur n’importe quel bateau négrier, qui se sont arrêtés en Europe, dans les Caraïbes, aux États-Unis, etc., pour moi, c’est donc une femme de partout. Cette femme est une femme sans passeport, sans visa, on la crache n’importe où. Cette expression confond de façon magistrale, c’est-à-dire par le temps et par le lieu, toutes les origines diverses des femmes noires. Que ce soit une femme congolaise en France ou dans les Caraïbes, elles entrent toutes également sous le dénominateur de « femme de couleur ». Ce sont toutes des femmes cent couleurs. Sur ce fil, je crois que beaucoup de femmes, et je l’espère, se sentiront interpellées.
PNN : J’aimerais insister sur quelque chose, quelque chose qui s’inscrit dans l’eau, dans la couleur, dans le mouvement. Tu parles du début, des bateaux négriers, de la cale des bateaux négriers, tu parles du début de toute cette violence qui se structure à partir de la traite. Mais j’ai aussi l’impression de lire, dans La Femme cent couleurs, le début de plusieurs possibilités : des solidarités, des manières de se comprendre. Ça vient de ce même endroit.
LJL : Tout est possible, oui. À partir de là. Un ensemble de choses que je ne peux pas énumérer, c’est-à-dire que c’est une promesse. C’est une promesse de pouvoir circuler dans le temps, dans les lieux, une promesse de pouvoir reconfigurer les choses et se dire qu’on peut faire autrement. Il y a des solidarités qui peuvent naître à partir du moment où on s’arrête et on se regarde. Je voulais écrire quelque chose qui ne soit pas simplement triste et fermé. Ça va mal, mais je suis là, et c’est déjà une promesse. La beauté aussi doit traverser ce que j’écris, quand j’écris pour briser le silence qui pèse sur les violences, sur nos vies. Comme je le dis plus haut, ma peine devait être transfigurée en lumière et en danse parce que c’est par amour que j’écris. L’amour sans espoir ne nourrit pas. L’exercice de l’espoir est difficile, exigeant mais salvateur.
PNN : Dans le troisième courant, il y a justement un poème sur ces possibilités. Sur l’une de ces possibilités qui prend la forme d’une relation avec une femme autochtone.
LJL : La femme cent couleurs est une femme qui marche. Elle va donc certainement rencontrer d’autres femmes. C’était pour moi évident que de penser ces rencontres, c’était de penser toutes les femmes qui sont exclues, qui sont à l’extérieur du système colonial. De croiser cette femme qui dit Kuei kuei, c’est une rencontre merveilleuse : je ne suis pas seule, je suis avec une femme qui connait la terre sur laquelle elle est. Pour moi, c’était important d’imaginer une rencontre comme celle-là au hasard des rues. Toutes les femmes sont potentiellement des Femmes cent couleurs. Le titre, c’est un refus des assignations ; il y a donc nécessairement solidarité avec d’autres femmes marginalisées. Ce que je refuse pour moi, je le refuse pour les autres.
Une fois que la Femme cent couleurs a bien voulu me tenir la main, que je me suis sentie assez digne de la suivre, j’ai eu confiance en mon geste. Pour moi, c’est la Femme cent couleurs qui est venue vers moi et c’est un geste de solidarité. Je ne peux pas perdre ça de vue sinon je suis perdue. L’amour était là et, comme je le pense depuis toujours, il est toujours trop tard pour reculer quand l’amour est là.