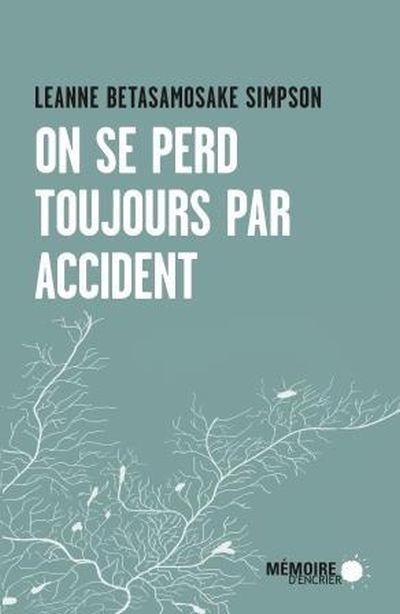On se perd toujours par accident, Leanne Betasamosake Simpson, traduit de l’anglais par Natasha Kanapé Fontaine et Arianne Des Rochers, Montréal, Mémoire d’encrier, 2020, 152 p.
///
« On ne se perd jamais volontairement, mais bien parce que les pistes sont brouillées, les outils brisés, et les repères effacés. Comment, en effet, retrouver son chemin si la boussole qui nous est léguée est coloniale, raciste et hétéropatriarcale ? Entre perdition et désobéissance, On se perd toujours par accident esquisse de nouveaux repères décoloniaux pour se reconquérir soi-même.
Reconquérir nos amours. Nos personnalités. Nos vies. Notre intensité. » (Note des traductrices, p. 141)
Il peut sembler étrange de débuter une critique littéraire par la note des traductrices. Cette note exprime cependant bien ce qui m’apparaît comme étant au cœur des expériences livrées dans ce dernier recueil de l’écrivaine et musicienne, membre de la communauté Michi Saagiig Nishnaabeg, Leanne Betasamosake Simpson. On se perd toujours par accident se présente comme une suite de fragments de diverses natures – courts récits, poèmes, chansons, suite d’observations ou de compte-rendus qui tendent tantôt vers le réalisme, tantôt vers un pur imaginaire – rassemblés en trois grandes parties, comme trois étapes ou trois vecteurs de la reconquête identitaire : « la rébellion est en chemin », « témoin sur une terre-promesse-brisée » et « reprendre possession des corps rouges ».
Déconstruire pour se réapproprier
On ne sait pas toujours comment ces fragments s’arriment entre eux : les personnages semblent les traverser à leur gré ; une toile de relations y est créée, mais elle paraît se métamorphoser constamment ; la voix narrative n’est pas toujours clairement attribuée. Mais voilà, il ne s’agit pas ici de relater une Histoire : ce que montrent ces fragments, c’est que la colonisation, la « réconciliation » et la décolonisation ne font pas partie de l’Histoire justement – la grande histoire, unique et déjà actée. Elles participent plutôt des histoires : singulières bien que partagées, se jouant non seulement au présent, mais au quotidien. Et si quelque chose doit rassembler ces histoires, outre l’expérience commune de la perte qui les travaille, c’est le souffle qui en porte les voix et les intensités (il faut ici saluer le travail des traductrices qui ont réussi à rendre avec naturel l’oralité de ce texte), du sentiment d’asphyxie à l’impression de grande respiration qu’on retrouve dans le magnifique fragment « brun sur fond bleu ». La forme fragmentaire permet ainsi d’ouvrir les lieux du livre aux multiples facettes de la réalité d’une génération largement urbaine, témoin à la fois de l’ascension sociale d’une partie de sa collectivité, de la réalité des réserves passée sous silence, et de la bonne conscience hypocrite des Blancs qui « soutiennent » gentiment les initiatives de réconciliation.
Reconstruire au quotidien
La reconstruction ne se fera pas à partir du haut, par une « réconciliation » dont l’hypocrisie est ici dénoncée de façon aussi grinçante que juste. Plutôt, Simpson propose de « donne[r] naissance à une nation de façon indigne, en rampant dans l’urine et les excréments et la saleté et les entrailles fumantes de la trahison ». Car l’histoire est ici pensée en tant qu’elle est vécue dans le corps des protagonistes, dans leurs relations, dans un quotidien qui n’est jamais coupé des enjeux sociaux et politiques – lesquels sourdent dans leurs pensées et leurs paroles, composantes fondamentales d’un flot de conscience intraitable : « Y a des fois où j’aimerais vraiment en savoir plus sur toi », déclare l’une des narratrices, dans une adresse imaginaire à la personne avec laquelle elle entretient une relation par textos depuis huit mois. « Par exemple, manges-tu de la viande ? Ou as-tu des frères et sœurs ? Ou lequel de tes parents est innu, et lequel est blanc ? Ou pourquoi est-ce que personne ne parle de lutte des classes, alors que d’ici la prochaine génération un nombre considérable d’Autochtones vont passer de la pauvreté à la classe moyenne ? Ou est-ce qu’elle sait que tu m’envoies quarante textos par jour ? Est-ce que c’est correct ? »
Ainsi, l’alternance entre textes éminemment engagés et fragments qui pataugent humoristiquement dans la trivialité des choses permet-elle finalement de télescoper ces différents pans de réalité au sein d’une expérience à la fois individuelle et collective du réel – l’expérience d’un fil brisé, de la perte irrémédiable et de la nécessaire reconstruction identitaire dans un monde à jamais transformé. Retrouver ce qui a été perdu, se retrouver, passe ici par l’actualisation de la tradition dans la vie urbaine : Sabe (qu’une note en fin de texte désigne comme « Bagwajiwininiwag dans le contexte des Nishnaabeg, aussi connu sous le nom de bigfoot ou sasquatch) » apparaît dans plusieurs fragments comme un personnage indiscernable des autres, les individus se confondent avec les esprits (qui manient d’ailleurs les technologies les plus récentes), et la communication avec la nature se fait par messagerie texte. On retrouve par ailleurs certains mythes fondateurs réécrits à la saveur 2020, avec une ironie mordante (produisant à la fois rire et malaise) que l’autrice maîtrise parfaitement.
Reconnaître une expérience qui n’est pas la sienne
Il est difficile de ne pas se reconnaître dans certains aspects des personnages : obsessions, angoisses, coups de gueule. Or, c’est bien là qu’agit le télescopage des réalités mis en place tout au long du livre : à chaque fois que j’ai l’impression de me reconnaître dans une situation, celle-ci m’échappe aussitôt. La pointe d’expérience peut être semblable, tout ce qui l’entoure et qui en fait une expérience m’est inconnu et le restera. Simpson l’indique dans ses remerciements, ces histoires sont écrites « directement et sincèrement, pour qu[’elle] puisse [s]e voir et voir [s]a collectivité sur ces pages ». L’un des grands intérêts de ce texte est de nous permettre, à nous qui ne sommes pas de cette collectivité, de la reconnaître comme telle, dans une altérité irréductible qui n’est pourtant pas sans point de partage.