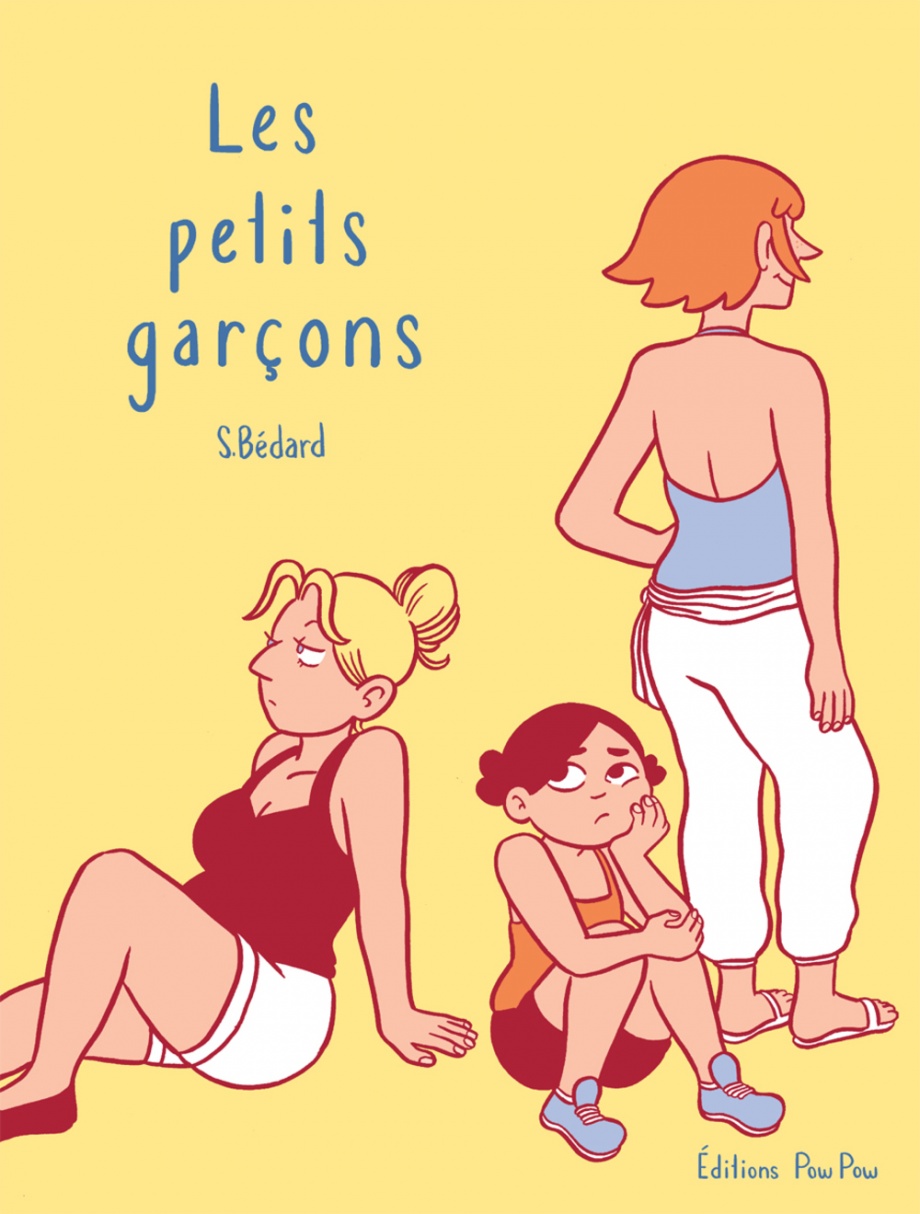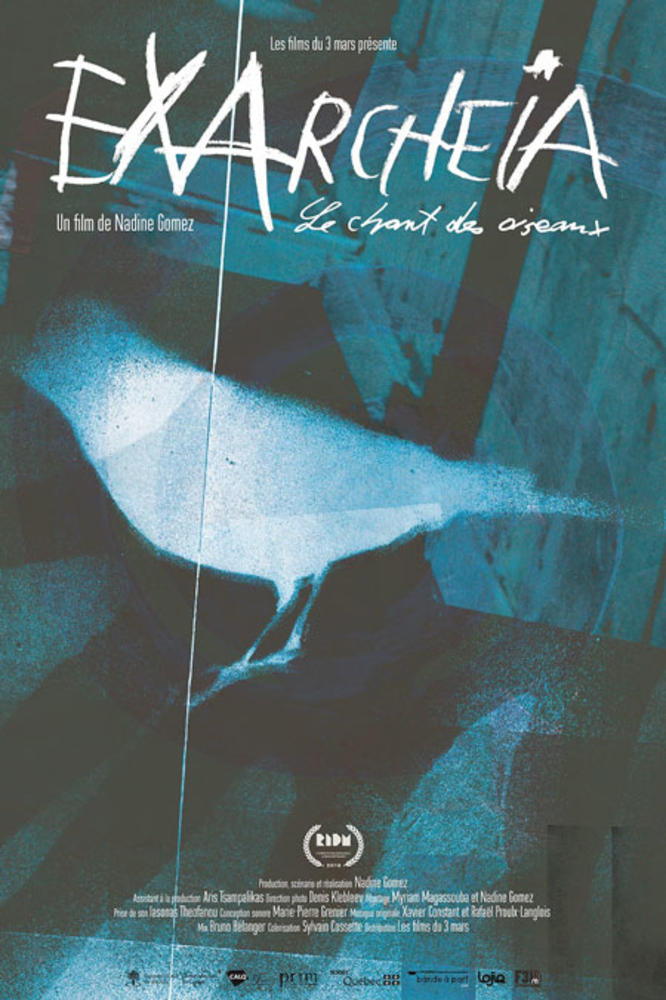La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, Texte : Michel Marc Bouchard ; mise en scène : Serge Denoncourt ; avec Éric Bruneau, Kim Despatis, Patrick Hivon, Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau et Mathieu Richard. Présenté au Théâtre du Nouveau Monde du 14 mai au 8 juin 2019.
///
Il y a un caractère attendu à la dernière pièce de Michel Marc Bouchard. On peut prendre ce terme de différentes manières.
Attendu, par son titre : La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé relève l’évidence du nœud dramatique. On sait que tout mène à cette nuit, qu’inévitablement on en dénouera le détail, et ça y sera, on comprendra ce qui explique l’attitude des personnages, cette fratrie veillant leur mère morte plusieurs années après le drame. La révélation de ce que fit Laurier Gaudreault cette nuit-là en se réveillant exposera sous son vrai jour une situation (un peu) cryptée. On l’attend. Mireille (Julie Le Breton) l’énonce on ne peut plus clairement aux deux tiers de la pièce : « La nuit du drame, parce qu’il a fallu une nuit du drame. » Tout y mène, tout en découle, il la faut. D’entrée de jeu, on apprend que le hobby de Mireille, dans sa prime jeunesse, consistait à visiter les maisons d’Alma durant la nuit pour regarder les gens dormir – ça ne pouvait que mal finir.

Attendu aussi par sa construction tragique : dans la pièce, on voit les codes de façon systématique se tendre comme des cordes, on pressent d’où les coups partiront, très vite on sait, sans savoir, ce qui surviendra. Quelques principes peuvent être présentés ici sans ne rien gâcher. D’abord, par sa manière un brin grossière de retenir l’information – qu’est-il arrivé cette nuit-là ? –, la pièce nous indique une évidence : si le spectateur ignore ce qui a eu lieu, alors que tous les personnages le savent, c’est qu’à terme, quand on apprendra le drame, il ne pourra être celui que tous connaissent. Voilà une mécanique de la tragédie. Il faut un personnage trahi, dont le sentiment de trahison, par catharsis, permettra d’atteindre le spectateur, rejouant sa surprise, ou l’induisant, au choix.
Ce personnage, c’est Denis (Éric Bruneau), survenant à la moitié du drame comme le Thésée de Phèdre, afin de pouvoir donner une épaisseur à la révélation. Autre procédé de cette nature : la pièce, ancrée dans ses ressors classiques, se fait utilitariste. Selon le vieux principe dit du fusil de Tchékhov, chaque information se verra chargée de sens – ou retournée – dans le dénouement, on ne laissera rien au hasard, la partition convenue reviendra sur chaque thème. Ainsi, on se demandait « et le petit chien ? », évoqué à quelques reprises comme « moment fondateur » dans la vocation de Mireille vers la thanatopraxie. Un épilogue nous rassure : le petit chien aussi mérite qu’on le raconte.
Attendu peut-être également par le caractère usé de son prétexte. Étienne Beaulieu, dans son essai Sang et lumière, qu’il consacrait au cinéma québécois, relevait comment nos films se voulaient théâtraux, chargés notamment du « tragique de la mort en communauté » ; mourir tragiquement, c’est la grande affaire de nos représentations culturelles. La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé ne fait pas exception. La mère de famille morte au centre de la pièce, alors qu’on la prépare pour l’exposition funéraire, les frères et la sœur qui se confrontent, le comique de situation – « faire des jokes quand c’est pas le moment, c’est exprimer un malaise », répète le benjamin, Éliot (Mathieu Richard), comme un mantra –, tout cela confine la scène à un lieu commun plutôt pépère. Évidemment, la charge canonique du rituel agit avec efficacité, et souvent l’émotion fera mouche. Il n’en demeure pas moins que cela pointe un certain confort.
Attendu, enfin (et voilà un trait délicat), dans la création de Michel Marc Bouchard. En effet, des Muses orphelines ou de Tom à la ferme, on voit ici se répéter les motifs – la réunion d’une fratrie, la veillée funèbre. Cela, il est vrai, participe d’une esthétique, d’une voix, et il serait bête de reprocher à un auteur de suivre un peu trop docilement sa propre trajectoire.
Tuer la métaphore
« Sacrer, ça tue la métaphore », énonce Éliot, citant le nouvel art de vivre de son frère aîné, Julien (Patrick Hivon) : le mot tabarnak permet aux personnages de faire l’économie d’expressions rares et précieuses pour nommer notre réel. De là, « tout est devenu vulgaire », se plaint-on. Ainsi, dans cette veillée funèbre, on comprend que se joue davantage que le secret de la nuit du drame. Mireille est de retour, après onze ans d’absence ; elle est une thanatopractrice de renom, ayant œuvré sur les corps de vedettes du monde entier. Elle a eu droit à des articles dans le Paris Match. Ses gestes font atteindre aux dépouilles le grand art. En ce sens, le clan se divise en deux : d’un côté, Julien et Mireille, sensibles à la beauté, et de l’autre, les deux frères et (peut-être surtout) Chantale (Magalie Lépine-Blondeau), épouse de Julien, caricature sans concession.
Un passage en particulier met de l’avant cette division entre les instruits et les ignares. À un moment de la scène, on évoque la cérémonie funéraire à venir et Mireille annonce qu’elle déclamera un poème : La Promenade des trois morts, d’Octave Crémazie. Les premiers vers laissent les ignares interdits et rieurs ; Julien rétorque : « On demandera pas à la littérature de s’adapter à tes 200 mots de vocabulaire ». Toute la pièce agit pour distinguer ces deux groupes.

Si Michel Marc Bouchard use effectivement d’humour dans cette dernière œuvre, peut-être davantage qu’ailleurs dans sa pratique, on rit souvent des personnages, un peu moins avec eux. Leurs deux cents mots de vocabulaire, leur répétition rituelle de phrases toutes faites, tout cela peut faire rire une grande salle du Quartier des spectacles, à Montréal, mais engage une sorte de gêne, comme si au fond – et je ne parle même pas d’éthique – il y avait là un geste trop commode pour être tout à fait appréciable. Encore une fois, dans cet humour se reconnaît une manière attendue.
Il faut le dire : la pièce, mise en scène par Serge Denoncourt, joue efficacement de ses effets. La musique confère à des scènes leur aura cinématographique, les quelques transitions servent la tension narrative comme il se doit. C’est lisse et rythmé, porté par tout ce qu’on pourrait aller attendre sur des sièges de théâtre. Le problème tient au fait que, loin d’ennuyer, la pièce se colle trop étroitement au conforme, évite les hoquets, s’agence sur le ronron d’une machine connue ; à si bien suivre nos attentes, toutefois, elle se garde de tout à fait nous surprendre.
crédits photos : Yves Renaud.