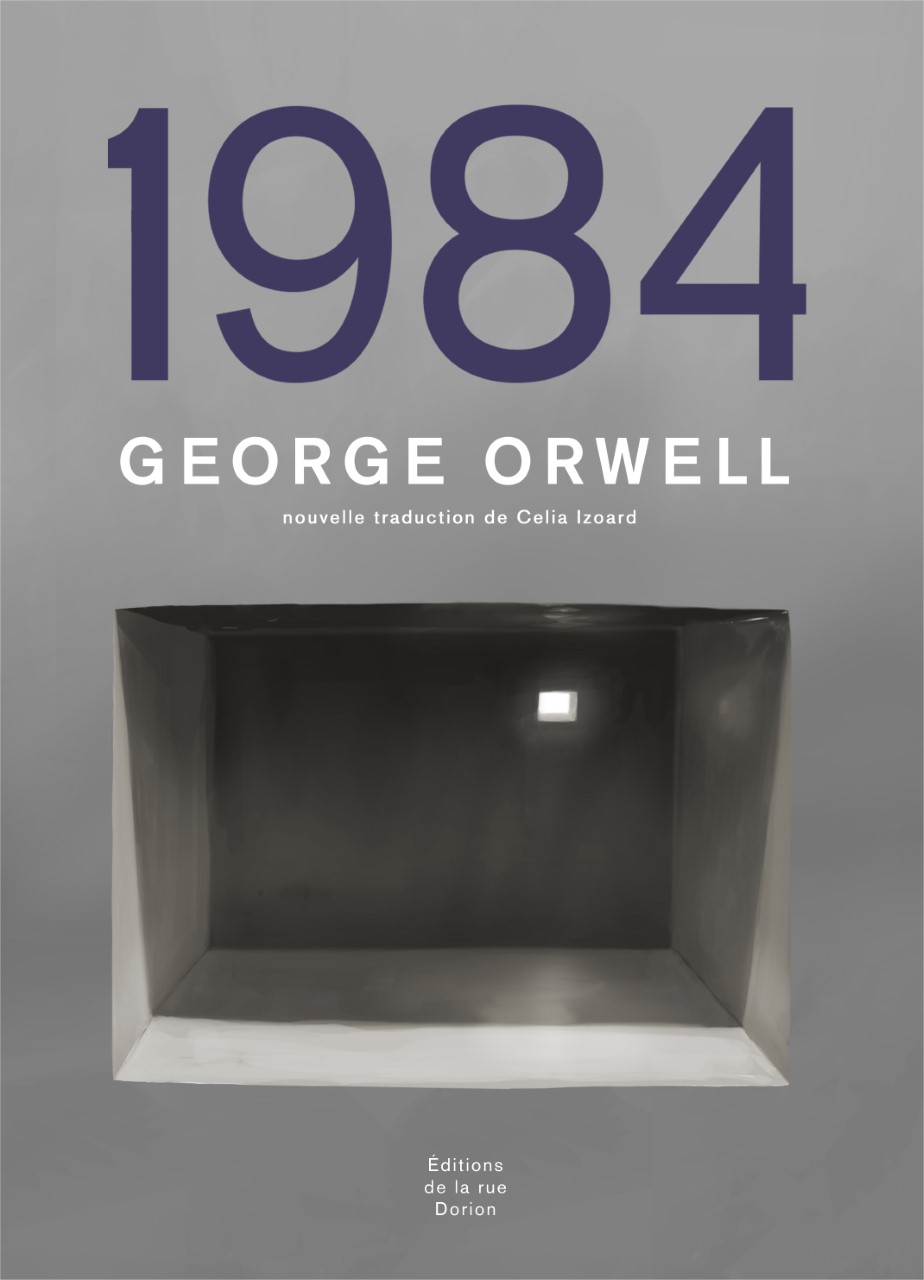ColoniséEs, texte : Annick Lefebvre ; mise en scène : René-Richard Cyr ; avec Maude Demers-Rivard, Myriam Fournier, Charles-Aubey Houde, Macha Limonchik, Benoit McGinnis, Sébastien Rajotte et Zoé Tremblay-Bianco ; présenté au Théâtre d’Aujourd’hui du 22 janvier au 16 février 2019.
///
C’étaient les 21 avril et 21 mai 2012. Par deux fois – l’une en plein Salon du Plan Nord, l’autre à la fin d’une soirée de printemps –, j’ai été pris en souricière avec des dizaines d’autres manifestants, tie-wrappé des heures durant en attendant ma contravention. Annick Lefebvre, dans ColoniséEs, parlera plutôt de la soirée du 23 mai 2012, alors que plus de 500 personnes avaient été arrêtées d’un coup à l’intersection Saint-Denis/Sherbrooke, là même où j’avais été pris deux soirs plus tôt, mais le récit est similaire.
L’autrice fait conjuguer la petite et la grande histoire dans un mouvement de balancier. Elle revisite l’Histoire (du mouvement souverainiste, des révoltes populaires depuis les années 1960, de l’indépendance) à travers celle du couple Gérald Godin et Pauline Julien ; en contrepoint de ce récit se déroule l’histoire de Québec (une jeune serveuse encore traumatisée des événements de 2012), qui essaie, en 2019, de faire sens de ses désillusions et de ses espoirs. Le récit, qui alterne entre les deux temporalités, joue sur une idée simple, mais inspirée : l’Histoire est faite d’individus d’exception dont on retiendra le nom, mais aussi de milliers d’anonymes, « d’humains anonymes, générateurs de joie ».

ColoniséEs nous rappelle que les plus grands espoirs collectifs de l’indépendance québécoise, mais aussi les différents épisodes de « révolutions » au xxe siècle, sont intrinsèquement liés à des moments douloureux : le samedi des matraques, la manifestation du 24 juin 1968, la crise d’Octobre et sa nuit d’arrestations, les maladies respectives de Godin et Julien, le suicide de Dédé Fortin, les arrestations massives de 2012.
Sur le papier, tous les éléments sont là pour que cette histoire me parle, m’interpelle. Et pourtant, quelque chose n’a pas pris. Peut-être suis-je encore trop réfractaire au récit de ce que l’Histoire appellera le Printemps Érable pour pouvoir recevoir ceux des autres. Chaque fois que des récits personnels (réel ou fictif) servent de point de départ pour viser l’universel, j’ai l’impression d’être dépossédé du mien. Ceci expliquerait pourquoi j’ai passé plus de temps à confronter mon vécu avec celui de Québec qu’à être ému par ce dernier.
Histoires intimes et politiques
Il y a pourtant une matière féconde dans ColoniséEs. Lefebvre, en s’inspirant de la vie de Pauline Julien et Gérald Godin, semble également imiter la prose de leurs échanges. C’est dans ces moments, où on échoue à deviner si elle cite des extraits de leurs correspondances ou si elle réussit à pasticher leurs styles respectifs, que le texte résonne le mieux. Certaines références sont explicites, comme la critique que Godin faisait d’un spectacle de Pauline Julien en 1961, qu’il décrivait en ces termes : « Pauline Julien est un petit arbre dur, entêté, tout à la fois noueux et fragile qui s’impose par sa volonté et cet entêtement qui sont ce que l’on appelle “la présence”. » Il y a plusieurs échanges d’une grande beauté, des phrases qui frappent et émeuvent : les moments où « Pau » et « Gé » (comme ils s’appellent) avouent avoir chacun « profité » de l’arrestation massive de la crise d’octobre et la scène de la mort de Godin sont particulièrement fortes. Repasser par l’histoire mythique de « la renarde et du mal-peigné » qui défraie à nouveau les manchettes depuis l’automne (les pièces Je ne te savais pas poète à l’Espace Libre et Je cherche une maison qui vous ressemble au Théâtre Denise-Pelletier, ou encore le film Pauline Julien, intime et politique), c’est poser un regard rétrospectif sur l’Histoire, non seulement sur les événements passés qui la composent, mais également sur notre manière de la construire, de la raconter, de la vivre au présent.

En contrepartie, les monologues de Québec apparaissent toujours plus plats. Dans l’idée de tisser des échos entre le passé et le présent, l’autrice réactive volontairement des lieux communs poétiques, à commencer par l’association Québec/femme, métaphore archi-commune dans la poésie québécoise militante des années 1960-1970 (notamment dans le groupe qui gravite autour de l’Hexagone, la maison cofondée par Gaston Miron et le groupe élargi auquel appartenait lui-même Gérald Godin). Le lyrisme de Québec surprend tout autant qu’il déconcerte : non pas qu’il soit absent de l’écriture de Lefebvre (le monologue final de J’accuse en était rempli), mais il est ici omniprésent. On ne sent pas, dans l’écriture, que l’autrice arrive à mener ces lieux communs plus loin que leur simple reconduction. L’intimité de Godin et Julien, qui auront fait ensemble « un peu de ski et beaucoup d’après-ski », l’emporte toujours sur celle de Québec – soit, inévitablement, une femme à la fin de la vingtaine qui se cherche, abandonne ses études dans la foulée de 2012 et assomme son désespoir à grand coup d’alcool Chez Baptiste, là où elle travaille
/01
/01
Là n’est pas le propos de la pièce, mais difficile de passer sous silence que cette allégorie sur le Québec contemporain est présentée par une équipe uniformément blanche, ce qui surprend encore…
.
Or, Maude Demers-Rivard est seule à défendre cette partition difficile, sans toujours réussir à s’approprier les mots pour leur donner la profondeur recherchée. Face à elle, les six autres interprètes se partagent les deux rôles du couple mythique – Myriam Fournier, Macha Limonchik et Zoé Tremblay-Bianco jouent « Pauline (mais pas que) » ; Charles-Aubey Houde, Benoit McGinnis et Sébastien Rajotte sont « Gérald (mais pas que) » –, idée moins intéressante que prévue, notamment parce que tous n’arrivent pas à garder le même niveau de jeu. La mise en scène de René Richard-Cyr aide également peu : la forêt de micros qui compose l’arrière-scène est évocatrice, mais l’écran massif au centre de la scène encombre l’espace plus qu’autre chose (d’autant plus qu’il sert finalement peu souvent pour afficher çà et là quelques extraits de Godin et Julien), rendant les transitions entre les temporalités peu fluides.
L’après
« Nous sommes arrivés à ce qui commence » : les mots de Gaston Miron avaient été abondamment cités durant la grève de 2012. Mais depuis, difficile de savoir ce qui a commencé. Sommes-nous passés à côté de la marche de l’Histoire ? Quels seront les contrecoups positifs de la répression de 2012 ? La proximité nous empêche-t-elle de voir que l’élection de Catherine Dorion, déjà adoubée « députée poète », sera aussi significative que celle de Godin ?
Ces questions, soulevées par Annick Lefebvre dans son texte, difficile d’y apporter une réponse. Le déchirement ressenti et exprimé par Québec au début de la pièce par rapport à l’élection de la CAQ en octobre 2018 – difficile de voir gouvernement plus éloigné des idéaux d’il y a sept ans – sera encore douloureux pour certains. En fin de parcours, ColoniséEs tente bien d’offrir une lueur d’espoir, voire une mise en garde contre la répétition des erreurs du passé (lire : se laisser abattre lorsqu’un vent de changement s’éteint), mais l’équivalence posée par les deux récits me semble au final plus désespérante que lumineuse. Peut-être est-ce simplement parce que je suis moi-même, d’un point de vue politique, encore « pas pire traumatis[é] du Printemps Érable » et de ses (non) suites.

crédits photos : Valérie Remise