Céline Huyghebaert, Le drap blanc, Édition à compte d’auteur/D’ébène et de blanc (design graphique), 2017, 275 p.
Lucile de Pesloüan, Les histoires de Shushanna Bikini London, Rodrigol, 2018, non paginé.
///
Avec Le drap blanc et Les histoires de Shushanna Bikini London, Céline Huyghebaert et Lucile de Pesloüan revisitent les territoires de l’intime
/01
/01
Les histoires regroupées dans l’ouvrage de Lucile de Pesloüan ont d’abord été publiées sous forme de fanzines. Pour un regard sur le projet, voir l’article d’Andrea C. Henter « Les petits cahiers de Shushanna Bikini London », http://magazine-spirale.com/article-dune-publication/les-petits-cahiers-de-shushanna-bikini-london.
. Elles font de l’objet livre un complice poétique, support d’un texte pluriel où les composantes verbales, visuelles et matérielles dialoguent entre elles et invitent le lecteur à faire corps avec l’écriture même. Les deux œuvres errent quelque part entre le récit autobiographique, le journal intime et l’essai sans toutefois se cantonner dans un genre en particulier, et c’est peut-être le propre de ce qu’on pourrait appeler le « livre d’artiste ». Ici, le support livre se transforme en boîte à souvenirs remplie d’objets littéraires, qui ont parfois leur vie propre : lettres, sondages, photos, courts récits, notes, nouvelles, autant de fragments qui s’offrent comme éléments d’une mythologie personnelle. Inspirées par le fanzine, les deux auteures investissent le livre comme espace d’expérimentation dans un contexte éditorial artisanal qui, en plus de rehausser le propos, embrouille la catégorie livresque. Et ça fonctionne merveilleusement bien.
« Tout ce qui reste de mon père est dispersé »
« Je m’appelle Mario. Mario Huyghebaert. Comme tout le monde. » Telle une épitaphe inscrite dans l’espace réservé à une photographie à la fin du Drap blanc, ces mots viennent parachever le portrait d’un père disparu esquissé par sa fille. Livre au parcours singulier à cheval entre les pratiques, émergeant dans un espace de création artistique précis, présenté comme œuvre littéraire et primé pour ses qualités visuelles et matérielles, Le drap blanc est né de la volonté de reconstituer l’histoire d’un père mort trop rapidement, alors que sa fille était en route pour le voir une dernière fois.

Projet complexe, délicat et exigeant, la recherche d’une identité paternelle à laquelle s’adonne Huyghebaert s’étale dans le temps et dans l’espace sous formes diverses. Une carte adressée au père, écrite par la fille, sur laquelle figure une représentation de L’homme au chapeau melon de Magritte (ceci n’est pas une pipe, ceci n’est pas, non plus, mon père…), suivie de photos de famille, de retranscriptions de dialogues entre les proches, d’une enquête sous forme de questionnaire adressé à des gens qui n’ont jamais connu l’homme, sont autant d’archives témoignant d’une vie qui échappe à l’auteure. Afin de pallier aux trous laissés dans l’histoire et de coller ensemble les bribes de souvenirs qui, petit à petit, construisent une figure paternelle, Huyghebaert emploie le ciment des mots :
Mon père disait « j’entends rien ». Et « saleté de téléphone ».
[…]
Parfois, je me raconte que je lui disais « j’entends rien moi non plus ».
Il maugréait « saleté de pays ».
Je répétais « saleté de pays » et puis « tu me manques, papa ».
Il disait « quoi? ».
Je répondais : « je t’aime papa ».
Et lui : « quoi? ».
[…]
« Je t’aime. Je te rappelle demain, papa. »
Et je faisais comme si ça coupait.
Mais je ne crois pas que ça se soit passé comme ça. Sauf la fin. « Je te rappelle demain. » Et j’ai pas rappelé.
Ainsi, les courts récits, peut-être fictifs, en dévoilant un rapport intime fantasmé (?) de la narratrice à son père (culpabilité, amour, rancune, etc.) viennent combler les vides laissés par les souvenirs épars. C’est alors qu’un portrait émerge : le noir des premières photographies s’estompe pour laisser apparaître la silhouette du père au fil du livre. Et sur le drap blanc, à la fois linceul et page vierge, un visage et des mots s’impriment comme les résidus toujours un peu flous d’une mémoire qui, « parfois, […] aimerait bien aussi oublier ».

« Tenez, regardez ce qu’il y a à l’intérieur. Vous n’avez même pas besoin de fouiller. »
Drôle d’invite que cette phrase placée au milieu de la page, d’autant plus qu’elle fait ironiquement face à l’ « Histoire numéro 10 », pourtant première histoire de l’ouvrage de Lucile de Pesloüan. Issu d’un projet de publication de fanzines, Les histoires de Shushanna Bikini London regroupe de courts textes, voire des scénettes, qui explorent le quotidien de personnages à la fois banals et marginaux. Entrecoupés de photographies et de collages, les textes traitent d’une déprime ordinaire : un homme attend un train en retard, une femme qui a coupé les ponts avec sa mère est enceinte, une collectionneuse de figurines de Woody Allen rencontre un groupe de soutien, deux immigrantes se séparent pour l’été, une correspondance entre deux femmes se termine sur une note triste, etc. L’exercice de style auquel s’adonne l’auteure lui permet d’explorer sous plusieurs angles une sorte de grammaire de la mélancolie urbaine. Tel un motif qui accentue l’expression d’un malaise, la figure de l’énumération se décline d’une histoire à l’autre :
Paula, 33 ans
Je ne comprends pas comment quelqu’un d’aussi peu intelligent puisse réussir aussi bien ce qu’il entreprend. J’ai regretté de m’être coupé les cheveux dès que j’ai vu ceux de Margot. Je maudis tous ceux qui se sont extasiés sur le livre que je viens de terminer, je n’y ai strictement rien compris. Je lorgne toujours sur l’assiette de mon voisin au restaurant. La dernière fois il a eu plus de frites. J’ai dénoncé mes voisins, ils se sont construit une terrasse illégale sur le toit. Je suis partie à Boston et je regrette de ne pas être partie à New York comme la personne au téléphone devant moi dans la file.
Un peu comme chez Huyghebaert, chaque histoire est prétexte à explorer une écriture multiple, qui emprunte à d’autres supports – la carte postale et le journal intime, par exemple –, qui joue sur des registres narratifs variés – l’emploi de la première ou de la troisième personne – ou encore qui propose des formes textuelles diverses – des listes, une suite de portraits, des lettres, des maximes. Ici aussi, la forme même du livre s’accorde avec l’intimité des personnages mise en scène dans les textes. Ainsi, les images légendées de villes, de portraits et d’objets disparates sont moins illustratives qu’expressives ; intercalées à travers les textes, elles sont des fragments d’intimités anonymes isolés en gros plans et offerts à la contemplation.
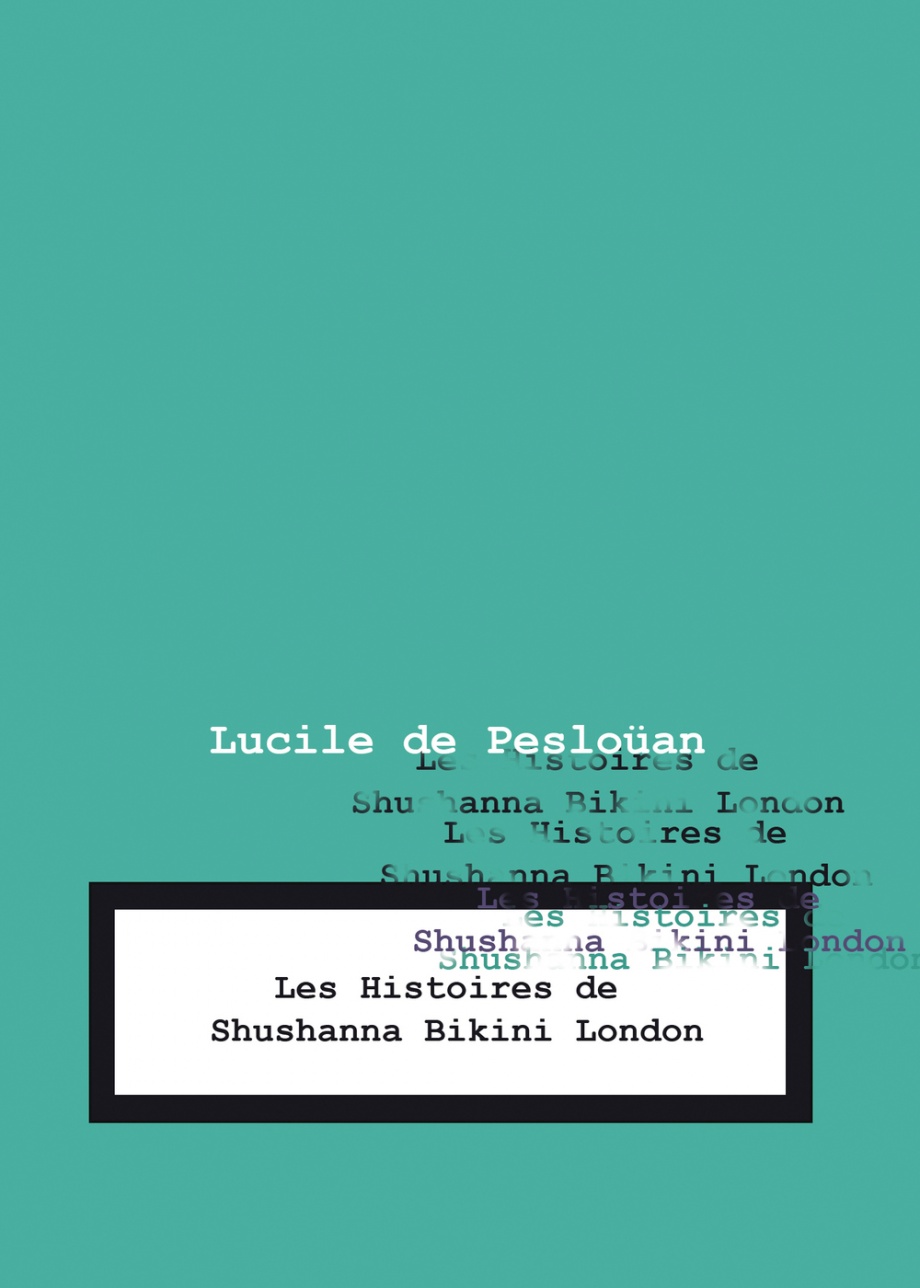
Autant chez de Pesloüan que chez Huyghebaert, la recherche de soi ou de l’autre à travers une écriture hétéroclite et personnelle, couplée à un travail éditorial artisanal, contribue à façonner une poétique de l’intime. Les sujets abordés, comme le deuil ou la solitude, servent de près l’expression d’une intériorité, amplifiée par le format des ouvrages et par leurs différentes composantes. Ainsi, aux fragments de vies éparpillés répondent des fragments de textes et d’images, des fragments d’archives, dont l’assemblage aléatoire s’appréhende sans mode d’emploi.





