Naomi Fontaine, Manikanetish. Petite Marguerite, Montréal, Mémoire d’encrier, 2017, 144 p.
///
Si le premier roman de Naomi Fontaine, Kuessipan, a connu un véritable succès lors de sa parution en 2011, Manikanetish, son deuxième roman, cimente le rôle de la jeune auteure comme figure de proue du mouvement littéraire autochtone actuel. Grâce à des éditeurs comme Mémoire d’encrier et les Éditions Hannenorak, une nouvelle génération d’auteurs comme Naomi Fontaine, Natasha Kanapé Fontaine et Louis-Karl Picard-Sioui vient ajouter sa voix à celle d’auteurs mieux connus comme Yves Sioui Durand ou encore Joséphine Bacon. C’est dire que nous assistons à un foisonnement artistique et littéraire autochtone dans l’espace francophone qui contribuera, nous espérons, à mettre en lumières des réalités peu et mal connues pour y déceler notre humanité commune.
L’incipit de Manikanetish, un extrait bilingue en langues innu et française d’An-Antane Kapesh, rappelle à la mémoire celles et ceux qui ont tracé le chemin de l’auteure. En 1975, Kapesh écrivait l’ouvrage Je suis une maudite sauvagesse, détaillant les rapports de pouvoir entre Innus et Blancs dans son territoire à partir d’une perspective qui ne pouvait qu’être décapante. Avec cet incipit, l’auteure choisit de s’inscrire expressément dans une tradition littéraire qui allie le vécu personnel au collectif et au politique, la vulnérabilité à la force de caractère et l’humour au drame du quotidien. An-Antane Kapesh décrivait le tiraillement que provoquait la traduction à l’écrit d’une tradition orale en affirmant : « Après avoir bien réfléchi et après avoir une fois pour toutes pris, moi une Indienne, la décision d’écrire, voici ce que j’ai compris : toute personne qui songe à accomplir quelque chose rencontrera des difficultés mais en dépit de cela, elle ne devra jamais se décourager. »
Cette phrase, en apparence toute simple, devient le fil conducteur du roman de Fontaine. Ce conseil de Kapesh porte sur l’écriture, mais Fontaine l’emploie également pour parler des défis de l’enseignement et, plus largement, de la persévérance qu’exige la (ré)intégration dans une petite communauté. Le récit de Yammie, le personnage principal, s’inspire du vécu de l’écrivaine qui a enseigné à Uashat, une communauté innu de la Côte-Nord près de Sept-Îles. La jeune enseignante dans la vingtaine, baccalauréat en main, fait le choix audacieux de quitter sa vie urbaine et son amoureux pour aller où le besoin d’enseignants promet un emploi stable pour une nouvelle diplômée.
C’est le chemin du retour des exilés, comme le décrit Fontaine, un parcours qui aura mené Yammie à suivre sa mère à sept ans et partir de Uashat pour aller vivre à Québec et se découvrir une « […] petite fille brune parmi tous ces visages blancs, ces yeux pâles, bleus ou verts, ces cheveux blonds ou frisés. Étrangère ». Être étrangère sur son propre territoire, être l’autre, prétendre être latina pour éviter les questions, avoir honte de devoir faire l’étalage d’un mets « traditionnel » avec sa classe au primaire sont autant de souvenirs qui créent en Yammie le sentiment de ne jamais s’être sentie complètement à sa place et la volonté de retourner dans sa communauté d’origine, aussi lointaine soit-elle.
Pleine d’une fébrilité naïve, Yammie se prépare à entreprendre ce retour de l’exilée et à donner des cours de français à des étudiants du cinquième secondaire dans une école appelée Manikanetish (Petite Marguerite). L’école doit son nom à une femme de Uashat, décédée quelques années avant le début des travaux il y a vingt ans : « La Petite Marguerite n’avait jamais porté d’enfant, ce qui ne l’a pas empêchée d’en élever des dizaines. Des enfants qui avaient perdu leurs parents, ceux qui avaient été donnés, trop nombreux à la maison, les enfants difficiles, ceux qui au lieu d’être placés sous la garde de l’État, ont trouvé refuge dans son nid. Petite, dans le corps d’une préadolescente. Du coup, infiniment grande. Le Créateur joue parfois à contredire sa créature. »
Yammie, une Petite Marguerite de sa génération, est une femme toute jeune sans enfant. Elle apprendra rapidement que son rôle ne se limite pas à l’enseignement formel et que l’université ne l’aura pas préparée à affronter les réalités de sa nouvelle école.

Petit à petit, Yammie se redécouvre une communauté; elle assiste au mariage d’une cousine et fait la rencontre d’un musicien avec qui elle pourra alléger sa solitude hivernale. Elle part une fin de semaine dans le bois avec des tantes et des oncles, découvrant le plaisir de prendre le train local qui parcourt le long chemin de l’intérieur des terres pour débarquer les familles sur leur territoire, qui ne sont jamais répertoriés sur les cartes. Yammie, avec ses années passées en ville, avait oublié le bien-être que peut apporter la pose des collets, la tire de perdrix à la carabine, les jeux de cartes, les histoires de familles racontées dans le chalet chauffé au poêle à bois et le plaisir de dormir tous ensemble sous un même toit.
Naomi Fointaine, avec une humilité teintée d’autodérision, décrit le contexte paradoxal d’une Innu venue enseigner la langue française dans une communauté qui est la sienne et qui a pourtant bien changé depuis son départ. Contrairement à son enfance, la solitude guette maintenant Yammie, tout comme les joies de réaliser qu’elle appartient tous les jours un peu plus à Uashat, notamment lorsqu’elle apprend qu’une de ses étudiantes est en fait sa cousine. Même si Yammie ne se rappelle pas leurs souvenirs communs, elle feint de ne pas être complètement perdue dans cette vie qui s’est poursuivie en parallèle, à huit heures de route, pendant une quinzaine d’années.
Dans une entrevue avec Julie Tremblay, Fontaine a expliqué que son roman se voulait un hommage à ses étudiant.e.s. En prenant soin de demander à ses anciens élèves la permission de relater leur expérience dans son roman tout en changeant leurs noms, l’auteure réussit à démontrer que ces jeunes ont une force de caractère incroyable, à la mesure des défis qui les entourent. La mort est omniprésente et le suicide frappe de plein fouet la classe de cinquième secondaire lorsque la sœur aînée d’une étudiante, une jeune mère, est retrouvée morte. Son élève terminera-t-elle son année scolaire? Doit-on la remplacer dans la pièce de théâtre étudiante? Aux questions de Yammie, ses étudiantes et ses étudiants lui répondent en cœur qu’il faut être patiente. Le deuil est collectif et Yammie apprend à partager sa propre vulnérabilité avec ses élèves en reconnaissant ne pas posséder de solutions toutes faites.
La ténacité des élèves comme Myriam est une qualité que tous partagent à leur façon, une détermination dont Yammie s’inspirera à son tour pour surmonter ses propres épreuves. Lors d’une visite de l’école secondaire au cégep de Sept-Îles, deux étudiantes du troisième secondaire sont éloquentes : « Sont poches eux autres qui sont racistes avec nous./Ouais, on devrait leur donner des amendes./Ouais! Genre cinq cents dollars chaque./Les deux filles se sont mises à rigoler./On serait riches. »
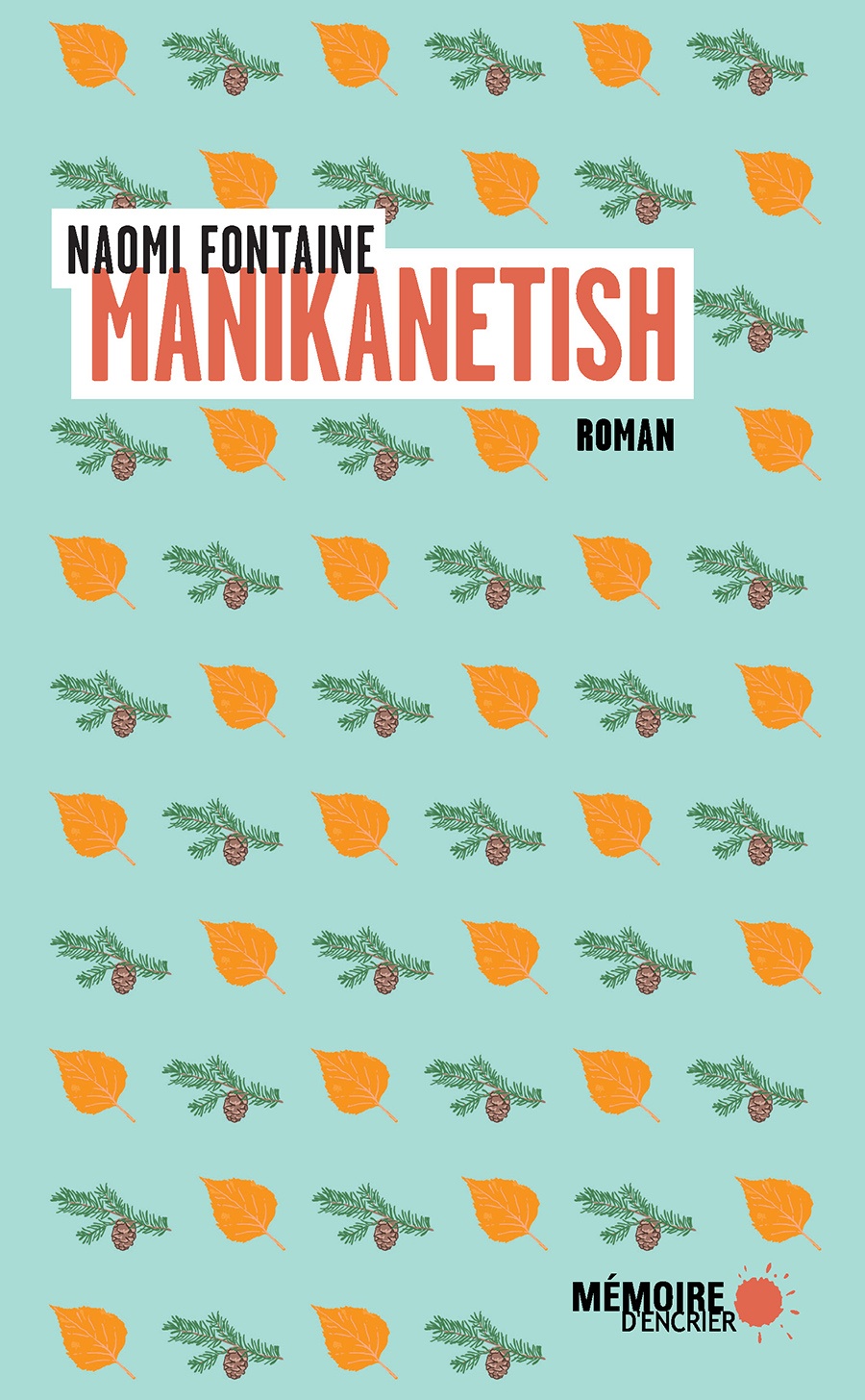
Au travers les drames, la mort et la solitude, l’auteure de Manikanetish révèle avec éloquence la résilience de ses élèves et de sa communauté. De la précision de sa prose découle un récit où les descriptions sans ambages, empreintes d’humanité et d’humilité, sont loin du misérabilisme ou de l’incompréhension avec lesquels est parfois traitée la vie sur les réserves. Le roman est un digne héritier de la tradition d’An Antane Kapesh; petit et beau comme une marguerite recélant une étonnante grandeur.





