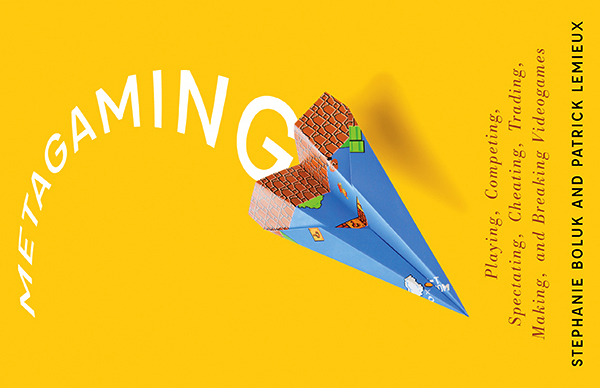Sous la nuit solitaire, mise en scène : Estelle Clareton et Olivier Kemeid ; chorégraphie : Estelle Clareton avec Larissa Corriveau, Renaud Lacelle-Bourdon, Esther Rousseau-Morin, Nicolas Patry, Ève Pressault, Éric Robidoux et Mark Eden-Towle ; assistance à la mise en scène et aux chorégraphies : Annie Gagnon; décor et costumes : Romain Fabre; lumière : Marc Parent; musique : Eric Forget; direction de production et régie : Catherine Comeau. Présenté par Trois Tristes Tigres et Créations Estelle Clareton en codiffusion avec le Théâtre de Quat’Sous (Montréal) du 15 novembre au 2 décembre.
///
« Toi qui entre ici abandonne toute espérance. » Si ces mots ornant le fronton des portes de l’Enfer dans la Divine comédie de Dante sont bien connus, l’avertissement semble n’avoir jamais vraiment réussi à dissuader ceux tentés d’y pénétrer. L’histoire de la représentation est ainsi ponctuée d’œuvres d’écrivains, d’artistes et de penseurs qui se sont confrontés au texte monumental du poète italien. Rien que ces derniers mois, on compte deux nouvelles traductions ambitieuses de la Divine comédie par Danièle Robert chez Actes Sud et René de Ceccatty en format poche chez Points, et plus proche de nous, la mise en corps et en scène des chants de l’Enfer dans une création d’Estelle Clareton et d’Olivier Kemeid, actuellement présentée au Théâtre de Quat’Sous : Sous la nuit solitaire.
Il aurait été facile de tomber dans le piège de la mimésis et de l’ornementation, d’autant plus que la chorégraphe et le metteur en scène reconnaissent d’emblée s’être inspiré des gravures de Gustave Doré illustrant les poèmes de Dante. Ici, nulle débauche visuelle ou sonore qui tourne en débâcle, car ce sont bien les corps qui occupent la scène et habitent le regard. Saluons donc le travail d’éclairage, efficace et tout en sobriété, qui plante des décors monochromes sans verser dans un symbolisme naïf. Même constat pour les musiques, caverneuses, électriques, déchaînées à certains moments, mais sans jamais recouvrir la mesure du spectacle. Alors que Dante avait son Virgile pour l’accompagner dans la traversée de la géhenne, le spectateur ne dispose pour seul guide que des vers du poète projetés sur le fond de la scène. Mais les mots ne font pas image, d’eux ne découlent pas forcément un enchaînement ou une scène qui en serait le prolongement chorégraphié. Ce sont des mots ouverts sur l’acte même de leur lecture, ouvrant le regard à ce que les corps découvrent et interprètent sur scène : leur désir, leur peur – c’est souvent une seule et même chose –, cette damnation qui est leur et qui, pourtant, tombe toujours comme condamnation depuis l’extérieur.
Le Diable au corps
En Enfer, comme il se devait, le mouvement est chaos et la désarticulation est son credo. Toutefois, sans le paratexte qui accompagne la pièce, devrait-on déchiffrer obligatoirement, dans les contorsions de ces corps erratiques, les tortures des martyrs éternels ou les sévices de leurs bourreaux démoniaques ? Bien sûr, les postures choisies ne peuvent manquer de faire penser aux exactions de la guerre, aux danses de Saint-Guy et aux supplices du feu de Saint Antoine, aux épileptiques, aux fous et aux cannibales. C’est ainsi tout un répertoire des corps en souffrance qui s’exhibe ici, mais aussi des corps des amants, autres fous irrécupérables soufflés, transis par la jouissance, en somme le spectacle vivant des chairs portées hors de leurs communes limites, jamais vaincues puisque se relevant toujours pour un nouvel assaut.
Aussi le spectacle répond à certaines attentes du genre infernal, entre les cris de femmes dignes des hystériques du Grand Siècle, les grognements d’un prédateur sexuel passant d’une proie à l’autre tel un Don Juan libéré de la loi et, enfin, la topique de la violence inscrite en creux de tout désir, lorsqu’une main referme ses doigts sur la gorge tantôt aimée, maintenant broyée. Tandis que ça jacule et gesticule à tout va, d’un pas de côté un interprète s’échappe du sabbat et devient à son tour spectateur. Évidemment, il faut se montrer attentif, car cet arrachement se joue loin de la furie des corps : une main sur la bouche pour exprimer l’horreur face à un coït mortifère, un regard sidéré, crispé, tordu par le dégoût alors que le corps s’abat doucement contre un mur. C’est sans doute quand nous sommes amenés à déplacer notre regard par la médiation de cet intrus que la proposition de Clareton et Kemeid renoue finement avec la geste de Dante. Alors le spectateur n’est plus aliéné à sa vision de l’Enfer mais en entreprend seulement le voyage, voyeur médusé mais pas entièrement captif de l’angoisse, régnant en tyran sur le royaume des fantasmes.

Crédit photos : Romain Fabre