Alain Deneault, De quoi Total est-elle la somme ? – Multinationales et perversion du droit, Montréal, Écosociété / Paris, Rue de l’échiquier, 2017, 436 pages.
Alain Deneault, Politiques de l’extrême centre, Montréal, Lux Éditeur, 2017, 100 pages.
///
C’est Saint-Augustin qui affirmait que l’espoir a deux filles de toute beauté : la colère et la bravoure. En lisant le plus récent livre du philosophe et essayiste Alain Deneault, De quoi Total est-elle la somme ?, on est tenté de le croire. Du moins, si l’on met l’accent sur le projet de l’auteur et non sur la société dont traite l’ouvrage. Dense, élaboré et factuel, De quoi Total est-elle la somme ? se révèle une étude du « cas-école » que représente de la multinationale Total, en tant qu’entreprise tentaculaire dont les malversations et les crimes sont perpétrés « en marge du droit » et en toute complicité avec les états où elle sévit.
Au cours d’un long entretien, Spirale a fait le point avec Alain Deneault sur les transformations historiques dont ce nouvel ordre témoigne. Cette rencontre autour des méfaits de la plus grande société de la francophonie a aussi été l’occasion de questionner Deneault au sujet de certains enjeux rhétoriques, politiques, universitaires et sociaux rapidement abordés dans l’opuscule Politiques de l’extrême centre, paru chez Lux, en 2016.
Les premières questions qui me sont venues en tête, en apprenant la publication de votre plus récent livre, ont été : « Dans quoi se lance-t-il ? » et « Quels arguments a-t-il présentés à ses éditeurs afin qu’ils acceptent de s’attaquer à ce Goliath ? ». Tout cela, évidemment, sachant que le livre Noir Canada, que vous avez fait publier
C’est un projet qui s’est fait en tandem, en ce qui concerne les éditeurs [Rue de l’échiquier, en France, et Écocociété, au Québec]. Et ce n’est pas la première fois qu’une telle collaboration a lieu, puisque Paradis sous terre [qui reprend la teneur de Noir Canada, avec une autre couverture] avait aussi été coédité par les mêmes éditeurs.
Je reviens sur cette idée que contrairement à une étiquette que l’on a voulu lui imposer, Noir Canada n’est pas un livre controversé. Ce sont les poursuites judiciaires dont il a fait l’objet qui sont controversées. C’est l’activité des sociétés minières canadiennes qui est controversée, et c’est le rôle du Canada, comme pays de référence de ces sociétés-là, qui est controversé. Nous avons rendu compte d’une controverse, et le mot est d’ailleurs faible, c’est un euphémisme !
Dire du messager qu’il doit porter les attributs des objets qu’il fait siens est abusif. Noir Canada n’avait pas à être la cible de reproches particuliers, ni dans la thématique, ni dans la méthode, ni dans le ton. Il s’inscrit dans une grande tradition de pensée en occident, qui est la pensée critique, et d’une certaine façon, le marxisme.
Je constate plutôt que Barrick-Gold, dans Noir Canada, eu égard à la question des poursuites judiciaires, était déjà citée, et que ses démarches judiciaires l’ont plongée dans la perspective d’une mise en abyme. Déjà dans le livre, nous critiquions la façon qu’avait la firme de poursuivre devant les tribunaux tous ceux qui la critiquaient. Et ils nous ont attaqués. À ma connaissance, depuis cette poursuite, la firme n’a pas récidivé envers d’autres acteurs, tandis que, pour ma part, j’ai continué à travailler comme auparavant.
Pour De quoi Total est-elle la somme ?, j’ai œuvré sur un mode documentaire qui me permet de faire la synthèse de propositions provenant de maintes disciplines qui ne relèvent pas de la somme des partis, mais bien d’une lecture qui met en perspective des enjeux, au-delà du discours propre à chaque discipline et à chaque source.
Parmi mes sources, il y a toute une documentation qui provient de Total, de ses historiens [Emmanuel Catta et Alain Beltran], de ses communiqués de presse. En cela, les historiens de Total finissent par faire partie eux-mêmes de l’histoire. Leurs textes datent suffisamment pour témoigner de l’esprit d’un temps qui n’est plus celui d’aujourd’hui. Par exemple quand Emmanuel Catta nous dit que c’était super en 1990, parce que Total pouvait éviter l’impôt sur le revenu, en France, en allant aux Bermudes… Il s’agit de quelque chose que l’on ne dirait pas aujourd’hui. Il y a aussi les entrevues que les présidents accordent aux médias. On pourrait également parler des commandites, des sites web que financent la firme comme Planète Énergies et divers experts qui parlent en son nom, les professeurs qui proviennent de facultés financées par Total, les journalistes financés par Total, et bien d’autres acteurs sociaux.
Ma position consiste à dire que mon travail n’est pas à charge, au sens d’une offensive que je lancerais, avec mes tire-pois et mon équipe de bénévoles contre une multinationale multimilliardaire. Ce serait ridicule. Au contraire, je me situe comme quelqu’un qui écoute Total. Cette firme est bavarde, elle parle énormément. Mon travail a été de l’écouter et de porter attention à ses constantes idéologiques, de manière à les mettre en perspective et à les traiter de manière critique.
Et les trois constantes de son discours sont : 1) Ce que nous faisons est légal, 2) Le passé appartient au passé, il n’est pas pertinent de se tourner vers lui pour penser le présent, et 3) Total ne fait pas de politique.

D’où vous est venue l’idée de vous attaquer à Total ?
Je m’attaque moins à Total en réalité que j’essaie d’en comprendre le discours. La firme est très présente, en Europe du moins, sur la scène publique, et ses très nombreuses prises de position me semblaient mériter un traitement critique.
Aussi, ce livre semblait tout simplement manquer. C’est le moteur premier derrière les essais que j’ai écrits. Parfois, je ne me sens pas nécessairement le mieux outillé au départ pour combler ce manque, mais je m’en sens la capacité et l’envie. Et je me donne les moyens, je pense, d’arriver à un certain résultat, afin qu’on remédie à ce manque.
Après coup, j’ai découvert qu’il y avait sept ou huit livres sur la firme, mais ils sont pour la plupart des fascicules, des textes d’humeur parfois, très militants, avec peu d’éléments relevant comme tels des sciences humaines ou de la philosophie politique. Ces écrits restent souvent légitimes et indéniablement pertinents, mais on n’en est pas à faire une synthèse sur ce que signifient les cas qui posent problème en lien avec l’activité de la firme. Cela ne me donnait pas l’impression d’aboutir à un traitement qui relève de la pensée critique, à savoir qu’elle allie le besoin de changement à la théorie.
En tant qu’intellectuel, comment Total et les paradis fiscaux sont-ils devenus votre principal cheval de bataille ? Je pose la question, puisqu’il s’agit de sujets que le libéralisme et l’air du temps ne nous encouragent guère à contester dorénavant.
Certains enjeux conceptuels majeurs se posent. Pourquoi travailler sur les instituts financiers, la grande industrie et les ministères clés des exécutifs politiques ? Parce que la mise en relief de ces trois pôles permet de suivre l’évolution de l’oligarchie. L’ordre actuel de la domination, la structuration contemporaine des pouvoirs qui se démultiplient et qui se privatisent, nous force à revoir nos catégories politiques.
Si l’on se réfère aux textes traditionnels de la pensée politique, disons de Machiavel jusqu’à Carl Schmidt, en passant par Spinoza, Rousseau, Humes, Hobbes, on constate ne pas être outillé pour penser un phénomène comme celui des paradis fiscaux, lesquels constituent un régime d’État d’une nature spécifique.
Pour aborder le phénomène, il m’a moins intéressé d’utiliser le vocabulaire traditionnel de la pensée politique, strictement de manière heuristique, que de mettre à rude épreuve ce patrimoine intellectuel là, quant aux transformations historiques dont ce nouvel ordre témoigne. Les paradis fiscaux et les législations de complaisance représentent un problème si grave qu’ils affectent jusqu’à la sémantique des termes qu’on utilise pour traiter de la vie publique. Donc, c’est moins les paradis fiscaux qui m’intéressent, à partir de ce vocabulaire-là, que la façon dont les paradis fiscaux nous forcent à modifier nos concepts : qu’est-ce qu’une loi, qu’est-ce que l’état, qu’est-ce que la souveraineté, qu’est-ce que le crime, qu’est-ce que le droit, qu’est-ce qu’une frontière, qu’est-ce qu’un pouvoir ? Ces réalités changent complètement à partir du moment où les composantes historiques évoluent et nous contraignent à cette mise à jour conceptuelle. C’est là où l’apport de Georg Simmel est essentiel. C’est peut-être l’auteur que je cite le moins, mais qui compte le plus dans cette démarche [NDLR : la thèse doctorale d’Alain Deneault, rédigée sous la direction de Jacques Rancière, portait sur la notion d’économie au vu de la philosophie de l’argent de Simmel]. Cet auteur-là se trouve plus à inviter à penser sur ce mode dynamique et empirico-théorique, qu’à délivrer un fond théorique qu’il faudrait strictement analyser et reproduire.
En définitive, il est moins étonnant qu’on s’intéresse aux banques, au capital, à la façon dont les États évoluent, voire s’écroulent, et donc à l’apparition de nouveaux pouvoirs, que de constater le faible nombre de professeurs et de chercheurs qui placent ces questions au centre de leurs questionnements dans les universités.
Évidemment, ce phénomène s’explique par la médiocratie ; il s’explique du fait que, de manière « infraconsciente », comme disait Pierre Bourdieu, il devient difficile de travailler d’une manière critique sur Paul Desmarais, par exemple, lorsqu’on évolue dans un pavillon qui porte son nom.
Il est plus intéressant, pour comprendre l’université, de ne s’arrêter non pas sur ce que font les chercheurs, mais bien sur ce qu’ils ne font pas et ce dont ils ne parlent pas.
Continuellement, lorsque vient le temps de demander une subvention, de monter un cours ou un de préparer un colloque, les voilà sous la pression de pairs qui sont eux-mêmes sous la pression d’autres pairs, qui sont sous la pression à leur tour de pairs… plus personne ne pensant par lui-même, parce que tout le monde pense en fonction de ce qu’on va penser de ce qu’ils pensent. Dans cette espèce de tourbillon où l’on se mord la queue, l’enjeu consiste toujours à se censurer, à dire : « Bon, cet auteur-là n’a plus tellement la cote à la bourse des valeurs « réputationnelles », mettons-le de côté au profit de cela qui marche…
Dans votre autre livre récent, le très court Politiques de l’extrême centre, vous faites la critique de certaines revendications extrêmement pointues, qui peuvent souvent être adoptées par un camp ou un autre. Ce sont les sujets sensibles qui divisent : si vous êtes conservateur, ce sera le droit de porter des armes, si vous êtes « liberal », vous privilégierez les droits des minorités sexuelles, par exemple. C’est quelque chose dont Chris Hedges parle d’ailleurs dans L’âge des démagogues (Lux, 2016). Vous semblez donc vous attaquer à une machine qui ne trouve pas de contre-pouvoir, contrairement aux partis politiques. Qu’est-ce qui peut s’opposer à une multinationale ? Où vous situez-vous par rapport au libéralisme ? Est-ce que le libéralisme est simplement une face présentable, un décalque du capitalisme ? Est-ce un outil par le truchement duquel on peut faire passer n’importe quoi ?
Le libéralisme consiste en différentes façons de penser l’organisation sociale à partir du postulat de la liberté. Pourtant, c’est bien davantage en fonction des contraintes publiques que les membres d’une collectivité s’administrent sciemment eux même, et c’est à ces contraintes qu’on identifie les conditions de possibilité de la liberté. La question de la liberté se pose surtout quant au statut qu’on a au moment de délibérer collectivement sur les contraintes qu’une collectivité veut s’imposer à elle-même pour organiser la vie en société. Dans Politiques de l’extrême centre, j’ai voulu marquer le fait qu’en Amérique du Nord, le spectre gauche-droite est subordonné à un fantasme de « liberté ». Sur son axe gauche-droite, on passe désormais de libertaire à « liberal » à l’américaine, puis au libéralisme à la française, ensuite à ultralibéralisme et au courant libertarien, etc. Le fantasme de la « liberté » nous positionne de manière négative quant à la question des contraintes sociales. On manque alors le coche, parce qu’on relègue hors champ ce qui paramètre et conditionne la liberté.
Mais dès lors qu’on ne pense pas en de tels termes, cette idée vague de liberté en tant qu’idéal pour lequel on lutte, en vue qu’elle n’empiète pas sur la liberté des autres, ne mène nulle part ; l’intérêt reste de réfléchir l’ensemble du contexte social dans lequel ce principe-là s’applique.
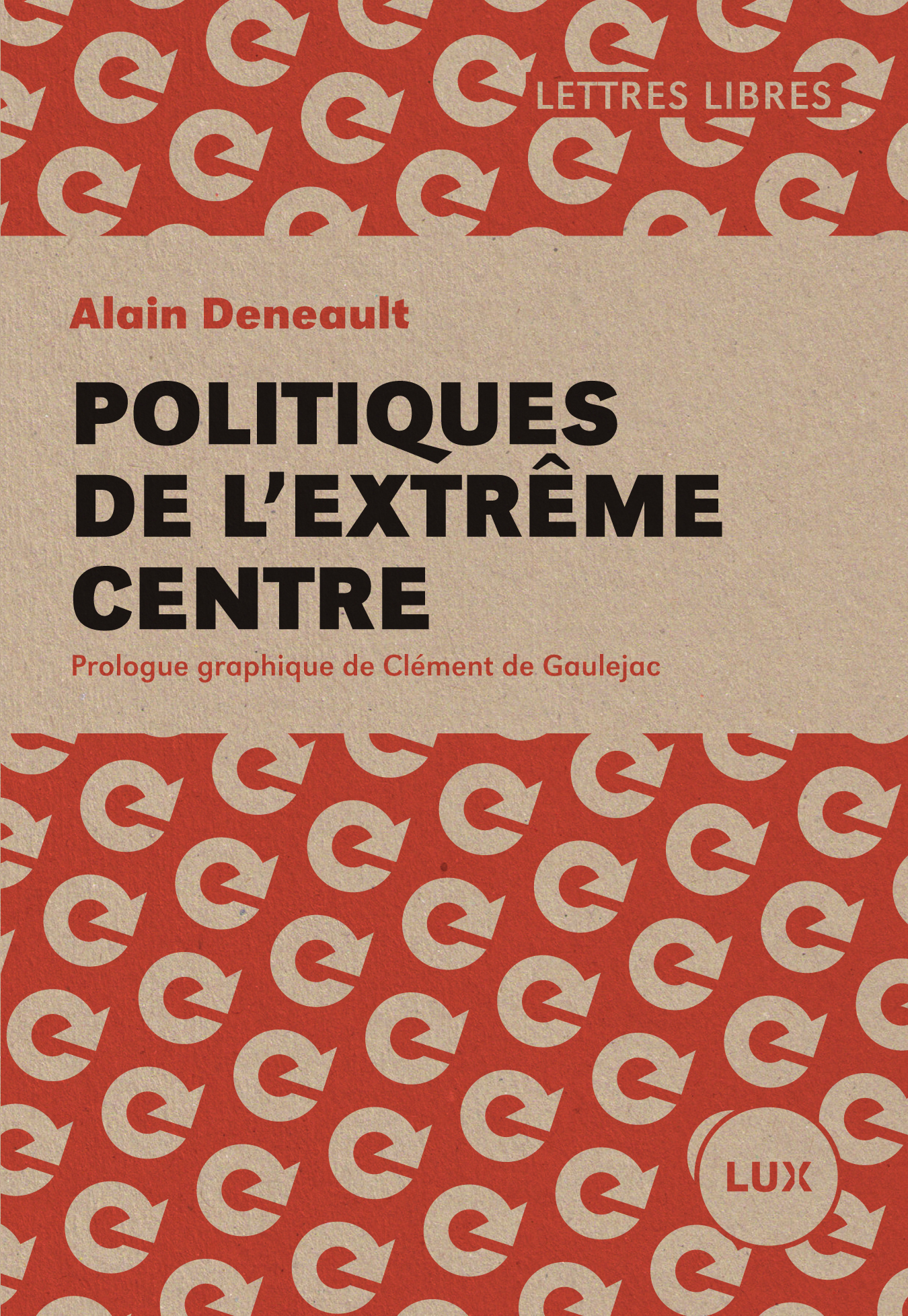
Si l’on parle de ce contexte, et des gens qui sont étouffés par la servitude et la médiocratie quotidienne ; cette spirale régressive qui fait que vous vous levez le matin et que vous détestez votre emploi (si vous avez la chance d’en avoir un), votre inéluctable routine aliénante et votre position précaire… j’ai l’impression que c’est un peu un clou sur lequel on ne tape pas assez. Alors qu’on va souvent verser, sur les réseaux sociaux, dans un sensationnalisme drapé de progressisme, tout un plat de sujets moraux se voulant « choc » qui vont nous mener à élever, par exemple, des histoires anecdotiques d’accès à des toilettes non-genrées dans un casse-croûte mal fichu, à un niveau qui dépasse l’enjeu fondamental de la reconnaissance et du respect des droits des minorités.
Le problème, à mon sens, est qu’on confond morale, gestion et politique. Le problème ne porte évidemment pas sur le fait qu’on cultive une réflexion morale ou que l’on ait à cœur la bonne gestion d’organisation. Cela est nécessaire, voire indispensable. Il faut vraiment avoir mal compris Nietzsche pour penser que la morale est une vieillerie du passé, ou méconnaître la critique de la « gouvernance » pour penser que savoir gérer est superfétatoire. Une société incompétente, cynique et immorale est une société bien sûr perdue. La morale et la rigueur institutionnelle restent, en ce qui concerne leurs enjeux respectifs, nécessaires et consistent en un certain nombre de règles comportementales, en ce qui concerne le rapport à autrui, le consentement, la reconnaissance, la justesse, le sérieux…
La politique ne relève toutefois pas tout à fait du même ordre d’enjeu. Elle consiste en la traduction de principes généraux pour organiser la vie sociale sur un plan beaucoup plus général, sur le plan de tout ce qui nous est commun (pour autant qu’on soit capable de se rappeler qu’aucun courant politique ne dispose en propre de ce qui est commun, surtout pas l’extrême droite !). La morale et les enjeux de gestion font partie des problèmes qui se posent à ce stade, sans toutefois y être exclusifs.
Cette perte de sens de la politique amène bien des courants contestataires à épouser des causes morales circonscrites et circonstanciées au titre de combats politiques généraux, de même qu’à des acteurs de pouvoir qu’à ne plus cultiver comme problème que la façon dont l’ordre capitaliste doit être administré. Les enjeux politiques qui transcendent nécessairement ces deux champs de préoccupation s’en trouvent hélas délaissés. Des psychopathes prennent le pouvoir en perdant de vue le fait qu’un budget d’État est la médiation de la souffrance d’autrui, et que lorsqu’ils jouent avec les chiffres, ils font éventuellement crier les gens de douleur.
Lorsqu’on est face à des psychopathes qui perdent de vue cela, et qui se lancent dans ce qu’on appelle « l’austérité », alors qu’il s’agit de bien d’autres choses, comme de pillage et de spoliation du bien public et le détournement, voire la privatisation des institutions publiques, eh bien dans ce contexte-là, les discours sur la troisième porte de la salle de bain dans l’école primaire ou sur le fait d’ajouter ou pas des –trice et –teur dans telle ou telle appellation officielle ne pèsent plus lourd s’ils constituent le principal objet de mobilisation publique. Il ne s’agit pas de réfuter la pertinence de tels questionnements et revendications, que d’en appeler à une juste qualification en termes d’importance et de statuts.
La politique consiste à délibérer sur un ensemble de principes qui gouvernent la vie en société. Alors que la morale a plutôt trait sur un mode appliqué au comportement et aux règles qui découlent de tels principes.
Gardant cela en tête, forcément, si l’on pense en termes de principes, on considèrera d’emblée Bernie Sanders, par exemple, comme un très grand féministe, même s’il ne parle presque jamais nommément des femmes. On le considèrera comme un très grand défenseur des Noirs, même s’il ne les évoque presque pas. Pourquoi ? Parce qu’il milite pour l’accès à l’éducation, à des soins de santé universels, et milite de fait en cela à l’intégration des groupes sociaux stigmatisés à ces sphères sociales. Il me semble plus pertinent de mener le combat politique sur le plan de cette synthèse que sur le mode « anarchoramifié » qui consiste à plaider pour la petite différence.
La convergence idéologique est fichue si l’on se met uniquement à délibérer sur ce mode, non ?
Oui, et malheureusement, on n’a plus le choix de parler, de se situer dans la rhétorique de subjectivités absolument censurées dans certains milieux et par ailleurs tout à fait tapageuses dans d’autres. Ce n’est pas mon enjeu de prédilection, mais force est d’en parler parce qu’on ne sait plus intégrer les causes dans un discours commun. On constate une absence d’appétit et de désir pour une notion qui était jadis très importante à gauche : celle de la synthèse. (Quelque chose que quelqu’un comme François Hollande, en France, a rendu caricatural et a galvaudé.) La synthèse consistait précisément à faire en sorte qu’on soit porté par ce qui nous grandit, à travers une conjonction de luttes et de constructions politiques, pour nous amener à concourir à quelque chose de plus grand que soi.
Ce quelque chose de plus grand que soi rencontre-t-il un problème lorsqu’il y a impossibilité de faire face à l’altérité et de se « sortir de soi » ?
Déjà, on constate qu’au nom de cette ramification des subjectivités toujours plus fines, qui s’expliquent tout à fait historiquement et qui ont en maintes circonstances une raison d’être, se développe toutefois la propension à conférer du sens à ce qui relève de l’infinie différence, plutôt qu’à l’appartenance commune. Cette attitude tantôt courageuse et audacieuse connaît tantôt le versant négatif de la paresse intellectuelle. Penser en termes de déterminisme culturel et social, disons, permet de penser à peu de frais. On se sent tout de suite doté de clés magiques pour analyser la marche du monde : parce qu’on est de tel ou tel milieu, voilà qu’on serait nécessairement disposé à tel ou tel comportement… Et à partir de là, on peut postuler un grand nombre de considérations mécaniques en faisant l’économie de l’histoire, de la géographie, de la politique, du droit, de la sociologie et de la philosophie dans ce que ces disciplines suggèrent de complexes.
Par exemple, on peut très bien, à partir d’un outillage élémentaire, travestir des prémisses incontestablement pertinentes et absolument fondamentales (lutte des femmes, des étrangers, des paysans), et ainsi tomber dans une sorte de fixation qui consiste à se croire doté d’un pouvoir heuristique implacable et absolu.
Lorsqu’on le manie exclusivement, cela nous rend paresseux et myope. À partir de ces seuls critères, on en vient à considérer, par exemple, que Jacques Parizeau, Gilles Gagné et Richard Martineau sont indistincts dès lors qu’on les enferme dans d’énormes catégories : vieux – hommes – blancs ‒ bourgeois ‒ occidentaux… Il s’agit d’une discrimination négative. C’est-à-dire qu’on prend les anciennes catégories utilisées par la domination et on se contente de les inverser comme un gant.


