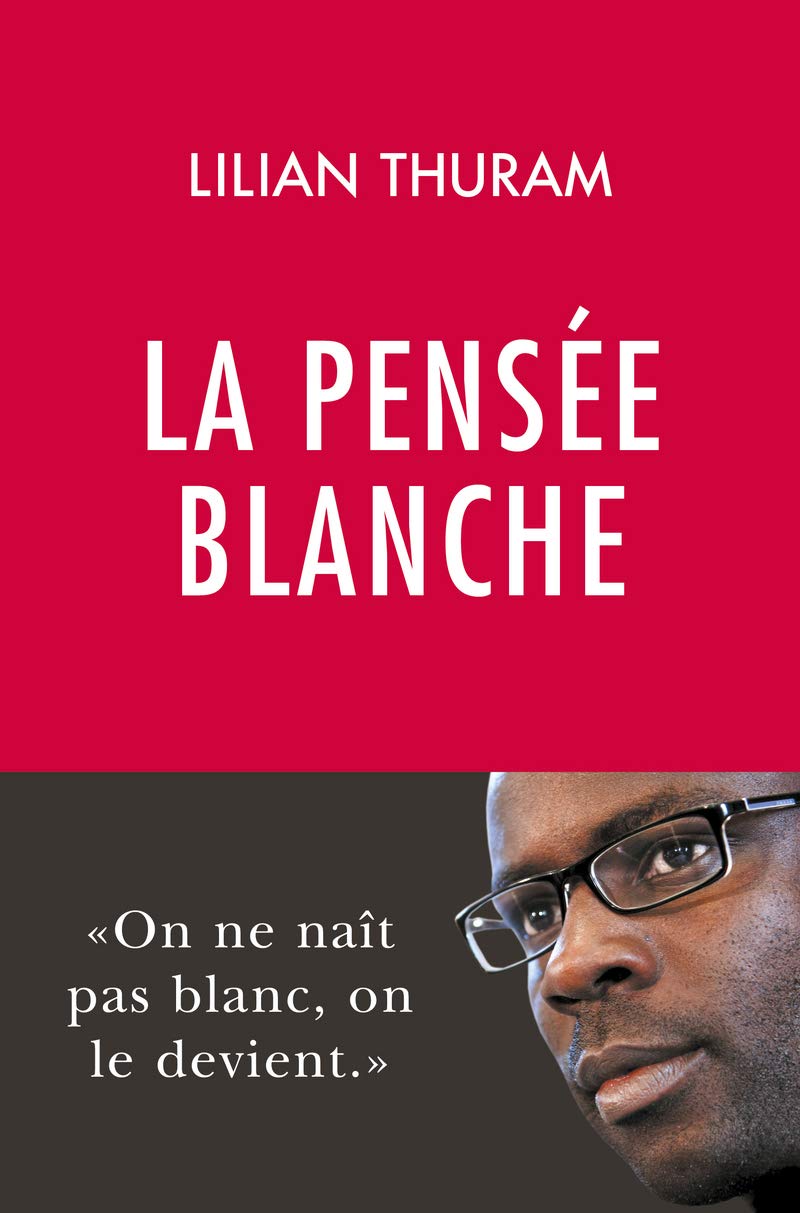La pensée blanche, Lilian Thuram, Montréal, Mémoire d’encrier, 2020, 320 p.
///
Du temps où Lilian Thuram portait le maillot de la Juventus de Turin, des foules en liesse massées dans les gradins l’accueillaient avec des cris de singe. C’est peut-être davantage les couleurs de la partisannerie que celle de la peau qui motivaient alors le geste. N’empêche que ces piaillements réveillaient le vieux fond de racisme occidental suivant lequel, sur la ligne de l’évolution, le Noir serait resté coincé quelque part entre l’anthropoïde et l’homme civilisé. Une idée qui lui réservait d’ailleurs une place de choix parmi les spécimens des zoos humains de l’époque coloniale.
Près de 15 ans après ces incidents récurrents qu’aucun arbitre n’a jamais cru bon de condamner, l’ex-footballeur signe La pensée blanche, un essai au carrefour des Whiteness studies et de la Critical Race Theory. L’ambiguïté du titre a immédiatement piqué les épidermes les plus sensibles. Certains y ont décelé – Pascal Bruckner, notamment – les signes de l’essentialisation clivante d’une pensée, la pensée des Blancs. Son auteur se défend pourtant d’avoir entretenu de pareilles ambitions. Le titre fait moins référence, selon ses dires, à la racisation d’une pensée qu’à une pensée de la racisation, à cette construction progressive de la blanchité de l’être occidental qui l’installerait de facto au pinacle de l’humanité. La distinction, cependant, n’est pas toujours évidente.
« Ce livre », précise Thuram d’entrée de jeu, « a pour but de mettre en lumière des pans entiers de l’histoire négligés, voire ignorés, qui ont pourtant construit l’identité blanche. Il n’est pas destiné à condamner le racisme en des termes généraux. Il ne désignera pas le racisme là où on l’attend, dans les manifestations outrancières de quelques partis extrémistes, mais dans l’ordinaire de nos sociétés ». Autrement posée, la question qui retient l’ancienne étoile du ballon rond pourrait se résumer ainsi : d’où vient, fondamentalement, qu’on lance des hurlements de singe à des joueurs de football noirs ?
L’origine d’un cri
D’aussi loin que l’histoire permet d’éclairer, des dissemblances instrumentalisent la division et la hiérarchisation des relations sociales. Pendant l’Antiquité par exemple, si Aristote nie la moindre différence entre Noir et Blanc, il considère tout à fait naturelle l’existence d’hommes libres d’un côté, et d’esclaves de l’autre. La démocratie athénienne était d’ailleurs exclusivement réservée aux hommes, laissant impérieusement aux subalternes – femmes et esclaves – le soin d’entretenir les coulisses de la citoyenneté.
La race, telle qu’on l’entend aujourd’hui, a ceci de particulier qu’elle se forge des appuis scientifiques durant le siècle des Lumières. Carl von Linné et Edward Tyson remarquent au milieu du XVIIIe siècle des similitudes entre les hommes et les primates. Buffon, à la même époque, établit plusieurs ressemblances entre les singes anthropomorphes et les Hottentots d’Afrique du Sud. Postulant un lien causal entre la grosseur du crâne et l’intelligence effective des sujets, les adeptes du déterminisme cérébral causeront des dommages irréversibles en interprétant ces différences à l’aune du darwinisme naissant. Médecin anthropologue, Paul Broca constate : « Ainsi, l’oblique et la saillie de la face [la forme du crâne] […] la couleur plus ou moins noire de la peau, l’état laineux de la chevelure et l’infériorité intellectuelle et sociale sont fréquemment associés, tandis qu’une peau plus ou moins blanche, une chevelure lisse […] sont l’apanage le plus ordinaire des peuples les plus élevés de la série humaine ».
Les recherches anthropométriques ne feront jamais que conclure au même constat, celui de la supériorité blanche, inscrite à même le biais d’ethnocentrisme qui sape dans ses fondements la méthode employée. Quoi qu’il en soit, les lumières de la race peuvent désormais remplacer le flambeau de la religion pour motiver l’entreprise de civilisation coloniale. Elles entraînent encore aujourd’hui, nous dira Thuram, des privilèges à ce point normalisés qu’ils restent invisibles aux yeux de la majorité. Entendre : la majorité blanche.
Les masques
Ces quelques faits, auxquels on peut ajouter l’adoption du Code noir de Jean-Baptiste Colbert, jalonnent l’histoire de la légitimation de la supériorité blanche. Une supériorité qui va de pair avec l’acceptation, de la part des Noirs, de leur infériorité. En effet, les Blancs autant que les Noirs intériorisent ces normes et adoptent le masque qui leur échoit, lequel masque impose son lot d’assignations sociales. Thuram rappelle à ce propos une expérience menée dans les années 1940, consistant à présenter deux poupées, l’une noire, l’autre blanche, à des enfants âgés entre 3 et 7 ans et d’ensuite leur poser des questions. Laquelle est la plus gentille ? La plus belle ? Presque invariablement, tout ce qui apparaît comme le meilleur, le plus beau et le plus convenable aux yeux des enfants, noirs comme blancs, se rattache à la poupée blanche.
Cette expérience de Kenneth et Mamie Clark est une évocation saisissante de la force des préjugés et perceptions raciales qui ont cours dans les sociétés occidentales. Afin de démontrer l’ancrage des comportements racistes dans la réalité quotidienne, l’ex-champion de la Coupe du monde 1998 nourrit d’ailleurs sa réflexion d’événements personnels pour mieux dévoiler les ramifications du racisme ordinaire. Le racisme systémique, quant à lui, est plus diffus, « il avance masqué », comme le dit Reni Eddo-Lodge que cite l’auteur, « [i]l nous glisse entre les mains comme un serpent d’eau dans celles d’un enfant ».
Thuram saisit pourtant l’hydre à bras le corps. Il nous expose quelques-uns de ses visages. Dans les espaces parisiens, en 2007, un Noir a entre 3,3 et 11,5 fois plus de risques d’être contrôlé par la police qu’un Blanc ; en France, les copies d’étudiants racisés sont systématiquement sous-notées par leurs enseignants et seul l’anonymat leur garantit l’équité : en Grande-Bretagne, des individus d’origine afro-caribéenne sont internés beaucoup plus rapidement qu’un Blanc dans un institut psychiatrique, où ils recevront plus promptement des doses plus importantes d’antipsychotiques.
Glissements
Les deux premières parties de La pensée blanche sont richement documentées. De ses manifestations embryonnaires aux persistances contemporaines, le racisme y est décrit dans son fonctionnement, ses motivations et ses effets. Les exemples sont nombreux et l’exposé critique de Thuram se développe rondement. En revanche, la fin de la troisième et dernière partie, « Devenir humain », est plus brouillonne. Après des débuts où il met fort justement en valeur, sur le modèle de son précédent Mes étoiles noires (2009), des personnes ayant lutté contre le racisme, l’essayiste glisse lentement d’une pensée blanche, raciale, à une pensée racisée, la pensée des Blancs. Ainsi, quand il s’interroge de manière rhétorique : « L’Anthropocène dont on parle n’est-il pas un anthropocène blanc ? », il effectue un important saut de l’une vers l’autre. Certes, le dénominatif « anthropocène » est critiquable en ce qu’il collectivise la responsabilité de dérèglements auxquels une poignée d’humains ou de corporations ont principalement contribué. Des auteurs ont d’ailleurs suggéré d’utiliser « capitalocène » ou « corporatocène ». L’anthropocène blanc, par contre, pèche par une même généralité trompeuse pour laquelle il faudrait minimalement avancer quelques explications.
Le flou vient d’une substitution entre de fausses équivalences, notamment entre pensée raciale et capitalisme. Quand Thuram déplore que « [l]a pensée blanche a trop tendance à nier ses responsabilités dans le processus de dérèglement climatique, dans la destruction de la biodiversité, dans les violences, dans les déplacements de populations et les épidémies qu’elle engendre », il confond ainsi les causes – l’exploitation capitaliste – avec l’inégale répartition des effets de cette exploitation sur les « races ». Du réchauffement climatique au capitalisme sauvage en passant par le spécisme, ce ne peut donc être que la pensée des Blancs qui est, au fil des dernières pages, déclarée responsable de plusieurs maux contemporains. Et ces doléances, dénuées de nuances, n’évitent pas toujours le piège du prêchi-prêcha.
Malgré ce léger dérapage de fin de course, le propos de l’essai demeure, entier et pertinent. La race est un masque qui empêche de voir la réalité. Qui empêche de respirer. Les personnes noires, en premier lieu, mais les blanches aussi : « on ne peut pas être libre si les autres ne le sont pas », déclarait en ce sens Denis Goldberg, un militant anti-apartheid, au journal La Croix. La race est un masque asphyxiant (George Floyd en est mort, et combien d’autres avant lui). Thuram s’en souvient, qui invite à les laisser tomber dans un essai d’une nécessité absolue, pour redécouvrir la part d’humanité commune qui illuminerait alors le visage nu de chacun