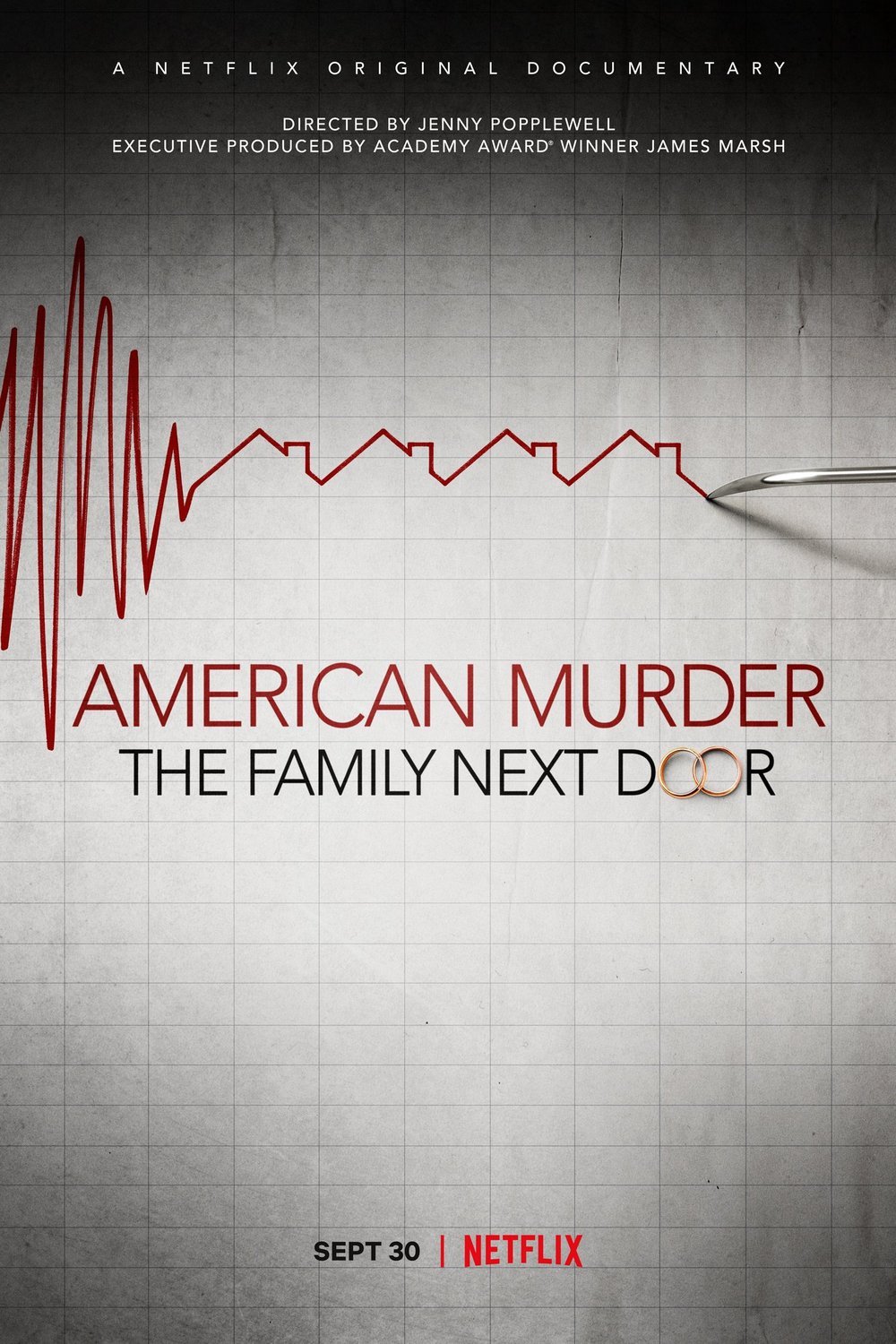« Comprise simplement, une pédagogie de la vulnérabilité implique de prendre des risques de se dévoiler, de changer, de ne pas savoir, d’échouer – pour approfondir nos apprentissages. /01 /01
Edward J. Brantmeier, « Pedagogy of Vulnerability: Definitions, Assumptions, and Applications », dans Re-Envisioning Higher Education: Embodied Pathways to Wisdom and Social Transformation »
Les nombreuses années qui s’empilent et que nous accumulons dans l’institution, en tant qu’étudiant·e·s au doctorat en littérature comparée, nous aurons vu remettre en question la traditionnelle dyade « maître-élève ». Que ce soit par ironie cynique, réflexion critique ou désespoir, nous avons cherché – et cherchons encore – à nous jouer des rapports de force qu’implique ce binarisme qui présuppose une transmission verticale du savoir dans laquelle notre rôle se résume souvent à celui de réceptacle. Cela dit, la dernière et la présente année nous ont donné la chance de vêtir pour la toute première fois l’habit de chargé·e de cours : il nous a alors fallu apprendre à négocier, de l’autre côté, les implications d’une posture que nous avons critiquée et connue. Conscient·e·s de ce que nous pouvions désormais prolonger comme dynamiques de pouvoir et que nous désirions altérer ces dernières, nous avons voulu penser la salle de cours et y instaurer une atmosphère de sorte qu’elle puisse devenir un chez soi pour tous·tes, même si l’apprentissage et l’itinéraire du cours étaient guidés par nous.
La position double d’étudiant·e-enseignant·e ainsi que la proximité d’âge et de situation dans laquelle nous sommes avec nos étudiant·e·s nous ont permis de développer et de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques qui prennent en compte la diversité et la composition nécessairement complexes d’une salle de cours, tout en bouleversant les rôles dans celle-ci. La séance devenait prétexte à la discussion vulnérable, où les sensibilités se partagent et se lient au gré des voix et des silences qui se font entendre. En atténuant une structure qui fait machinalement de la perspective professorale, du moins pendant l’instant que dure la séance, la perspective dominante, la chorégraphie maîtrisée du cours magistral est perturbée par des éboulements qui remettent en cause les rôles, et les liens qui se tissent au sein de la salle de cours.
Évidemment, les errements et les itinéraires, les déroutes et les bons coups qui ponctuent nos parcours de chargé·e·s de cours en littérature s’apparentent autant qu’ils se distinguent. Nos discussions sur le sujet ont permis de rendre visible une préoccupation similaire entre nos approches, soit l’inclusion, dans le corpus du cours, de « textes difficiles ». Cette appellation, aussi vague qu’elle soit, nous paraît rendre compte, dans le contexte du parcours universitaire en lettres, de ces œuvres qui impliquent un autre rapport à l’affect littéraire, en ce qu’elles nous bouleversent et nous atteignent au fond de nos retranchements. Les affects soulevés, allant du découragement à la colère, nous amènent à dépasser les considérations strictement narratives, formelles et sociopolitiques, lesquelles peuvent parfois tenir le·la lecteur·rice à distance et influencer la réception des textes. Les retentissements de certains textes à l’étude au cœur de nos corpus respectifs exhortaient naturellement à la discussion, nous empêchant de rester des observateur·rice·s intact·e·s. Surtout lors du partage d’une difficulté, d’un nœud senti au contact du texte et de sa manière de s’introduire en tout·e un·e chacun·e, déstabilisant la façon même de penser à soi. Ce sont nos expériences croisées que nous tentons d’esquisser ici, puisque c’est ultimement l’aménagement de la salle de cours qui a permis l’entrechoquement de réflexions et d’affects pluriels qui se contaminaient, l’instant d’un cours.
Triste, triste Colomb
RRL : Il y a tout d’abord la déception. Je tenais à ce que les étudiant·e·s aient un contact avec le Journal de l’amiral, qu’ils·elles puissent vivre ce que j’avais vécu il y a plusieurs années, en me frottant pour la première fois à cette archive : un mélange ambivalent de nausée et de déception. On fantasme d’y trouver le code originel du colonialisme espagnol, voire européen : avant de le lire, on souhaiterait presque y découvrir des scènes de massacre, un pillage infini, le racisme tel qu’on le comprend aujourd’hui. Le texte est plus subtil, mais il ne manque pas d’éléments symboliques qui annoncent bel et bien ce que deviendra la modernité occidentale. J’exposais, devant mon groupe, ce qu’avait été ma première impression du Journal ; je disais que je rêvais, à tout le moins, d’y trouver des « coupables », sinon une explication de l’état du monde. Suscitant quelques sourires, j’entamais le cours avec ce désenchantement, même si je devinais que celui-ci ne pourrait être transmis. C’était ensuite à leur tour de me décrire leur perception : une étudiante évoquait l’errance de Colomb et l’impression qu’elle avait eue de lire le journal d’un homme complètement perdu ; une autre y voyait un lien, bien que lointain, avec les atrocités eugénistes du xxe siècle. Je sentais ici une once de colère, là de la consternation, ailleurs l’envie de comprendre ce que j’entendais enseigner à partir de cette archive classique. Il n’y avait aucune polémique dans l’air, le temps limité de la séance autorisait le groupe et le texte à respirer, et le premier à apercevoir les enjeux plus subtils du second. Nous avons terminé avec un renversement de perspective : je montrais aux étudiant·e·s que les zapatistes avaient repris, pour le parodier, le geste de l’explorateur en allant à la rencontre de l’Europe et en la renommant dans une langue maya. De la sorte, j’espérais, sans vouloir imposer cette perspective, montrer que le voyage, loin d’être contaminé à jamais par une symbolique coloniale, recèle des possibilités de resignification. Plutôt que par le mitraillage du mot « décolonial », c’est par le geste de lecture et la reconnaissance des affects – admettre qu’on peut rire devant un texte aussi bizarre, aussi solennel, que le Journal ne va pas de soi – que s’est développée une conversation très éloignée des descriptions parodiques et réactionnaires dont l’université fait l’objet dans plusieurs médias.
Colomb, figure surchargée et environnée de tant de débats et d’émotions, se transformait en un étrange personnage, un homme, à la frontière de l’Occident, complètement perdu et déplaçant cette frontière plus loin, de manière meurtrière. Personne ne semblait voir, entre le politique et le littéraire, le lieu d’un duel : il s’agissait plutôt de chercher, dans les failles du texte, l’alliance entre littérature et colonialisme, la part symbolique de la domination humaine. Moins un fuck you (quoiqu’il soit toujours bienvenu) à Colomb qu’une enquête parmi ses traces, le cours me permettait de chercher le lieu, peu stable, de la nuance en acceptant de devoir manœuvrer entre des critiques saisissantes – de la part d’intellectuel·le·s et de militant·e·s – et des zones d’ombre. Ni le texte, ni moi, ni le groupe, n’étions à la poursuite d’une quelconque forme de conquête (herméneutique ou autre), l’errance au milieu cette catastrophe annoncée par le Journal formant peut-être le seul legs de cette leçon qui, plus j’y pense, n’en était pas vraiment une.
Disgrace ou les malaises
MS : Ce sont ma propre lassitude et ma désillusion qui m’ont amenée à suggérer à mon groupe la lecture du roman Disgrace (1999) de J.M. Coetzee. Étudiante, je me suis trouvée aux prises avec ce roman dont la profusion d’horizons de sens possibles se voyait constamment réduite à la seule perspective du professeur qui me l’enseignait ; j’ai voulu renverser le sort.
À travers un dispositif narratif ambigu où une parole omnisciente nourrit autant qu’elle raille la vision intérieure d’un professeur de communications déchu de l’université de Cape Town, l’œuvre met elle-même en scène les rapports de domination – sexuels et raciaux, entre autres – qui peuvent sévir dans la salle de cours. Le récit débute notamment par la destitution et l’exil, autant symboliques que concrets, du professeur, dont les agressions sexuelles répétées à l’endroit de l’une de ses étudiantes noires ont été dénoncées. L’impression forte que m’a laissée mon premier contact avec cette œuvre et le regret de n’avoir pu la lire autrement qu’à partir de mes insatisfactions liées à son enseignement m’ont encouragée à l’intégrer dans un cours portant sur l’« évolution » du roman en général. C’est un texte complexe que j’admire, qui est adulé pour des raisons qui ne pourraient jamais être miennes, et est abhorré en raison de considérations et de points de vue auxquels j’adhère tout à fait. Nommément, les agressions sexuelles qui constituent l’amorce du roman ne sont jamais nommées comme telles : est uniquement fournie aux lecteur·rice·s la perspective écrasante, machiste et blanche du personnage principal ainsi que de son acolyte omniscient qui, essentiellement, l’encourage et le suit comme son ombre. La seconde agression mise en scène dans Disgrace est commise à l’endroit de la fille du protagoniste afrikaner habitant le Eastern Cape, par des hommes que l’on devine être des Xhosas, un des peuples noirs vivant essentiellement dans l’est de l’Afrique du Sud. À l’inverse de la première attaque, celle-ci se voit nommée en toutes lettres et dénoncée furieusement par le professeur. La violence est visible lorsqu’elle est subie par la femme blanche et perpétrée par l’homme noir, il n’en est pas de même lorsque le contraire se produit. La brutalité et la violence de la blanchité et du masculinisme, dans cette Afrique du Sud post-apartheid, sont effrontément exhibées à l’intérieur des voix narratives même. C’est une mise en récit qui, je le répète, impose une focalisation absolue sur les besoins et les désirs d’une figure dont la misogynie et le racisme sont le moteur d’une immense partie du dispositif discursif du roman.
Ce sont cette narration tordue et le piège considérable d’une identification totale à celle-ci que j’ai donc proposés à mes étudiant·e·s, afin que nous y réfléchissions en commun. Cela ne peut se faire sans vertige et remises en question. L’ambiguïté du mode de représentation littéraire demande d’adopter une pratique de lecture engagée, vulnérable et affective des textes difficiles qui peuvent être porteurs de possibilités postcoloniales et critiques sans précédent. J’ai eu beau réitérer cette conviction aux étudiant·e·s avant la lecture de Disgrace, j’ai craint leur réaction et encore plus leur jugement quant à mon choix de la recommander.
L’incertitude et le malaise provoqués par ce récit ont au contraire favorisé le partage des sensibilités et des réactions dans notre groupe. La difficulté des thèmes abordés dans Disgrace et les interprétations plurivoques que l’œuvre suppose appellent à accueillir ce que le texte nous impose en termes d’affects afin de l’investir dans nos propres apprentissages, geste dont le pari me semble avoir été accepté et relevé par la classe. C’est suivant mes balbutiements et les leurs, nos mécompréhensions et nos échanges depuis nos lectures et postures variées, que le texte nous a permis d’expérimenter ces errements, cette reconnaissance de nos propres limites et présupposés. Une expérience que la pensée littéraire engage et promeut, si on décide de se prêter à l’exercice.
L’écoute contre la surveillance
Nous en convenons tous·tes deux, à partir de nos expériences respectives de la salle de cours, les déambulations et les affects difficiles que provoquent certains textes permettent la rencontre avec soi-même. Éprouver collectivement un texte qui appelle non seulement à sa propre remise en cause, mais également à celle de nos biais, permet de faire de la salle de cours un lieu où la vulnérabilité partagée s’esquisse comme une approche pédagogique essentielle. La salle de cours devient l’espace où l’on construit une relation qui n’est pas qu’une autre métaphore universitaire dépourvue d’applications concrètes.
Avions-nous, nos legs racisés, une prédisposition au malaise, puisque nous devions enseigner à des groupes presque exclusivement blancs et performer une forme quelconque de radicalité ? La véritable surprise, la part la plus incontrôlable, a été l’éveil de certain·e·s étudiant·e·s qui ont osé admettre une ressemblance entre eux·elles et un fragment du texte. C’est dans cette constatation par le littéraire des dispositions et orientations personnelles les plus ancrées et intimes que le « texte difficile » devient cette irrévocable et magnifique perturbation de celles-ci. Une personne a reconnu qu’en lisant Disgrace, c’était son propre regard sur les corps féminins qu’elle avait vu ; une autre détectait malgré elle, dans le Journal de Colomb, un héritage dont elle ne voulait pas. Ces textes, qui ne sont pas québécois, ont facilement franchi une frontière temporelle et culturelle qu’on considère souvent, à tort, comme insurmontable. De même, la différence entre nos processus respectifs de racialisation et la blanchité majoritaire de la classe n’a pas généré une frontière : au contraire, elle a permis, ici et là, un rapprochement entre les perspectives.
Nous avons vécu l’enseignement telle une manière de s’exercer à une forme d’exposition dans laquelle nous acceptons nos lézardes comme celles des autres. Ainsi que l’écrit le poète Monchoachi : « nous nous maintenons dans l’écart / écho et écoutant / porteur du mot de passe / et la détresse. » Cette position double invite à la résonance, nous n’enseignons qu’en vue d’amplifier les sensibilités, collectives et individuelles, commandant moins aux étudiant·e·s une manière de penser que rêvant de les guider. Nous ne produisons pas des subjectivités, pas plus que nous ne les surveillons. Tout vocabulaire critique requiert une patience, un temps, pour qu’il devienne une forme d’habitude, sinon de repère parmi les nombreux problèmes abordés par la littérature. Il n’y a pas d’examen pour la bonne conscience, ni pour la mauvaise, pas plus qu’il n’existe un test plus réel que le réel afin d’observer l’évolution d’une pensée qui se forme, que ce soit la nôtre ou celle des communautés étudiantes majoritairement blanches devant lesquelles nous sommes devenu·e·s nos propres expérimentations. En saluant encore ces communautés, nous disons « bonne et longue nuit » à l’autorité, avec ou sans classe.