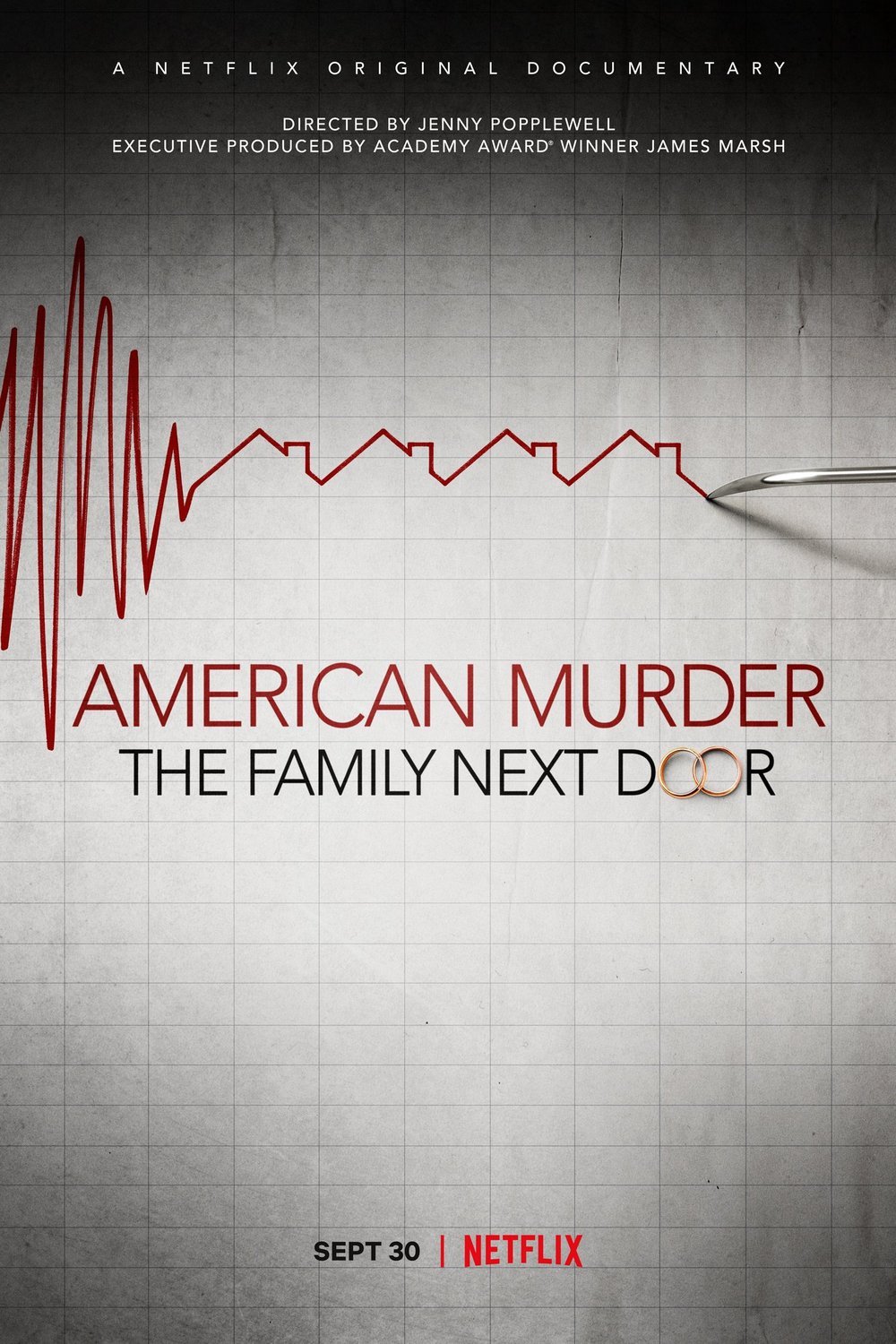Parmi l’immense quantité de documentaires True Crime qui pullulent sur les plateformes de diffusion numérique, L’affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale se démarque par l’inconséquence avec laquelle la réalisatrice, Jenny Popplewell, a traité ses choix esthétiques. Il en devient un film charnière par accident, exceptionnel dans sa médiocrité, fortuitement fantastique par ce qu’il dit sur l’époque dans laquelle il se situe. Socrate énonce dans Gorgias que « nul n’est méchant volontairement » ; ceux qui agissent mal sont ceux qui se trompent sur la nature du bien. C’est ce désolant spectacle qu’offre le visionnement de ce documentaire Netflix. Désolant, non pas en raison du meurtre au centre du récit, aussi monstrueux que tous les autres, mais de la nonchalance avec laquelle il agence, en une œuvre sensationnaliste, la matière première vidéographique qui constitue l’archive de cette histoire.
Le plus effrayant est sans doute que cette Affaire Watts se suit avec passion. Adoptant le point de vue de la police, l’enquête est uniquement reconstituée à partir d’un montage d’images d’archives issues des caméras de surveillance, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par les différents membres de la famille et des messages privés de la victime, Shanan Watts, dans lesquels elle confie ses frustrations sexuelles à une amie proche, quelques jours avant sa mort. Dans cette entreprise de construction post mortem de l’affaire, la nature des images semble pervertie. La caméra ventrale du policier, explorant avec tension une potentielle scène de crime, devient un found footage horrifique, ce dernier cachant aussi efficacement qu’involontairement l’objectif de sa main. Devant cet enchaînement de vidéos, nous sommes réduit·e·s à n’être que des pantins de la pulsion scopique, dont l’instinct primaire est excité par la possibilité d’entrevoir quelque chose d’horrible. Nous sommes fasciné·e·s par l’efficacité de la narration et la particularité de ces images d’archives, dont nous peinons à croire qu’elles existent. L’affaire Watts remplit ainsi parfaitement sa mission de divertissement en rendant envoûtant le visionnement voyeuriste et intrusif des caméras ayant capté, chaque jour, la vie des membres de la famille Watts.
Au-delà de son sujet, ce documentaire est surtout le témoin involontaire de la quantité d’images qui nous saisissent de façon quotidienne. La sélection d’archives provoque inévitablement une division dans la nature même des plans. D’un côté, le coupable est montré exclusivement par des images prises en direct au moment de l’enquête, que ce soit par la police ou par les médias. De l’autre, sa femme – la victime – n’apparaît qu’à travers les traces qu’elle a semées sur Internet : une présence fantomatique et désincarnée qui l’objectifie et la ramène essentiellement à son rôle de mère ou d’épouse. La narration, qui enfonce les spectateur·rice·s toujours plus profondément dans les ramifications de cette affaire sordide, empêche d’être empathique à l’égard de Shanann Watts. Chaque morceau raconté de sa vie, qui n’avait pas pour vocation d’être dévoilée dans un montage cinématographique, pousse au contraire à la blâmer pour son propre assassinat, comme l’ont fait certain·e·s internautes en n’ayant accès qu’à des micro-informations. Jenny Popplewell choisit de donner une place conséquente aux querelles du couple et à la facette contrôlante de Shanann, et montre Chris, son mari, comme une personne étouffée dans un mariage qui bat de l’aile.
Si je fais ici le choix conscient de ne pas accorder plus d’importance au récit, il est impossible de ne pas prendre en compte sa nature de fait divers. Ce genre est très présent dans la culture populaire, qui structure nos imaginaires, titille nos bas instincts et agite des paniques morales souvent utiles à la montée d’un autoritarisme étatique et policier. Le fait divers et ses représentations sont des outils politiques et on ne peut l’ignorer. Comme tout film autoritaire, L’affaire Watts met cette dimension sous silence, nous glissant au contraire, au creux de l’oreille, que tout n’est que succession de causes et de conséquences logiques. L’absence est d’ailleurs au cœur de la proposition esthétique de Popplewell : l’absence d’images tournées pour le film, certes, mais aussi l’absence de la cinéaste sous quelque forme que ce soit, visuelle ou sonore. Comme si celle-ci ne jugeait pas nécessaire de contextualiser la subjectivité d’une esthétique aussi radicale, au risque de créer de la distanciation chez l’auditoire. Il est, au contraire, essentiel que ce dernier reste collé et fasciné par les images, sans poser aucune question quant à leur nature ou à leur utilisation. Chez Popplewell, le fait de nier sa subjectivité de documentariste ne va pas de soi et suggère une volonté de mise en scène. Un·e documentariste filme avant tout sa relation avec un sujet, iel est présent quoi qu’il arrive, même s’iel ne le veut pas. Ce que la présence-absence de Jenny Popplewell semble vouloir dire, c’est qu’il n’est pas nécessaire de faire un pas de côté pour saisir l’affaire : les images parlent toutes seules, elles exposent le réel dans son plus simple appareil, sans exiger aucune lecture. Popplewell participe ainsi à alimenter une construction policière selon laquelle les images de surveillance seraient neutres. Sauf que ce n’est pas le cas. À ce propos, Ulrike Lune Riboni précise, dans son récent ouvrage Vidéoactivisme (2023), que les caméras corporelles de la police « favorisent le point de vue de l’officier » et que la caméra de surveillance, jouissant d’une impression de pure objectivité, « ne sera pas mis[e] en cause comme « biaisé[e]
/01
/01
Ulrike Lune Riboni, Vidéoactivisme, 2023, Paris, Éditions Amsterdam, p. 172
» .
Ce choix s’explique, car le documentaire L’affaire Watts ne se veut pas politique : il ne cherche qu’à utiliser des images policières pour divertir, à l’exception du carton de fin : « In America three women are killed by their current or ex-partner every day ». Un fait essentiel à rappeler, mais qui, au bout de 80 minutes de voyeurisme, laisse un goût amer de dédouanement dans la bouche. Car L’affaire Watts ne parle jamais de féminicide. N’en montre jamais les soubassements idéologiques, matériels et sociaux. Ce que ce long-métrage montre, essentiellement, c’est la meilleure téléréalité du monde, suggérant du même coup que la prochaine émission est déjà filmée. Nos vies sont captées, stockées, scrutées, jusqu’à ce que quelqu’un commette un crime ou vive une histoire suffisamment vendeuse pour devenir un épisode Netflix. Que nous soyons victime ou bourreau, nos vies sont devenues un spectacle que nous créons nous-mêmes volontairement à l’aide de dispositifs de captation omniprésents. Les protagonistes de L’arnaqueur de Tinder (2022), également diffusé sur Netflix, n’auraient jamais pensé, au moment où elles filmaient le décollage du jet privé d’un soi-disant millionnaire, qu’elles allaient servir à divertir plusieurs centaines de milliers de personnes. Shannan Watts ne savait pas, en installant une caméra sur sa porte d’entrée, qu’elle filmerait ses derniers instants, rendus ensuite visibles sur une plateforme comptant 238 millions d’abonné·e·s.
L’affaire Watts est l’indice de l’émergence d’une utopie dans laquelle les systèmes de contrôle deviennent sources d’images et de scénarios, issus d’un seul et même corps policier, lui-même sans doute piloté par une Intelligence artificielle. Des centaines d’heures de contenus, déversés à moindres coûts sur une plateforme prise dans une boucle de rétroactions sans fin, participent à créer une forme ultime de contrôle et d’aliénation divertissante.