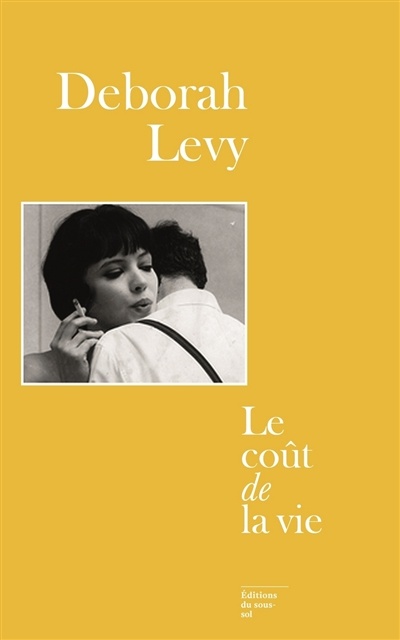Nulle trace, Simon Lavoie, GPA Films et K-Films Amérique, 2021, 101 minutes.
///
« La liaison et la logique poétique au cinéma, voilà ce qui m’intéresse.
Et n’est-ce pas ce qui convient le mieux au cinéma,de tous les arts
celui qui a la plus grande capacité de vérité et de poésie? ».
— Andreï Tarkovski, Le temps scellé
La prétention de l’image
La chose est bien connue : l’opposition entre documentaire et fiction, d’une part, de même que celle entre cinéma d’auteur (jadis nommé « d’art et d’essai ») et cinéma commercial (dit parfois « de divertissement »), d’autre part, font partie des dualismes immémoriaux du média cinématographique. S’il est vrai que, dans le contexte de la production québécoise contemporaine, plusieurs cinéastes – et parmi les plus intéressants – ont tendance à chercher volontairement la synthèse entre cinéma d’auteur et cinéma commercial (à l’instar des cinéastes de la génération des années 1960 qui ont tenté de renverser l’écueil de l’argument entre documentaire et fiction), il n’en demeure pas moins qu’il existe certains irréductibles pour qui tout compromis serait nécessairement une compromission. À n’en point douter, Simon Lavoie fait partie de ce groupe de créateurs dont chaque œuvre nouvelle est une proposition radicale qui vise à élever l’art cinématographique et son spectateur.
Tout juste présenté en première mondiale au Slamdance Film Festival, son dernier film, Nulle trace, ne fait aucunement exception à ce principe et à ces exigences. Nulle trace souhaite montrer, par le biais d’une fiction pensante (véritable fable sur l’image et la croyance), que le cinéma demeure l’art qui possède la plus grande capacité de vérité et de poésie. À la fois minimaliste et contemplatif, bouleversant et abstrait, il s’agit d’un film pour le moins difficile à résumer. Tout « ovni » cinématographique qu’il puisse paraître aux yeux du spectateur non initié, Nulle trace s’inscrit toutefois de manière particulièrement organique dans l’œuvre de Lavoie qui, de film en film, travaille les mêmes thèmes (la filiation, la marginalité), les mêmes motifs (un rythme lent, une ambiance glauque et chargée, une poésie du quotidien), les mêmes hantises (la peur de l’autre, la monstruosité, le poids de la faute), sans pour autant ne jamais se répéter et en faisant de plus en plus confiance au spectateur, à qui Lavoie – qualité peut-être trop rare chez les cinéastes – prête la prétention (dans le bon sens du terme) de vouloir comprendre toujours davantage le monde dans lequel nous vivons, et, aussi, dans lequel nous allons mourir. Le cinéma de Lavoie est un memento mori qui, par l’image, nous offre une expérience transpersonnelle et supratemporelle.
La vérité du format
Ce qui frappe d’abord avec Nulle trace, c’est son minimalisme, voire sa sobriété. Déjà, le générique de début, plutôt que de vouloir constituer une attraction ou un spectacle à part entière, se résume à quatre « cartons » où nous lisons sobrement l’ensemble des noms de l’équipe ayant participé à la production du film. Il n’y aura pas, non plus, de générique de fin, permettant, avec une chanson ou une pièce musicale, de méditer sur l’histoire qui vient de nous être racontée. Nulle trace, donc, se veut une proposition esthétique brute, qui fait fi de tout le « paratexte » cinématographique habituel.

Le spectateur est jeté dans cette diégèse sans compromis, et aussi sans repères. Après le générique, nous verrons longtemps un écran noir, tandis que résonnent des tintements, des cillements à la fois planants et inquiétants. Émergeant lentement de cette sorte de néant originel, la première image du film sera celle d’une voie ferrée, depuis la perspective d’un train en marche. Ce plan, qui ne montre jamais la locomotive ou le véhicule, mais seulement le chemin de fer (les rails, les lattes de bois et les cailloux), durera plus de deux minutes, alors que l’ambiance sonore s’intensifie en crescendo. À ce stade de l’œuvre, nous ne savons donc encore rien de l’univers où nous venons de pénétrer et que nous allons arpenter pendant près de deux heures. Ce qui est évident, néanmoins, c’est le désir qu’a le réalisateur de proposer non pas tant un récit (au sens de suite évolutive d’événements et de péripéties), mais une expérience, d’ailleurs davantage sensorielle qu’intellectuelle ou affective, car il s’agit ici bien de ressentir plutôt que de comprendre.

Cette expérience condensée de mouvement et de durée par laquelle le film s’offre au spectateur et à la spectatrice est également une ouverture programmatique et hautement symbolique en cela qu’elle investit la mythologie du média qui la rend possible : celle d’une des premières projections publiques, L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat. Il n’est pas nécessaire d’avoir étudié le cinéma pour connaître la mythologie qui s’est rétrospectivement emparée du film : à la vue du train s’approchant furieusement de l’écran, comme s’il allait le traverser, l’assemblée de spectateurs et de spectatrices aurait littérairement pris la fuite, de peur de se faire happer par cette bête de fer. Or, si les chercheurs ont depuis fait la part de la légende et de l’histoire dans cette anecdote, il n’en demeure pas moins que L’arrivée d’un train, qui fut d’ailleurs un énorme succès, demeure sans doute l’œuvre qui symbolise le mieux l’impact de cet art nouveau.

Soulignant de façon fortuite ou délibérée le 125e anniversaire de cet acte de naissance, Nulle trace est également un film qui utilise le train et le dispositif ferroviaire pour proposer une réflexion sur la puissance de l’image et sa capacité d’illusion. Une réflexion, aussi, sur la croyance et sur l’artifice. Là où la seconde partie du film se concentre plutôt sur l’errance et la marche en forêt, la première partie est entièrement construite sur des blocs narratifs qui mettent en scène le chemin de fer, le train, ainsi que la draisine à moteur que pilote l’une des deux protagonistes. Cet univers étrange, monde post-apocalyptique où l’armée surveille les frontières alors qu’il faut lutter pour sa survie (nous ne sommes pas loin de Stalker, réalisé par Tarkovski en 1979), nous est donc raconté à travers une série de séquences en mouvement. L’univers bâti par Lavoie se construit et se déplie par des rythmes, des lignes, des croisements. Film dont le minimalisme nous pousse vers une forme d’abstraction, Nulle trace est également une fiction géométrique, où il est après tout question de frontières, de rails, de routes et de lignes de vie. Que fait Lavoie ici, sinon partir à la recherche de l’origine du média qu’il travaille et investit depuis plus de deux décennies ?

« Ce n’est pas une image juste, c’est juste une image », lit-on dans un carton de Le vent d’Est (1970) de Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin et Gérard Martin. Dans Nulle trace, au contraire, Lavoie est à la recherche d’une image juste – image qui soit « à la fois justice et justesse », pour paraphraser Roland Barthes dans La chambre claire –, mais cette quête ne peut se faire qu’à travers ce qui, dans un premier temps, s’apparente aussi à une déconstruction. Car si le dispositif présent dans l’image est celui du chemin de fer, le dispositif qui travaille l’image elle-même est le changement constant, et en apparence non justifié, des formats (au sens de ratio) de l’image : en effet, sans trop de raison, on passe du format panoramique de l’image cinématographique contemporaine au format carré, dit « Academy ratio », qui rappelle le format du cinéma des premiers temps. Brisant sans cesse l’illusion d’une fiction qui, en raison de ses longueurs et du peu d’éléments qu’elle nous livre sur son univers, n’est pas particulièrement prenante ou immersive, ce jeu formel, toutefois, nous donne accès à la vérité du film. Dans cette oscillation entre différents formats de l’image, Lavoie tente de faire émerger une vérité qui dépasse le seul cinéma, mais qui touche de manière à la fois plus profonde et plus intime à notre rapport au monde.
De la trace à l’aura
Même si elle est équivoque, il y a aussi une histoire dans Nulle trace. Celle d’une mère, Awa (Nathalie Doummar), et de sa petite fille encore poupon qui vont traverser la frontière grâce à N (Monique Gosselin), contrebandière taciturne. Tout semble séparer ces deux femmes : N est pragmatique, matérialiste, athée, alors qu’Awa est un être de croyance, d’espoir et de culte. Pendant que la première répare des machines, allume des feux et dépèce des animaux, la deuxième chante, prie et se prosterne. À peine de l’autre côté de la frontière, où elle voulait rejoindre son mari, Awa et sa famille seront pris par des brigands. La mise en scène suggère que le père et l’enfant ne survivront pas. Seule Awa, violée et abandonnée dans la forêt, va demeurer en vie. Elle sera sauvée par N, qui la prendra sous son aile.
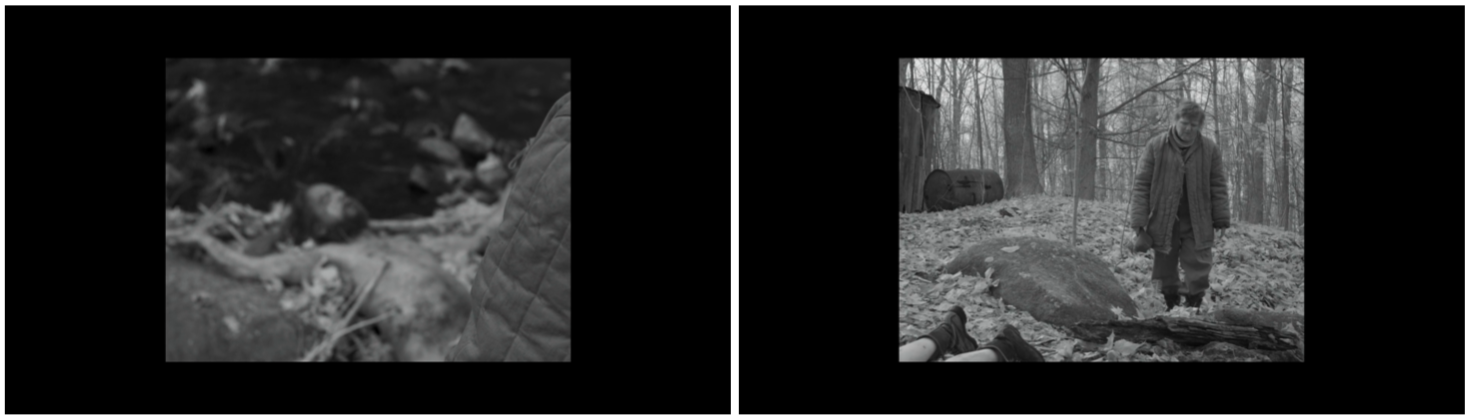
Or, le plus grand défi de la contrebandière sera de faire prendre conscience à Awa de ce qui s’est réellement passé, de lui faire accepter cette version des faits. Car la jeune femme, elle, n’a pas vu les cadavres, le sang ; elle n’a pas vu les traces. Elle continue de prier pour le retour de ceux qu’elle aime, refusant de croire aux signes qui l’entourent de même qu’aux paroles de N. Et c’est là, littéralement, qu’un miracle se produit, alors que s’illuminent également tous les choix esthétiques du film.

Cherchant à fuir la forêt avant l’arrivée de l’hiver, N va retourner sur la scène du crime afin de ramener quelques évidences à la jeune femme pour la convaincre de partir avec elle. Alors que, comme N (personnage autour duquel le récit se construit), nous avons le souvenir d’avoir vu le cadavre brûlé du poupon et le corps émasculé du mari, il ne semble maintenant plus rien rester de ce carnage. De tout cet innommable, ne subsiste nulle trace, au point où l’on se demande si ces morts ont réellement eu lieu, si nous avons bien vu ces images. Avec un incroyable aplomb et une maîtrise totale de son art, Lavoie reprend ici les motifs tarkovskiens de la croyance, de la prière et de l’importance de la parole, tels que développés dans Le sacrifice (1986). N, personnage nihiliste, personnage de la négation (d’où son nom ?), ne peut en croire ses yeux. Il n’y a aucune explication logique face à cette absence de signe et de trace. Sans réponse, arrivée au bout de sa logique survivaliste, elle donne alors l’impression de plonger dans la folie, pour finalement se livrer aux miliciens. Mais, là encore, est-ce réellement ce qu’elle fait ? À l’autre spectre de la croyance, reste Awa qui, dans la dernière scène du film, verra apparaître un être de lumière, qui semble être son mari. Des traces, on passe à l’aura ; du poids de la matière, on bascule vers l’immanence de la croyance et de la foi, un certain appel du lointain à travers ce qui est pourtant proche (selon la définition de Walter Benjamin). Là où tout, dans la vie de N, l’amène à regarder vers le bas, vers la terre, pour y décoder les signes et indices qui lui permettront de survivre encore un peu en repoussant l’inévitable, Awa, elle, nous encourage à lever les yeux vers tout ce qui nous dépasse et, surtout, à ne pas toujours chercher des réponses.

Film sur le cinéma, sur sa capacité d’illusion et de vérité, Nulle trace, à travers sa fable, nous propose deux postures distinctes de spectature, qui fonctionnent aussi comme deux rapports au monde. Déconstruisant son récit à travers un jeu sur les formats, proposant des images qui sont davantage des méditations que des vecteurs de récit, Lavoie nous encourage à ne pas prendre le cinéma au pied de la lettre, mais bien à nous laisser élever par lui. En ces temps troubles où l’entièreté de notre rapport au réel est médiatisé par l’image et par l’écran, il n’y a sans doute pas de plus grande leçon de vérité et de poésie.