Orwell à sa guise. La vie et l’œuvre d’un esprit libre, George Woodcock, Montréal, Lux, 2020, 424 p.
///
Par pudeur ou modestie, George Orwell a toujours refusé que sa vie fasse l’objet d’un livre. Inscrit dans son testament, ce souhait est à demi respecté quand paraît, en 1966, The Crystal Spirit. A Study of George Orwell, la clairvoyante étude que lui réserve George Woodcock, récipiendaire la même année du Prix du Gouverneur général pour le meilleur essai de langue anglaise.
Il s’en trouvera d’autres, à sa suite, pour outrepasser les dernières volontés du romancier, et parfois de magistrale façon (pensons à la somme de Bernard Crick, sobrement intitulée Une vie). D’emblée, Woodcock se défend pourtant bien de le faire : point de velléités biographiques ici, mais plutôt un regard critique sur la production orwellienne, des romans aux essais, en passant par les chroniques dont certaines, parues dans le magazine Tribune au sein de la série « As I Please », inspirent aux éditions Lux le titre de la traduction française assurée par Nicolas Calvé.
Si d’aventure Woodcock force les frontières entre l’intime et le littéraire, donc, c’est que celles entre la vie et l’œuvre d’Orwell sont éminemment poreuses, qu’elles se confondent souvent en un seul et même projet, comme tend à l’établir, à l’abri de tout biographisme forcé, Orwell à sa guise. La vie et l’œuvre d’un esprit libre. Quand l’auteur tourne son attention vers l’homme à l’éternel veston de tweed, il le fait en pleine connaissance de cause. Au cours des années 1930-1940, les deux intellectuels font partie des membres dissidents de la gauche littéraire britannique, en plus de siéger ensemble, à partir de 1945, sur le Freedom Defence Committee.
Bien que Woodcock admette les forces de son homologue, il en reconnaît aussi volontiers les faiblesses. Il rend ainsi à l’écrivain ses aspérités, que l’édification au rang de culte avait rabotées jusqu’à en faire une sorte de génie prophétique unidimensionnel. Alors que plusieurs le portent aux nues et le font accéder sans compromis au saint des saints littéraire, Woodcock procède à rebours. Dans un portrait sans concession, il déshabille le mythe pour laisser entrevoir les humaines imperfections de son sujet. Orwell, écrit-il d’ailleurs, « était trop solitaire pour être un symbole et trop irascible pour être un saint ».
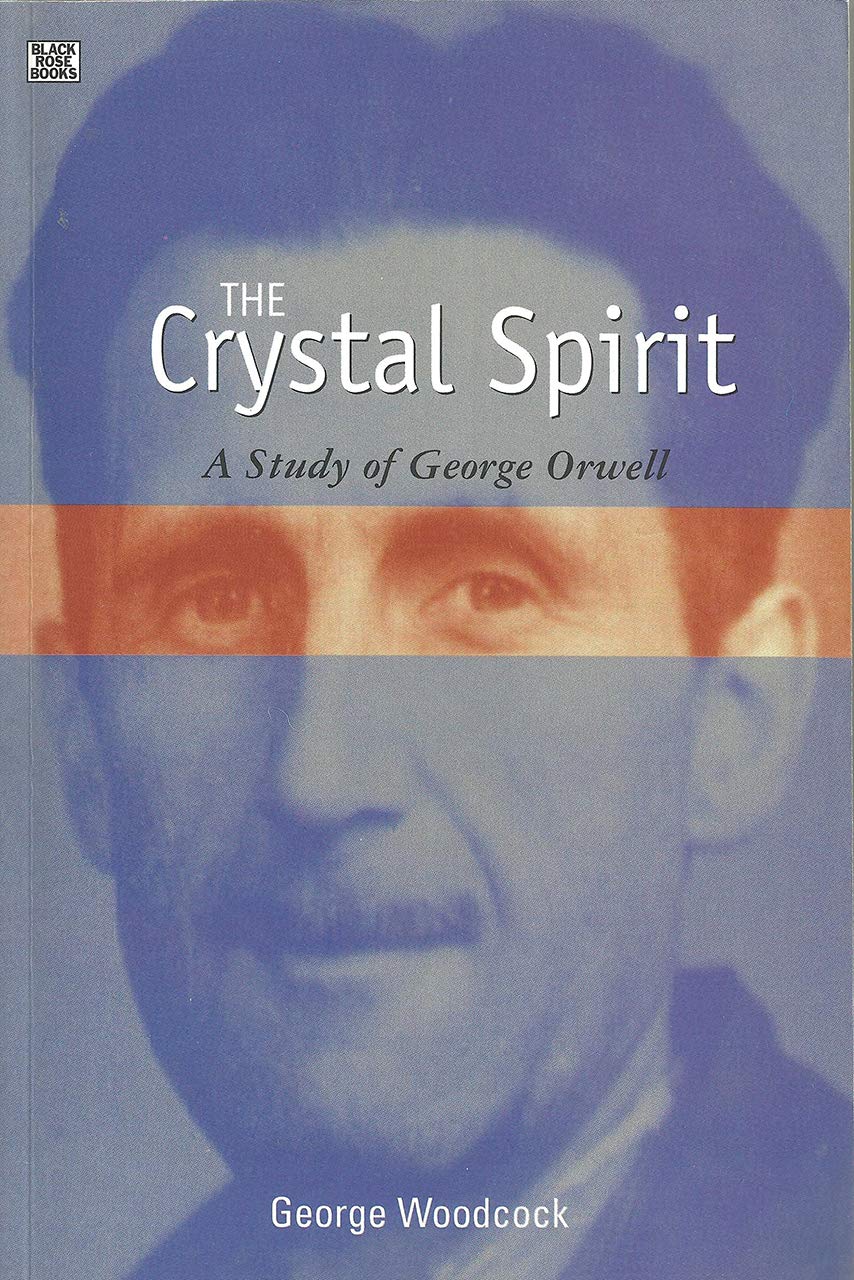
Portrait critique
Critique, Woodcock l’est sans contredit à l’égard de celui qui deviendra, au fil des ans, un ami proche. Une chose assez rare, de la part d’Orwell, tant ce dernier voue une attention maniaque à préserver sa vie intime et à compartimenter ses relations personnelles, de sorte que très peu d’entre elles passent le seuil de son appartement londonien. De cette fréquentation qui perdure jusqu’à ce que la santé précaire de l’auteur de 1984 ait raison de lui, en 1950, l’essayiste retient les souvenirs d’un homme aussi tranchant à l’écrit que réservé en personne.
Sa première rencontre avec Orwell sur le plateau d’enregistrement de la BBC lui permet d’entrevoir un assez piètre orateur, une faiblesse notamment due à la balle qui lui traverse la gorge pendant la guerre civile espagnole. De fait, « L’homme dont je me souviens », première des quatre parties d’Orwell à sa guise, constitue une esquisse de l’individu dont on retient surtout les nombreux travers et manies. Procédurier, pointilleux, plutôt malhabile à débattre de questions politiques, Orwell a pour singulière habitude de singer les manières de la classe ouvrière en se disant libertaire, plus tard socialiste, avant d’enfin, et pour de bon, épouser le credo socialiste libertaire.
Son penchant pour la nature et le travail manuel lui permet de prendre congé de son engagement politique. Il traduit également sa nostalgie envers un mode de vie passé, plus simple, plus sain, se traduisant par une sorte d’attrait pour les univers semi-idylliques. À l’image de Barnhill, la vieille ferme plantée en plein cœur du Jura qu’il acquiert vers la fin de sa vie, pour y couler des jours tranquilles, en compagnie de son fils. À l’image, aussi, de ce Pays Doré fantasmé qui traverse l’ensemble de son œuvre et se pose en refuge contre l’avilissement de la civilisation.
L’héroïsme ordinaire
Le second volet de l’étude, le plus imposant, offre une analyse minutieuse, parfois sévère mais toujours attentive, des romans d’Orwell. Au fil d’une lecture immersive, et d’aller-retour constants entre la vie et l’œuvre de l’esprit libre qu’il sonde, Woodcock dégage ainsi les fils lui permettant d’éclairer les pans les plus significatifs de son corpus.
L’un d’eux fait la lumière sur le canevas narratif auquel recourt le plus couramment l’auteur. En portant son origine comme la « marque imméritée du paria », l’anti-héros orwellien typique serait ainsi en proie à une « aliénation originelle » le confinant à son milieu social. Ses multiples et infructueuses tentatives pour enjamber le fossé des classes en font foi. De la petite démocratie des clochards londoniens (Dans la dèche à Paris et à Londres) aux champs de houblon de Kent (Une fille de pasteur) en passant par l’univers suffocant de la géhenne minière de Wigan (Le quai de Wigan), les personnages sont lancés vers les bas-fonds, dans une série d’aventures tenant du roman de formation, pour en revenir aussi transformés que résignés quant à la possibilité de franchir l’étanche cloison érigée entre les classes sociales.
Orwell lui-même, répugné par toute idée de progrès personnel, obnubilé par la vertu de l’échec qui lui semble un moyen juste de se départir de ses attaches sociales, sera durement confronté à cette vérité immuable. Or, si les bourgeois de son espèce ne peuvent effacer les traces qui les identifient à l’élite, il y a pire, puisque les citoyens de seconde zone restent tout aussi irrémédiablement cloués à leur sort. En cela, le thème de l’aliénation appelle ceux de la tyrannie de classe et de l’inévitable renoncement à y échapper.
Il n’en demeure pas moins qu’Orwell, expérimentant chaque fois le déclassement volontaire qui servira de sève à ses récits, reste convaincu que si quelque part subsistent les signes d’une condition humaine authentique, ils se trouvent soit dans le dénuement des vagabonds, soit, comme dans 1984, dans l’ardeur travailleuse des prolétaires. Guidé par cette conviction que, dans la hideur de la misère brille le diamant de la réalité, le romancier cherche sa vie durant la part d’héroïsme discret qu’il croit logée parmi les héros ordinaires.
Il reconnait aussi cet héroïsme chez les membres du POUM, aux côtés desquels il combat durant la guerre civile espagnole. Pour la première fois de sa vie, il découvre sur le front d’Aragon une confrérie où n’a cours aucune distinction entre dominants et dominés, aucune conscience de classe. Il y est également confronté aux méthodes employées par les staliniens pour trahir la révolution : désinformation, purges, élimination de la vérité objective. On reconnaît là quelques-uns des ingrédients qui feront le succès de La ferme des animaux et de 1984. En cela, la guerre d’Espagne est un événement charnière : après 1937, chacune des lignes qu’Orwell rédigera aura pour but de contrer le totalitarisme et ses effets pervers. Cette posture de l’écrivain en gardien de la liberté n’est d’ailleurs nulle part mieux résumée que dans ces deux vers tirés de « Réflexions sur la guerre d’Espagne » :
Aucune bombe jamais éclatée
Ne peut briser l’esprit de cristal.
Un « art invisible
/01
/01
Simon Leys, Orwell ou l’horreur de la politique, Paris, Flammarion, 2014, p. 28.
»
Orwell n’obtient qu’un timide succès commercial de son vivant. En treize ans, à titre d’exemple, seules 900 copies de son vibrant Hommage à la Catalogne ont été écoulées. C’est pourquoi il rédige, en parallèle à ses créations, une quantité impressionnante de chroniques et critiques littéraires dont la qualité, pour l’époque, demeure selon Woodcock inégalée. De ces centaines de pages proposant une approche majoritairement sociohistorique de Tolstoï, Dickens, Miller ou Koestler, se dégage une conception du travail littéraire, du rapport de l’auteur à son œuvre et de son œuvre au monde. Il en ressort qu’Orwell était un moraliste dans la lignée de Swift – envers qui il reconnait volontiers sa dette –, dont le jugement du bon et du mauvais prenait surtout appui sur les incidences morales des écrits.
Ces textes reflètent aussi l’enfance de l’art orwellien, représentent un laboratoire dans lequel l’écrivain peaufine son idéal esthétique. Dans un essai intitulé « Pourquoi j’écris », touchante profession de foi envers la littérature, il verbalise ainsi cet idéal : « La bonne prose est comme une vitre transparente ». Le romancier atteint ce but avec la clarté et l’extrême concision de La ferme des animaux (1945), fable qui reste, de l’avis de plusieurs, sa pièce maitresse.
Dans le même article, celui-ci évoque quatre motifs pour lesquels il s’acharne encore et toujours sur sa table d’écriture. Outre que par pur égoïsme, il mentionne écrire par enthousiasme esthétique, pour des raisons politiques et afin de consigner sur papier les faits historiques. Trois excellentes raisons de le (re)découvrir, auxquelles s’ajoutent désormais, en français, la pièce incontournable des études orwelliennes de George Woodcock. La traduction de Nicolas Calvé rend d’ailleurs magnifiquement justice à sa plume limpide et vigoureuse. L’unique bémol tient à l’absence de conclusion, d’autant plus prégnante que la monographie de Woodcock s’avère d’une densité remarquable. Laissons-lui ici le mot de la fin, qui résume avec laconisme l’essence de l’art orwellien : « Dans cette prose cristalline qu’Orwell a développée pour rendre la réalité visible réside la réalisation la plus remarquable et la plus durable d’un homme bon et indigné, qui était en quête de la vérité parce qu’il savait qu’elle seule pourrait assurer la survie de la liberté et de la justice ».






