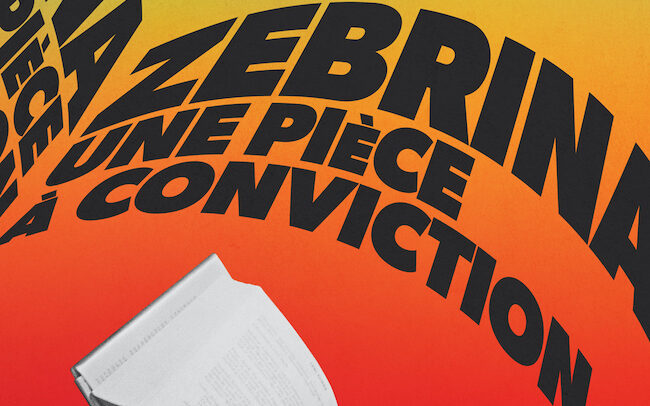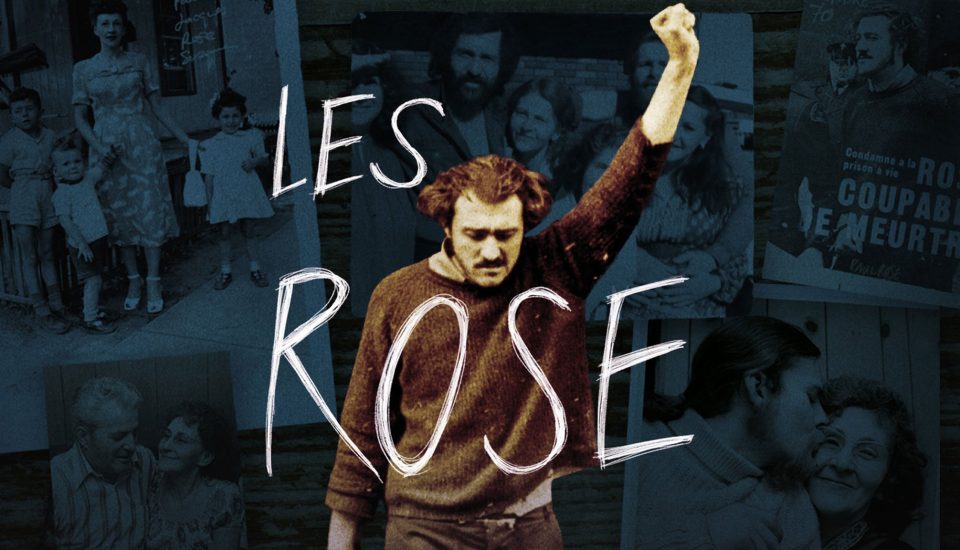Zebrina. Une pièce à conviction, texte de Glen Berger; traduction et dramaturgie de Serge Lamothe; mise en scène de François Girard; avec Emmanuel Schwartz; présenté au Théâtre du Nouveau Monde et en webdiffusion en direct, du 9 au 24 septembre 2020.
///
Nous voici dans le monde d’après : celui de l’étrangeté-devenue-trop-familière des derniers mois, où le déconfinement nous force à apprendre à vivre avec le virus, où pandémie, vie quotidienne, culture et divertissement doivent faire bon ménage.
C’est du confort de mon salon que j’ai éprouvé jusqu’au bout cette étrangeté, en choisissant de profiter de la webdiffusion en direct offerte par le TNM cette saison (les autres spectacles, eux, seront offerts en différé pour quelques dates seulement). Comme un soir de première-qui-n’en-était-pas-une, nous pouvions observer l’arrivée des gens : le public s’observe et se salue, mais de loin – oubliées sont les effusions de bonheur et les accolades à la vue d’une personne absente depuis longtemps –, chacun cherche sa place, les placiers s’animent, la fébrilité est palpable, mais quelque chose cloche et nous rappelle à tout moment que ceci est étrange. Peut-être est-ce dû à la position du voyeur qu’offre la webdiffusion (avant le spectacle, l’angle de vue est celui du coin du parterre) : cachés dans l’ombre, nous voyons ce qu’il ne faudrait peut-être pas voir, d’un endroit où on ne peut pas être vus.

En ce sens, le choix de Zebrina. Une pièce à conviction (traduction d’Underneath the Lintel) de Glen Berger est à propos : devrions-nous être ici ? que faisons-nous ici ? ces gens devraient-ils se trouver en cette heure et en ce lieu, à la recherche d’une relation ou d’une émotion, comme le dirait Koltès ? Oui, puisqu’ils y ont été conviés par le Bibliothécaire, unique personnage de la pièce, qu’incarne Emmanuel Schwartz.
Seul sur la scène d’un théâtre déserté (la charge symbolique est évidemment forte, jusque dans la présence de la sentinelle, cette lumière qui reste allumée lorsqu’un théâtre est vide et qu’éteint Schwartz en rentrant sur scène) et loué à gros prix pour l’occasion, le Bibliothécaire vient raconter l’étrange cas du retour (très) en retard d’un livre emprunté il y a 113 ans, évènement mystérieux qui vient bousculer sa vie terne (ses vêtements sont beiges, gris et bruns), menée jusque là par le souci de traquer les « délinquants » qui ramènent leurs livres en retard.
« Y’a pas plus de monde que ça », dira-t-il un peu dépité au moment de commencer son exposé (« il faudra s’y faire », voudrait-on lui répondre), avant d’enchaîner avec son leitmotiv : « Quand même. Procédons. » C’est qu’il doit absolument nous présenter sa découverte incroyable, celle qui l’aura fait quitter la monotonie de Hoofddorp (en banlieue d’Amsterdam) pour l’emmener successivement à Londres, en Chine, à New York ou en Pologne, sur les traces du mystérieux « A. » qui a emprunté un guide de voyage au siècle passé.

La pièce de Berger est construite comme une enquête policière, alors que le Bibliothécaire enchaîne les trouvailles pour mener au bout ses recherches. À la manière du scénario d’un Da Vinci Code, le texte est à la fois redoutablement efficace dans l’enchaînement de ses rebondissements et excessivement tiré par les cheveux. Obsédé par son affaire, le Bibliothécaire voit des preuves irréfutables là où il y a des coïncidences, convaincu en cours de route que l’homme dont il suit la trace n’est nul autre que le « Juif errant » (selon le mythe chrétien, il serait un cordonnier qui, ayant refusé son aide à Jésus tombé devant sa maison sur le chemin de croix, est condamné depuis à errer sur la Terre jusqu’au retour du Christ).
C’est lorsque le Bibliothécaire se convainc de sa découverte (au mitan du spectacle) que le texte de Berger s’essouffle. Malgré la louable tentative de transformer un mythe originairement antisémite (le Juif errant symbolise la « faute » du peuple juif et, selon les versions, son passage serait annonciateur de catastrophes naturelles) en en faisant la métaphore de l’inépuisable et insaisissable quête de sens qui anime une vie humaine, les questionnements qui s’ensuivent sur l’importance de laisser une trace, le pouvoir de la foi (ou, à tout le moins, de croire en quelque chose) et le caractère salvateur de l’amour et de la compassion paraissent plus convenus.
On s’attache néanmoins à ce personnage, en grande partie grâce à Emmanuel Schwartz, qui démontre une fois de plus toute l’étendue de son talent. Le Bibliothécaire est un personnage (volontairement ?) ridicule et exagéré, dans ses manières, sa vision du monde, sa prétention (son objet le plus précieux est un tampon de bibliothèque qu’il garde fièrement autour du cou, puisqu’il contient « toutes les dates de l’humanité » en lui) et son accent hollandais caricatural.

Seul sur la scène dépouillée du TNM (les rampes de lumières et autres éléments techniques restent bien à vue, sur le sol) où ne s’animent que les projections vidéo de Robert Massicotte, enveloppé des lumières d’Alain Lortie, Schwartz réussit à captiver, même lorsque le personnage se perd dans ses multiples apartés ; que sa performance résiste à la distance imposée par l’écran n’en est que plus impressionnant. François Girard revient au solo pour la première fois depuis Le fusil de chasse, en 2012, dont on retrouve la précision du geste et la minutie dans les détails ; même si l’ensemble n’offre pas un spectacle porté par la même grâce qu’avec Le fusil de chasse (dans les circonstances, ça se comprend), on sent toujours l’aise du metteur en scène face à cette forme scénique.
Avant la représentation, Lorraine Pintal souligne la « présence » des spectateurs qui ont, comme moi, choisi de « vivre le théâtre autrement, en passant de la scène à l’écran ». L’expérience reste forcément incomplète (malgré, il faut le souligner, l’excellente qualité technique de la diffusion). Je ne suis pas encore allé au théâtre, mais ce dernier est bel et bien revenu, et c’est déjà ça de gagné.

crédit photos : Yves Renaud.