« Dans ta face », présenté par Prends ça court! Sur Facebook du 4 mai au 31 juillet 2020.
///
Cela fait un mois que l’organisme Prends ça court! diffuse chaque soir, sur sa page Facebook, une programmation spéciale intitulée « Dans ta face » composée de courts-métrages d’ici et d’ailleurs sélectionnés par différents acteurs du milieu cinématographique. Le cinéma est probablement un peu moins dénaturé que d’autres arts par le passage de la salle de diffusion à l’écran individuel, même si ce passage abolit presque entièrement la dimension « commune » de l’expérience. Cela dit, avec la reconfiguration du mode de diffusion viennent des nouvelles possibilités ainsi que l’occasion, pour le spectateur, de découvrir en quelques jours des courts-métrages ayant des approches très diverses (du documentaire à la fiction), sélectionnés sans critères prédéterminés.
L’humanité en lumière
Dans Talking heads (1980), Krzysztof Kieslowski demande à une quarantaine de personnes d’âges différents – en ordre croissant – les trois questions suivantes : « Qui es-tu? », « Qu’est-ce qui est important pour toi? » et « Qu’est-ce que tu souhaites de la vie? ». L’accumulation des réponses arrive à créer un portrait d’ensemble où sont mis en lumière ce qui nous rassemble et nous distingue, les aspirations que l’on partage et le besoin de se définir en tant que personne. Ce court documentaire, choisi par Rafaël Ouellet, dégage une grande sensibilité humaniste et atteint la beauté dans la simplicité.

C’est avec le même intérêt pour l’intériorité humaine, mais en explorant un terrain beaucoup plus personnel, que Carol Nguyen a réalisé No crying at the dinner table (2019), un choix de Nahéma Ricci. La réalisatrice a questionné ses parents et sa sœur sur leurs souvenirs de leur vie au Vietnam. Le film contient une mise en abyme qui lui confère son originalité, sa magie particulière. Car ce qu’il met en scène, c’est la famille de la réalisatrice en train d’écouter, assise autour de la table de la salle à manger, les entrevues auxquels elle s’est prêtée dans le cadre du film. On assiste aux réactions de chacun placé face à lui-même. Le film met ainsi en scène la façon dont le cinéma documentaire peut avoir un effet thérapeutique et être un espace de transformation personnelle.
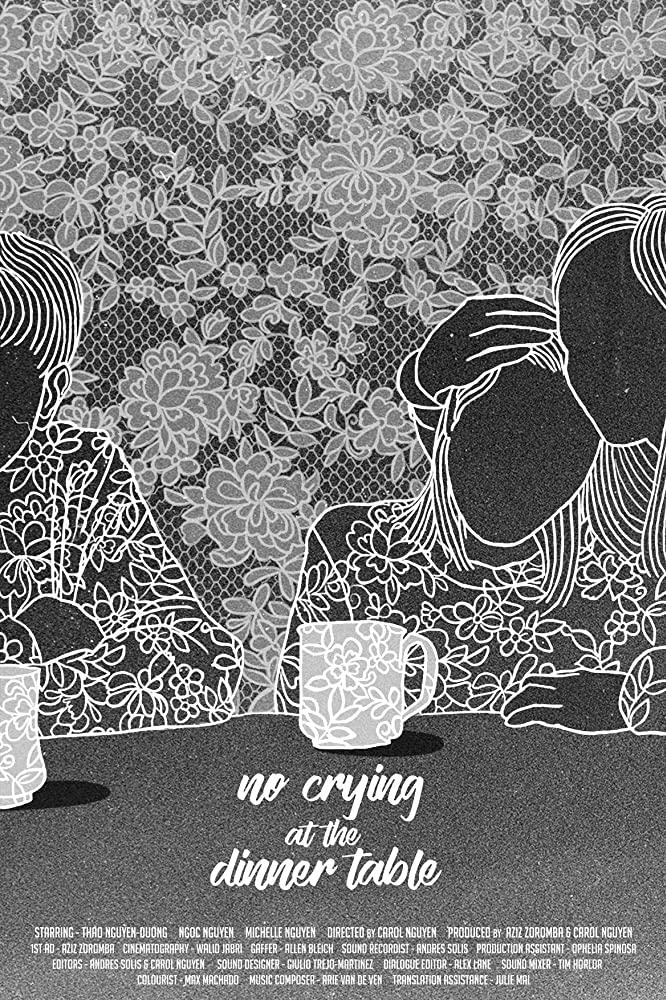
La stratégie du simulacre
Cette stratégie de mise en abyme était employée dans d’autres films présentés dans le cadre de « Dans ta face », parfois dans le but de créer un rapport volontairement ambigu entre le documentaire et la fiction. C’est ce qu’on observe dans le cas de Le voleur vit en enfer (1984), réalisé par Robert Morin, film génial du répertoire québécois choisi par Dominique Dugas. On y entend un homme raconter au téléphone, à un service d’entraide anonyme, une période de sa vie dans un quartier défavorisé. Les images qu’on voit à l’écran sont celles que cet homme – qui n’existe dans le film que par sa voix – aurait lui-même capturées de sa fenêtre à l’aide d’une caméra amateur, pour éviter de sombrer dans l’angoisse. Ce film joue avec les frontières séparant raison et folie, réalité et imagination, et suscite des réflexions qui concernent aussi bien le terrain de la sociologie que celui du cinéma en tant que tel.
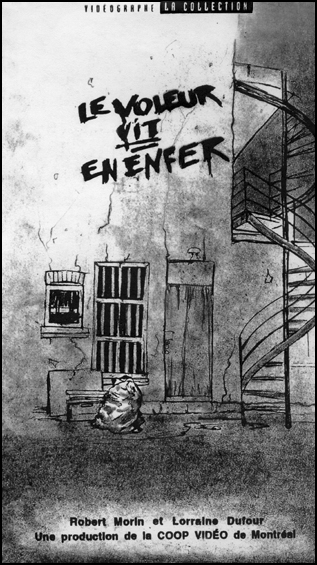
Les rapports entre documentaire et fiction s’articulent encore différemment dans L’affaire Bronswick (1978) de Robert Awad, André Leduc et Tim Reid, une présentation de Jean-Marc E. Roy. Mimant le documentaire par une narration didactique et tout en ensemble de codes, le film retrace les développements d’un scandale fictif : la mise en marché d’un téléviseur doté d’une puce spéciale incitant le téléspectateur à acheter en masse différents produits de consommation. Mais en se désignant directement comme un faux – ce que révèlent notamment certains aspects visuels comme le recours au collage – le film incite à chercher derrière les faits inventés une vérité de sens, qui réside ici dans un discours sur la surconsommation, l’alliance entre les multinationales et le pouvoir, et l’oubli dans lequel sombrent trop rapidement les fautes historiques.
Le principe de présenter une situation fictive à la manière d’un documentaire – en affichant d’emblée la nature inventée de l’œuvre – est également derrière Nostradamos (2011) de Maxence Bradley, Alexandre Lampron et Élisabeth Olga Tremblay, un court-métrage plutôt amusant dans lequel sont interrogés les habitants d’Amos, ville désignée comme le meilleur refuge face à la fin du monde imminente. Ici aussi, le film pointe, sur un mode ludique, vers certaines réalités bien sérieuses, notamment les enjeux économiques et territoriaux auxquels nous devrions faire face si un tel scénario apocalyptique se réalisait.

Des histoires brèves
Un univers de fin du monde se devine en outre dans La couleur de tes lèvres (2018) d’Annick Blanc, choisi par Maria Gracia Turgeon. Un plongeur et une femme malade semblent les seuls survivants du monde devenu subitement, et pour une raison inconnue, irrespirable. Leur fuite les conduit dans une maison où ils tombent sur le spectacle figé d’une fête interrompue par le désastre. On ne sait presque rien des personnages et de la situation, dans ce film où le langage semble devenu impossible. Les courts-métrages de fiction sont particulièrement intéressants quand ils tirent parti de la brièveté du format pour construire un récit volontairement elliptique, laissant beaucoup de place à l’interprétation du spectateur.

Or, dans certains films, tout se met en place pour nous emporter en entier dans l’espace de la fiction. C’est selon moi le cas de Lila (2000), le premier court-métrage de Robin Aubert, qui s’était vu décerner le prix de la meilleure fiction court-métrage de l’année par l’Association québécoise des critiques de cinéma. Ce film, choisi par Maxime Giroux, raconte l’histoire de Lila et de Flamme, deux punks vivant dans la rue qui jurent de s’aider et qui imaginent une vie autre, dans un impossible ailleurs. On y trouve des clins-d ’œil – comme le vol d’une robe de mariée – à l’univers de Réjean Ducharme, lui aussi épris de personnages marginaux. Tout éclairé par la performance de Joël Marin dans le rôle principal, Lila se démarque par tous ses aspects et se termine peut-être un peu trop rapidement – ce qui, dans ce cas, n’est pas un défaut mais souligne toute sa fulgurance.
« Dans ta face » permet une expérience inédite en rendant accessible un répertoire hétéroclite qui mélange les genres et les décennies sans principe fédérateur autre que celui des affinités et des influences personnelles. Dans ce jeu du hasard, les rapports et les contrastes se construisent néanmoins, d’où l’intérêt de suivre régulièrement la programmation proposée. Malgré la relative désincarnation qui caractérise un festival de cinéma en ligne, « Dans ta face » réussit à rendre présent les dialogues créatifs de l’univers cinématographique qui auraient pu facilement tomber dans l’oubli ou passer inaperçu.






