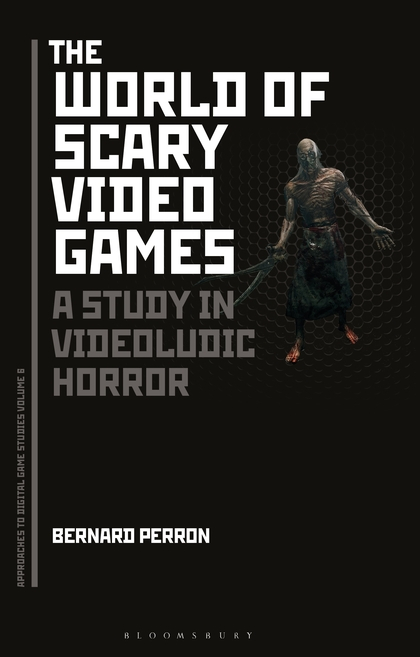Geneviève Pettersen et François Vigneault, 13e Avenue T. 1, La Pastèque, 2018, 174 p.
///
Écrite par Geneviève Pettersen (La déesse des mouches à feux, 2014) et illustrée par François Vigneau (Titan, 2017), la bande dessinée 13e Avenue raconte l’histoire d’Alexis, un préadolescent de 11 ans. On le rencontre alors qu’il revient de l’école lors d’une vague de chaleur au mois de mai. Une batte de baseball sur l’épaule, il parcoure les rues de Chicoutimi en rêvant au pain aux bananes que sa mère prépare tous les mardis. Ce jour-là, il se rend bien compte que quelque chose cloche : la maison est silencieuse, sa mère ne répond pas à ses cris ; surtout, pas de pain aux bananes en vue. Lorsque sa mère réagit enfin, la voix qu’elle prend est différente et préfigure l’annonce d’une nouvelle dévastatrice : le père d’Alexis, un électricien, est mort d’un accident de travail.

Incapable de continuer à vivre dans cette maison, dans cette ville, où tout lui rappelle son mari, la mère d’Alexis, Martine, décide qu’ils iront vivre à Montréal, sur la 13e Avenue. Quittant une maison neuve pour s’installer dans un vieil appartement, le préadolescent a du mal à s’adapter à son nouveau milieu et regrette le Saguenay. S’il est craintif et sort peu au départ, Alexis fera la rencontre d’Ernest, un garçon de son âge qui habite l’appartement du haut et qui l’encouragera à explorer Rosemont et ses ruelles. Peu à peu Alexis s’adapte à son quartier, mais Ernest lui paraît de plus en plus étrange. C’est sur la confirmation de cette impression que se clôt le tome, alors qu’Alexis perce, dans ce qu’on appellerait en langage télévisuel un cliffhanger, le mystère entourant son ami. Si on s’accorde pour dire qu’une bonne part du lectorat, adulte ou jeunesse, aura deviné le secret, la lecture n’en est pas moins agréable pour autant, et le côté convenu de la révélation n’empêche pas le lecteur.trice d’attendre la parution du deuxième tome avec grand intérêt.

Évidemment, la bande dessinée (surtout dans l’univers jeunesse) est souvent produite sous un mode de fonctionnement sériel qui témoigne de l’appartenance du genre à la culture populaire. Par conséquent, la littérature jeunesse et la bande dessinée sont souvent considérés moins considérées comme des œuvres que comme des « produits » culturels par le monde littéraire, ce qui témoigne d’un certain mépris encore entretenu aujourd’hui envers une littérature jugée de moindre valeur. Pourtant, ni la vitalité ni la qualité de ces productions ne sont à prouver au Québec : les Éditions de la Pastèque l’ont fort bien démontré dans les dernières années.
Un visuel classique et efficace
Si j’ai grandement apprécié ma lecture de l’opus, un premier contact avec l’ouvrage ne m’avait pas immédiatement convaincu. Il y avait quelques jours déjà que j’avais le livre en main lorsque je me suis décidée à le lire. Par curiosité, j’avais ouvert l’album au hasard et je n’avais pas été immédiatement charmée par les illustrations. Alors que la couverture était éclatante et toute en couleur, les pages sont, quant à elles, imprimées en noir et blanc (pratique courante, on en conviendra), dans un style plutôt propre au comics. De fait, la signature visuelle de Vigneault reste fidèle à celle de Titan (2017), son premier livre, d’abord publié en anglais chez Study Group Comics avant de trouver sa place en version française au sein des Éditions Pow Pow. Mais contrairement à cet ouvrage, qui lui avait d’ailleurs valu d’être finaliste pour le prix des libraires 2018, 13e Avenue s’adresse à un public jeunesse de 10 ans +.
Brusquée dans mon horizon d’attente, j’ai déposé l’ouvrage pour mieux le redécouvrir. Ce deuxième contact avec l’œuvre aura tôt fait de faire fondre mes résistances : je découvre un visuel touchant, sobre, mais tout en nuances. Les personnages attachants de Petterson s’animent par les soins de Vigneault. L’usage du gris nous transporte dans des flash-backs ou des rêveries facilitant la transition entre la trame narrative principale, linéaire, et les trames secondaires qui viennent l’interrompre. L’entrée en matière de l’œuvre est menée avec tant de justesse qu’elle suffit à saisir l’attention du lecteur.trice. Tout est simple, mais une attention particulière est portée aux détails. Ainsi, lorsque la mère d’Alexis lui fait part de l’accident du père, celui-ci est en train de manger une prune. Les émotions du jeune homme et celles de sa mère sautent aux yeux, mais le déroulement de cette scène vitale est constamment ralenti par des observations sur ce fruit. La scène se clôt sur une dernière planche, occupée par une seule case, où la prune à moitié mangée trône dans la main du garçon. Dans un tout petit encadré, on peut lire : «Papa est mort». Ce procédé de décentrement, utilisé fréquemment dans des comics classiques – on pourrait penser à Sin City de Frank Miller, par exemple – n’est pas aussi commun au sein de la production jeunesse.

Un rapport trouble au réel
Qu’on retrouve ce genre de caractéristiques du comics adulte dans 13e avenue est une importante qualité de l’œuvre. D’abord, elles permettent au public jeunesse de se développer en tant que lecteur.trice, mais plus particulièrement lecteur.trice de BD puisqu’illes se familiarise avec les codes du médium (dont la lecture peut parfois paraître réservée à un cercle d’initiés). Il est rafraîchissant de tomber sur un texte qui ne sous-estime pas les capacités du public jeunesse à comprendre une œuvre ou une thématique en infantilisant les objets qui leur sont destinés.
Cependant, la question du rapport référentiel refait surface cycliquement au cours de la lecture, du moins pour un public qui fréquente, de près ou de loin, les rentrées culturelles et littéraires. Dans la dédicace, Pettersen dédie le livre aux enfants de Rosemont, surtout aux siens, lesquels partagent leur prénom avec certains des personnages du récit : Alice, Sophie et Ernest. La littérature jeunesse fonctionne généralement sur le principe du leurre, c’est à dire que, derrière ces voix enfantines qu’on met de l’avant, se cache une voix d’adulte. Or, pour moi, ce jeu de référentialité, qui ne participe ici d’aucun effet littéraire, vient souligner à gros traits la présence de cette adulte qui tire les ficelles. Par conséquent, je ne pouvais pas m’empêcher de venir confondre, par moment, la mère et l’autrice, ainsi que l’enfant et le personnage. En effet, le travail de lecture devenait parfois un travail d’enquête alors qu’il me prenait l’envie, un peu voyeuse il faut l’admettre, de lever le voile sur la signification de certains passages ; s’agissait-il de la Pettersen-mère qui parlait de ses enfants ou de Pettersen-autrice qui décrivait ses personnages ?

Si Ernest est mis en scène de telle sorte qu’il échappe à la référentialité, Sophie et Alice sont représentées comme des sœurs. Le passage durant lequel Alexis rencontre la mère des deux jeunes filles, France (et non pas Geneviève), devient particulièrement inconfortable pour le lecteur.trice, qui s’affaire à démêler ce jeux de miroirs déformants. J’imagine par contre que tel ne sera pas le cas du jeune lecteur ou de la jeune lectrice, qui s’attarde généralement moins au paratexte et, par conséquent, ne tiendra pas compte du rapport référentiel : au final, ce sont eux les véritables critiques.