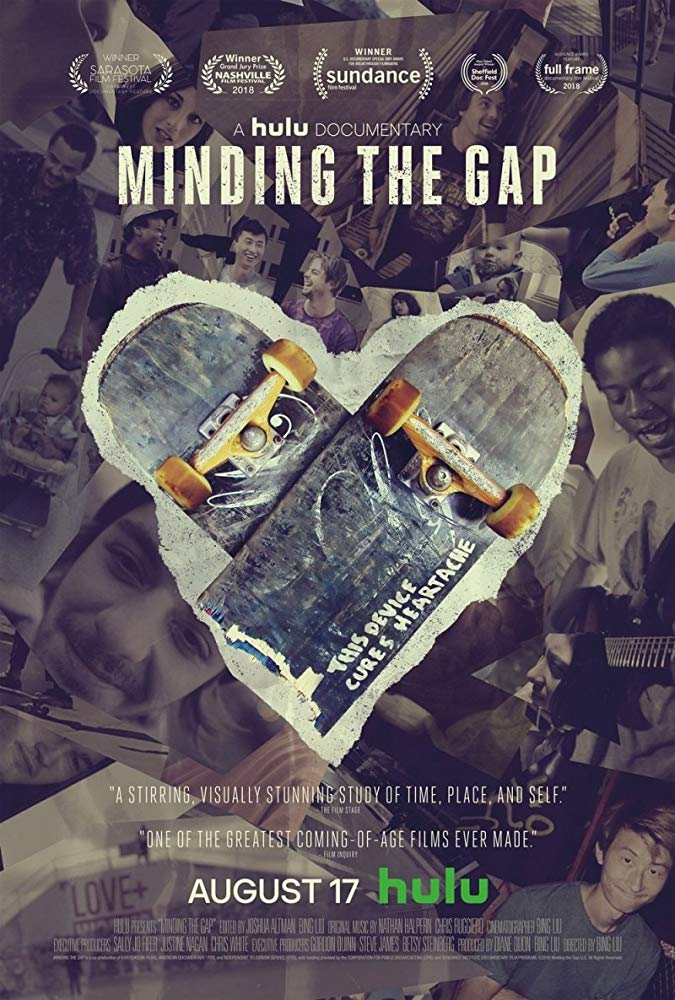Lignes de fuite, texte : Catherine Chabot ; mise en scène : Sylvain Bélanger ; avec Lamia Benhacine, Catherine Chabot, Victoria Diamond, Benoît Drouin-Germain, Léane Labrèche-Dor et Maxime Mailloux ; présenté au Théâtre d’Aujourd’hui du 12 mars au 6 avril 2019.
///
Catherine Chabot occupe une place particulière dans l’écriture dramatique contemporaine. Avec Table rase (co-écrit avec les autres actrices du spectacle) et Dans le champ amoureux, l’autrice faisait le pari d’une écriture exclusivement dialoguée, sans monologues ou apartés, où tout se passe en temps réel. À peu de choses près, le temps du récit est équivalent au temps de la représentation : pas d’ellipses, pas de retours dans le passé, rien qui n’informe le spectateur sur les personnages en dehors de ce qu’ils (se) disent et (se) font sur la scène.

Ainsi d’une écriture hyperréaliste, qui mise à la fois sur la familiarité de la conversation, mais aussi sur les références culturelles, afin de reproduire avec acuité les travers et les traits d’un milieu (social, économique, politique) ou d’une génération (celle qui a quelque part entre 25 et 35 ans). Après avoir exploré les relations d’amitié dans Table rase et la faillite du couple avec Dans le champ amoureux, Chabot offre une sorte de concentré de ces deux perspectives avec Lignes de fuite, où l’effritement d’une amitié entre amies du secondaire est appuyé par les failles de certains couples en scène.
Hyperréalisme et politique
Trois amies, accompagnées de leurs conjoint-e-s, se retrouvent pour la pendaison de crémaillère du condo montréalais de l’une d’elles. Il y a Zora et Olivia (la première travaille en finance, la seconde est artiste visuelle), qui reçoivent chez elles ; Raphaëlle et Jérémie (lui est représentant pour une compagnie de béton, elle est avocate au criminel), qui habitent toujours à Québec ; Gabrielle et Louis (elle est chroniqueuse pigiste à Radio-Canada, il est chargé de cours à l’Université de Sherbrooke). Le portrait socio-politique divers qu’offre la pièce est évocateur : les trois femmes restent unies par leurs souvenirs, refusant de voir qu’elles ne partagent rien au présent.

Catherine Chabot a un indéniable talent de dialoguiste : peu savent puncher comme elle, une réplique assassine n’attend pas l’autre et, les réactions dans la salle le confirment, elles frappent souvent juste. Elle sait également rendre avec acuité le moment de rupture : chez Chabot, la crise a lieu (ou elle est à veille de) au début du spectacle. Les relations sont déjà chambranlantes, ce qui place le spectateur dans une position inconfortable où il doit présumer (croire sur parole) que la relation a jadis pu être solide. Autrement dit, les moments de complicité montrés sont toujours inférieurs à la manière dont les personnages en parlent au passé, ce qui a pour effet de rendre la plupart des personnages surtout antipathiques.

Si Lignes de fuite signe la fin d’une « trilogie hyperréaliste », la pièce n’échappe pas à une certaine redite : plusieurs des enjeux (financiers, éthiques, philosophiques, émotifs) abordés l’ont déjà été dans les pièces précédentes, tant et si bien que Chabot reste parfois piégée par sa propre écriture. C’est bien le problème de l’hyperréalisme, soit de n’avoir rien à « proposer » au-delà de l’acuité du portrait générationnel/social : la transposition du réel à la scène peut faire sourire, grincer des dents, rire, voire pleurer, mais elle fait peut-être moins réfléchir qu’on ne l’espère.
Ceci est peut-être causé par la reprise de certaines critiques éculées (notamment en ce qui concerne les réseaux sociaux), qu’on aborde rapidement avant de passer à un autre sujet. Les sources de conflit sont nombreuses (gauche/droite, riches/pauvres, francophones/anglophones, environnement/économie, rectitude politique/éthique du care, etc.), et certainement présentes, mais elles s’enchaînent peut-être trop rapidement pour qu’il soit permis de brosser un véritable portrait générationnel ou social, si ce n’est pour dire que les générations sont des blocs moins immuables qu’on ne le prétend.

Miroir, miroir…
Pour accentuer cet hyperréalisme, Sylvain Bélanger a choisi un décor faste dans une disposition frontale (au contraire des pièces précédentes de Chabot, présentées en bi-frontal), peut-être pour donner l’impression d’observer ces êtres comme on observerait des animaux dans une cage. Les gigantesques et nombreux miroirs, placés en différents angles au fond de la scène et au plafond, multiplient les corps comme autant d’images et surfaces de projection d’eux-mêmes, mais aussi les points de vue que les spectateurs peuvent avoir sur eux.
Dès l’entrée en salle (et même pendant l’inévitable message d’accueil nous invitant à fermer nos cellulaires), on parle et on danse dans le grand condo luxueux de Zora. La scène est décorée dans un style « urbain vintage chic » qui laisse deviner sa valeur sans trop en jeter plein la vue – suffisamment pour signaler l’aisance financière de Zora – qui dérange tant ses amies – mais pas assez ostentatoire pour qu’on lui reproche son mauvais goût.

Une telle écriture ne peut fonctionner que si les interprètes s’en emparent avec tout le naturel possible. À ce titre, tous jouent leur partition avec aisance, réussissant à rendre chaque archétype – l’intello mal à l’aise socialement, le « gars de Québec », l’artiste ésotérique, l’avocate psychorigide et contrôlante, etc. – tout en lui donnant une couleur singulière.
Plus que les failles que révèlent les personnages en cours de route ou la nature des opinions qu’ils expriment, c’est la manière de les révéler qui captive. La véritable opposition, au bout du compte, se fait peut-être entre les cyniques et les optimistes, ces derniers ayant l’air plus ou moins quétaines (ou naïfs) selon notre propre degré de cynisme, nos propres lignes de fuite.

crédits photos : Valérie Remise