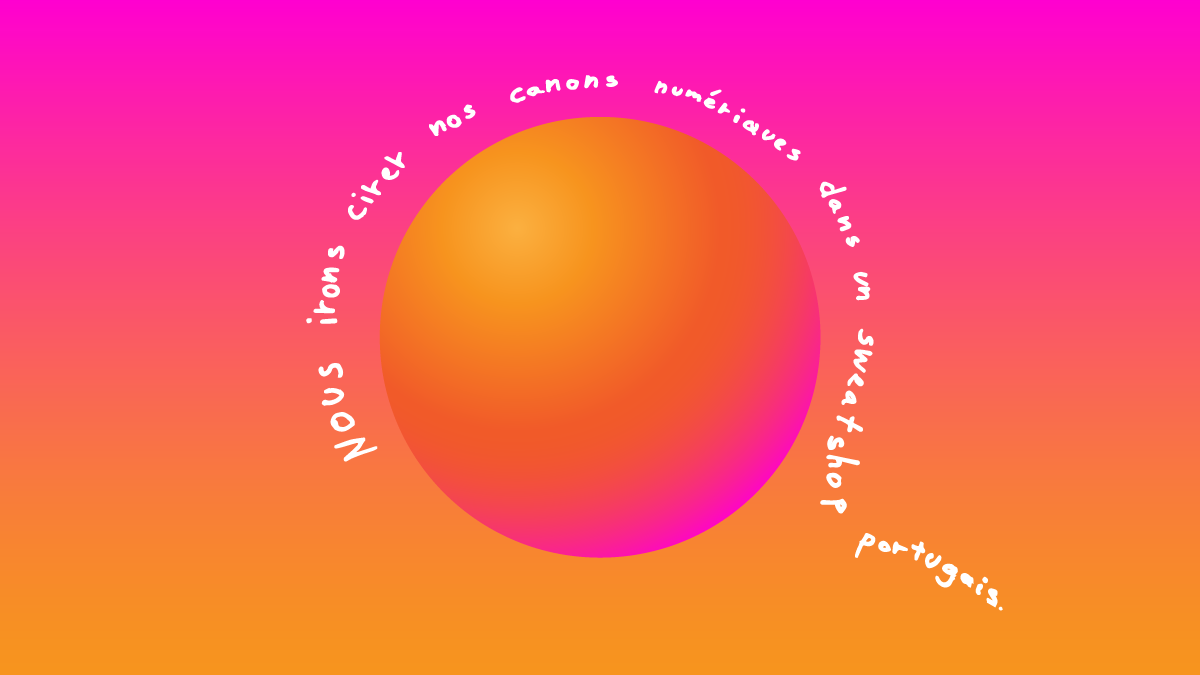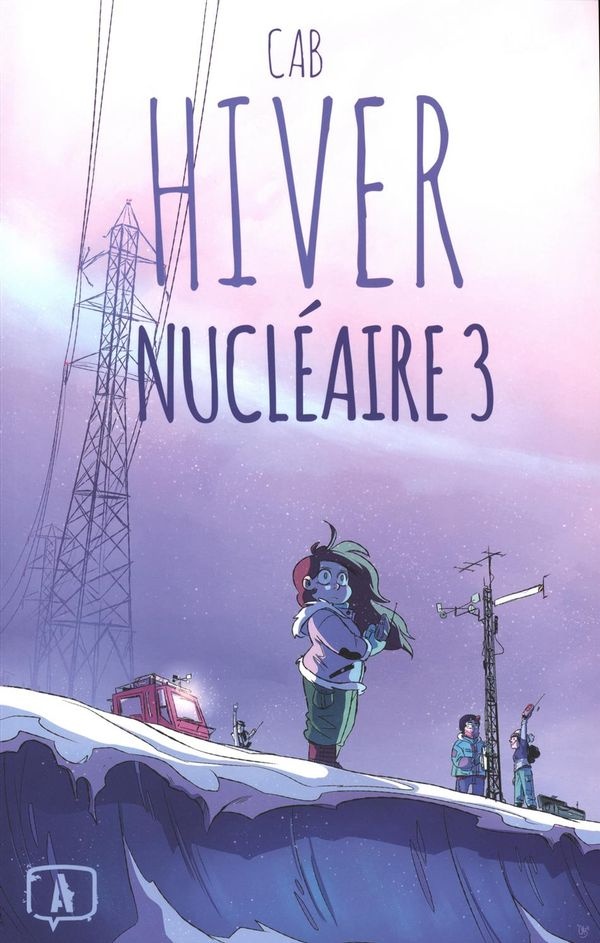Nous irons cirer nos canons numériques dans un sweatshop portugais. Texte de Maxime Brillon, mise en scène de Justin Laramée ; avec Maxime Brillon, Marjorie Gauvin, Marie-Ève Groulx, Karlo Vince Marra, Lise Martin, Louis-Olivier Mauffette, Frédéric Paquet et Joakim Robillard ; conception et collaboration Hubert Leduc-Villeneuve, Carl-Matthieu Neher et Olivia Pia-Audet ; présenté au théâtre Aux Écuries (Montréal) du 26 février au 16 mars.
///
Dans une banlieue lointaine, Gatineau mettons, des adolescents vivent les derniers balbutiements de YouTube après plus de 25 ans de junk qui en ont saturé les serveurs. Le monde en paraîtrait quasiment apocalyptique, si ce n’était de l’humour de la pièce qui nous informe que cette vaste entreprise d’archivage de nos niaiseries est finalement un peu mignonne, et qu’elle témoigne au fond de la pulsion du même qui propulse l’humanité.
Le prétexte de la pièce, produite par le collectif des Canons numériques en collaboration avec Tôle, se trouve précisément sur une archive YouTube : une cascade d’un jeune homme dans un escalier qui se termine par une split pas piquée des vers, laquelle se conclut, à terme, par la perte des testicules du cascadeur – on ne peut qu’en imaginer les détails. Le choc cognitif lié au visionnement d’une telle vidéo est vite relativisé – Paulo et Chris, les adolescents, en ont vu d’autres –, au profit d’un choc des origines : Paulo reconnaît son père, plus de vingt ans plus tôt, son père qui perdait alors sa capacité reproductive, son père qui soudain ne pouvait plus être son père. L’archivage de Youtube devient le révélateur d’un passé peu glorieux, digne d’un Darwin Award.
Prétexte, disais-je : cette pièce se refuse à suivre quelque ligne que ce soit, elle bifurque sans cesse, du micro – dans le fil des discussions, on passe du coq-à-l’âne – au macro – dans la quête des personnages, on passe d’une volonté féroce de fonder son identité à une visite au zoo. De même, les premiers temps de la pièce sont portés par un procédé métafictionnel intégrant un narrateur/régisseur à même la scène, qui commente, surgit entre les personnages pour en mimer les actions, etc., mais qui se fait vite discret, une fois le rythme de croisière adopté. Choix judicieux.
L’exemple type de cette discontinuité intrinsèque à Nous irons cirer nos canons numériques se retrouve dans ce laïus de Frank, consultant informatique de 41 ans et père protecteur de Jeanne. Attifé d’un chapeau de cowboys et d’une sorte de lavallière, l’accent doucereusement « Québec profond », érigé dans la posture décontract idoine – pouce dans la poche revolver, autre main portant une improbable tasse de café –, il débite ses conseils à la « Robin Williams » – heureux mélange entre le psy Sean Maguire de Will Hunting et du professeur Keating de Dead poet society. Longuement, il parle de l’éthique de nos cybermanières au xxie siècle, du rapport entre un père et sa fille, de la vie, en général, qu’il faut savoir domestiquer. Mais ce laïus, porté par la musique inspirante qu’on imagine, est façonné dans le décrochage, dans les interruptions, parmi lesquelles (les plus importantes pour la pièce) on compte les notifications de messagerie texte issus du téléphone de sa fille. Frank lui-même, de toute manière, finit par s’interrompre : « Ce que je veux te dire », conclut-il, à l’apogée de son éloquence, avant de se taire, d’éluder d’un « bref » final ce qu’il n’a pas su dire. La niaiserie aura raison de toutes les profondeurs.

Le message
Nous irons cirer nos canons numériques enfonce volontiers son message, qu’il fait glisser sur les signifiants. Dans les premiers temps de la pièce, Paulo s’irrite du mot « fif » que Chris utilise « comme des virgules » dans ses phrases, et il va plus loin : le binarisme même que sous-tend le mot fif, catégoriel, lui paraît inacceptable. Paulo aime à penser le monde comme un cercle, sans frontières strictes. Or, ce binarisme décrié se mâtine d’une autre signification, celle du « code binaire » propre à l’informatique : on en a alors contre les algorithmes, contre l’asservissement à la technologie, contre la perte des expériences – on aurait pu parler d’aura, avec Walter Benjamin. « Au fond, au plus profond, tout est cercle », déclame Paulo vers la fin de la pièce, s’étant rendu au bout de son joint. Le binarisme est une invention qui nous aliène.
D’un point de vue idéologique, la pièce ne sait ici éviter l’évidence : dénoncer la colonisation de nos existences par la technologie revient toujours un peu à désirer un passé-futur tribal, communautaire, connoté par la grand-maman – on réfère à la grand-mère plus de trois fois dans cette pièce, toujours en terme de douceur, de chaleur humaine. Tout de même, ce discours rétro, post-pré-moderne, n’est jamais endossé très sérieusement, et on dit non et oui à la vertu du passé, non et oui aux possibles du futur. Même en s’attaquant au binarisme, on évite le binarisme. C’est dire que dans la pièce, le binarisme est fait de camps tranchés, 0 :1, homme, femme, homo, hétéro, et le cercle seul, qui accueille les opposés, permet de refonder une sorte de vivre-ensemble. Oui et non, donc : ce sont les derniers mots prononcés avant la tombée du rideau.
Légèreté
En prenant pour thème le déclin de YouTube, alourdi de sa niaiserie, Nous irons cirer nos canons numériques ne se prive pas de sa propre bêtise. Car il faut bien le dire, le trait principal de cette production à tous égards enthousiasmante, c’est son humour, lequel sature la trame – on atteint presque le ratio d’une ligne pour un punch. Des calembours potaches, des acrobaties burlesques – les personnages se frappent violemment contre les murs et tombent comme des oiseaux heurtant une baie vitrée –, des quiproquos libidineux, mais aussi des blagues raffinées, ou en tout cas à l’effet moins direct, suffisent à une bonne décharge de rire. Se retrouve alors une sorte de facilité agréable, qui fonde la connivence : à la fin, on rit un peu d’exaspération devant la facilité des procédés, amusés tout de même par le jusqu’au-bouttisme de la niaiserie qui achève de nous enrôler. Un peu comme YouTube, au fil des ans. On atteint en effet cet aspect méta au fil de la représentation, réalisant que les termes du numérique et les aspects de l’expérience spectatoriale du consommateur de YouTube – la discontinuité, la proximité décalée, l’imbécilité comme procédé d’humour premier – structurent l’univers du récit qu’on se fait raconter. Cette rencontre fortuite entre une plateforme de partage vidéo et le théâtre – entre un canon numérique et un sweatshop portugais – nous fait ressentir, ontologiquement, le décalage des représentations soumises à l’algorithme aléatoire du World Wild Web.
crédits photos : Pierre Dion-Bisson