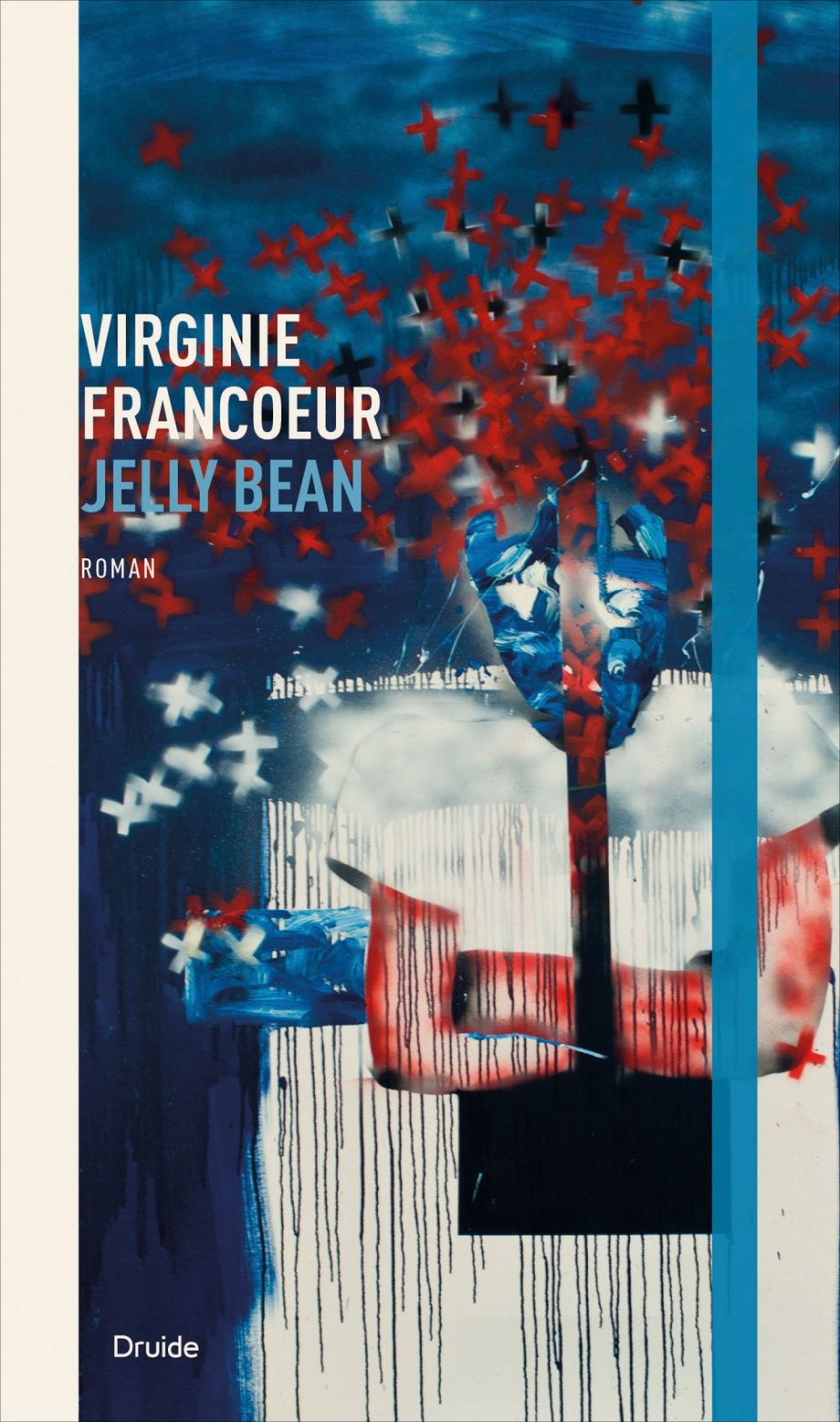The Mountain, the Truth & the Paradise, une production de la compagnie Mal Pelo ; direction et interprétation : Pep Ramis ; espace scénique : Pep Ramis, Maria Muñoz ; création sonore : Fanny Thollot ; création lumières : August Viladomat ; costumes : CarmepuigdevalliplantéS ; une coproduction de l’Agora de la danse, du Festival de Tardor de Catalunya Temporada Alta 2017 et du Centre de Création Mercat de les Flors de Barcelona. Présenté à l’Agora de la danse (Montréal) du 21 au 24 novembre 2018.
///
Disons-le d’emblée, l’apport de la parole dans les spectacles de danse constitue un défi de taille peu souvent réussi. C’est une chose de manœuvrer son corps dans un dessein artistique, mais utiliser l’organe vocal comme une partie de ce corps dansant est un tout autre talent. Or dans ce spectacle de Pep Ramis, qui compte le chant, le violoncelle et la marionnette au nombre de ses talents, acquis au cours de sa formation pluridisciplinaire, on se rendra vite compte que la voix constitue l’élément central. The Mountain, the Truth & the Paradise prend ainsi une allure de conte philosophique, dont la narration prend diverses formes vocales, et dans lequel le geste prend de l’ampleur, s’amorçant lent et minimaliste pour se clore une fois le corps investi en entier. De nombreux tableaux s’accolent pour mettre la métamorphose en images : le corps recroquevillé, le corps debout, le corps tournoyant, puis à la course, couché, assis, dessinant, racontant… Et comme un mince fil rouge qui ferait tenir la pièce, la voix de Pep Ramis entre en parfaite communion avec sa gestuelle, apportant une dimension supplémentaire à l’interprétation.

Dans cette longue gradation, la lumière s’ouvre sur une scène complètement blanche, pâlie à la craie, ce qui lui donne une allure de neige, ou encore d’une plage au sable blanc. La substance tache le costume au fur et à mesure que le danseur intervient avec les décors. Au commencement, Ramis est assis, côté cour, à un petit bureau d’écolier, placé tout contre l’étendue blanche où, on le devine, il ira danser une fois sur scène : son premier tableau, minimaliste, abonde de poésie et d’évocation. Nous le voyons de dos, tête baissée (donc cachée), main gauche cachée ; il reste debout et sans bouger, si ce n’est sa main droite, qui passe derrière son dos et qui se meut subtilement. Le plexus de la main, la paume, transforme le poing en main ouverte, dans un engagement total mais complètement ténu. L’image est tellement forte, comme si la main devenait un cœur, vu de dos, ouvert et inversé, que la transition suivante, où sont impliqués les bras et les mains, semble d’une gestuelle moins inspirée, plus fabriquée, par moments rendue maniérée par des tournoiements dans l’espace. Après une amorce aussi captivante, l’attention se disperse, si bien qu’on a l’impression que le danseur manque d’assise au sol, et qu’il utilise celui-ci davantage comme un accessoire de décor que comme un élément essentiel insufflant de la puissance à son corps par les pieds.
Puis surgit la parole
Et on se rend compte qu’on s’était trompé. C’est que l’assise de Ramis trouve son origine dans la voix, et pas nécessairement au sol, comme chez la plupart des danseurs. Sa voix elle-même compte diverses sources, que ce soit le ventre, la gorge, la tête, le cou, le plexus. La façon dont il parvient à l’utiliser, et qui le distingue spectaculairement, lui donne un élan qui provient de l’intérieur, de son intimité et de son émotivité, qui appuie le propos de sa pièce et lui donne une grande force.

Avec la voix vient la parole, avec la parole suivent les textes, puis l’amour. Alors qu’il déclame de la poésie (« J’attache de la valeur à… être reconnaissant pour quelque chose qu’on a oublié / deux personnes âgées qui s’aiment… ») toutes ses articulations se délient : petits gestes des poignets, chevilles, épaules, cou, il se déplace comme un boxeur dans l’arène, qui enfile ses protections, se défait de sa robe, embarque sur le ring. Du ciel, on lui jette d’ailleurs ses chaussures, et la folie s’empare de lui dès qu’il les enfile ; il soliloque (en catalan ?), devient possédé du diable, comme dans le conte auquel la danse avait auparavent fait une si belle part. L’éclairage jaunit, l’artiste se replie sur lui-même, la trame sonore rend uniquement l’écho de pas anonymes, qui redoublent ceux du danseur alors qu’il s’emballe, fait le tour de la scène en claquant des pattes – cla-clac, comme les adeptes du flamenco, dont l’affirmation passe par le rythme et le claquement des talons. Il court en cercles, comme s’il se trouvait dans une arène, et la craie du sol se soulève. Quand il s’épuise, la lumière, devenue bleue, accompagne ses paroles, à nouveau adressées au quatrième mur : « I’m falling / hold me ». Puis il tombe, mais demeure infatigable ; accoudé au sol, il se met à chanter.
Après la moitié de la pièce, la voix a déjà connu plus de quatre stades différents : de déclamation, elle passe à soliloque, à supplication, puis à chanson. Ces états continueront à se démultiplier, jusqu’au point culminant du conte. Ramis s’assied au bureau d’écolier, dessine pour appuyer, d’une projection murale simultanée, le conte de l’homme qui recherchait la vérité en gravissant une montagne. Au final, c’est l’impression la plus forte, celle qui restera gravée en nous. Elle dominera celle d’avoir eu beaucoup à assimiler en une heure, surpassera les nombreux registres très différents et les (tout aussi nombreuses) interventions techniques (qui passaient pourtant inaperçues) : on se rappelle les mimiques et les rires caricaturaux, les poèmes (et le texte de Erri de Luca), les innombrables états de corps, prenant par moments l’allure de personnages, soutenus par des éléments de costumes ou de décor et, bien sûr, par des modulations de la voix. Mais la clef de lecture, on la trouve dans ce conte de l’homme qui cherche la vérité en gravissant la montagne : tout est up and down, tel que le répète Ramis dans plusieurs langues. Comme la montagne, et même comme lui, le danseur, qui se verra suspendu pour chanter ; comme la voix qui s’élève, qui monte et descend, comme les corps, qui se lèvent au quotidien ou qui grandissent jusqu’à s’effondrer – qui spirituellement, aussi, s’élèvent, se couchent. S’il est bien une chose dont Ramis est certain, en vérité, c’est que tout est une question de verticalité, de rapport entre le bas et le haut, entre ciel et terre.

crédits photos : Jordi Bover.