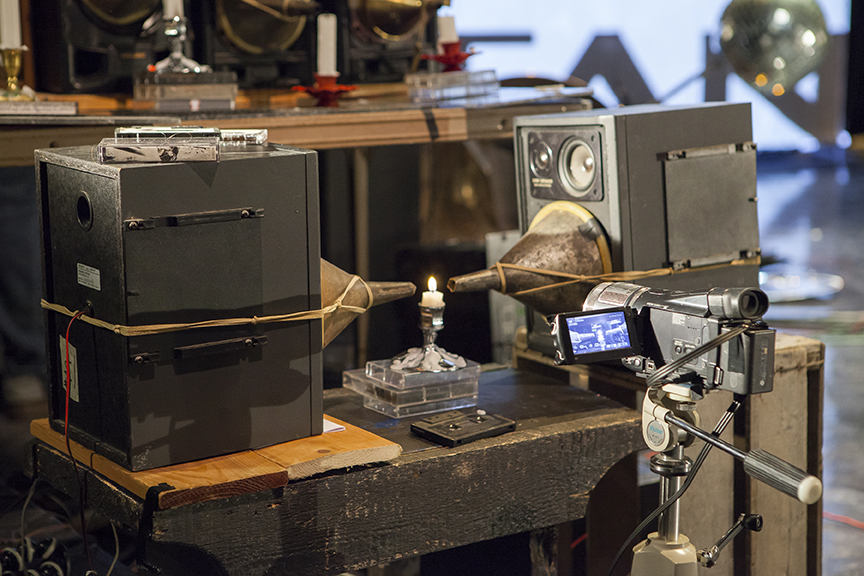Pour, chorégraphie et scénographie : Daina Ashbee ; interprétation : Paige Culley ; musique : Jean-François Blouin ; lumières : Hugo Dalphond. Un spectacle de Daina Ashbee présenté au théâtre La Chapelle du 2 au 4 juin.
///
C’est à partir du cycle menstruel que la jeune chorégraphe métisse Daina Ashbee a décidé de travailler la pièce Pour, qui est présentée cette semaine pour une seconde fois, dans le cadre du Festival TransAmérique (FTA.) Pour comme dans verser, en anglais. Un titre qui tranche d’emblée sur la contradiction entre les mouvements de rétention et d’épanchement qui sous-tendront la pièce.
On entre en salle dans la noirceur et le bourdonnement sourd des spectateurs qui affluent. Une silhouette est à peine visible, on perçoit seulement un reflet de lumière sur la peau. Le sol semble incandescent dans la noirceur. Un cri, de plus en plus grinçant, se fait entendre à répétition. Tout est mis en place pour que déjà, le rituel commence. Une fois le silence fait, la silhouette s’approche, se déplace latéralement dans le noir, on se sent épié par ce corps sans visage. Il y a quelque chose d’animal dans son comportement. Puis, une lumière crue est jetée sur la salle. Les spectateurs se cachent les yeux, aveuglés. Pourtant elle se tient là, à demi nue, debout dans un face à face tranquille avec le public. Pendant que les yeux s’habituent lentement à cette vibrante clarté, que les bras qui s’étaient levés pour s’en protéger se baissent un à un, elle, demeure immobile comme une image. Elle semble calme, presque absente. Au ralenti, elle retire son pantalon, d’un geste mécanique, très lent, le remonte, bouge, l’enlève à nouveau, le mouvement s’éveille et bientôt elle se transforme sur le sol, elle devient le cycle.

Loin de nous entraîner dans les topoï sanguinolents du thème, la chorégraphie s’organise plutôt autour d’oppositions de concepts davantage liés aux sensations et aux différents états du corps menstrué. Ce qui est versé ici n’est pas le sang, c’est plutôt l’énergie, la lumière sur le corps huilé de la danseuse, son reflet sur le sol, le mouvement : l’enroulement du corps sur lui-même, dans une longue ronde au sol à travers laquelle ce corps trouve peu d’appui, se contracte, se laisse déplier, à mi-chemin entre l’animal sauvage et la larve. C’est une transe aussi : le corps est possédé ; les coudes, les cuisses, le ventre tour à tour laissés tomber, laissés rebondir pour créer un rythme, très près du battement du sang dans la douleur. La danse est accompagnée d’un grondement sourd, parfois grinçant, tantôt soutenu d’une trame sonore, plus tard projeté par un grognement guttural de la danseuse. Ce grognement se transformant en cri, comme un appel au rituel ou à quelque comportement animal. Quelques pauses ponctuent la pièce et laissent tomber des moments de repos où le corps nu se fond dans l’espace. Tout à propos des règles est illustré dans Pour par des détails magnifiés, amplifiés, reproduits et représentés dans un incessant tiraillement entre la rétention et l’abandon du mouvement et de la voix.

Il faut mentionner l’hypnotisant travail d’interprétation de Paige Culley ; depuis son regard, qui semble provenir d’un endroit lointain jusqu’à la transe du corps. Elle impressionne par ce qu’elle parvient à laisser couler dans l’extrême lenteur comme dans la brusquerie, à force de retenue et de constance. Elle fait preuve d’une grande maîtrise de ses gestes et envoûte par sa présence, nous enroule avec elle dans ce cycle du corps qu’on voudrait infini.
Si le sujet est abordé avec une grande complexité, les procédés mis en œuvre pour le représenter sont plutôt simples et rudement efficaces. Il s’agit d’un jeu de répétitions, ramenant au cycle, à ce qui revient inlassablement. Les gestes d’apparence assez neutres sont posés frénétiquement, avec affront. Rien n’est pourtant donné au spectateur. Il lui faudra apprivoiser cette ronde avant de pouvoir comprendre et sentir ce qui s’y joue dans la retenue.
On finira en effet par s’y abandonner. Petit à petit. À force de présence de ce corps, magnifiquement habité par l’interprète. On finira par s’y enrouler. Mais il faudra s’habituer à la lumière aveuglante, au langage tordu du corps, au cri, tantôt laissé pour le silence des membres en mouvement, au fracas de la chair et des os sur le sol mouillé. Rien n’est donné : tout agit comme si chaque élan devait passer par un rituel qui invite au sacré. Ce corps en transe finira par résonner jusqu’aux bancs, nous prendra nerveusement dans son cycle de mouvements, jusqu’à nous donner des pétillements dans les jambes et une sourde douleur dans le bas du ventre.
crédit photos : Alejandro Jimenez