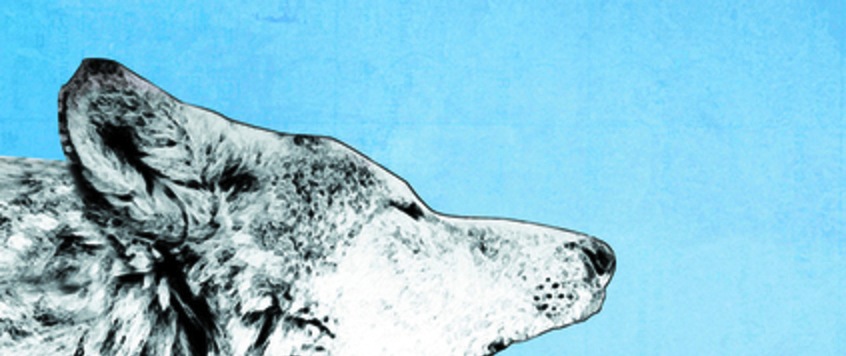Une femme à Berlin, texte de Marta Hillers, traduction de Françoise Wuilmart, mise en scène de Brigitte Haentjens, adaptation de Jean Marc Dalpé, avec Évelyne de la Chenelière, Sophie Desmarais, Louise Laprade, Frédéric Lavallée et Évelyne Rompré. Présenté au théâtre Espace Go (Montréal), du 25 octobre au 19 novembre 2016 et au Théâtre français du Centre national des arts (Ottawa) du 30 novembre au 3 décembre 2016.
///
«Maintenant, je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes.»
— Paroles attribuées à Vishnu dans la Bhagavad-Gita
«Je suis une maison qui vomit ses habitants»
— Emmanuel Cocke, Louve Storée
Vingt ans déjà que Brigitte Haentjens a fondé Sibylline, la compagnie avec laquelle elle a pu donner corps à quelques-unes des voix les plus graves de la littérature : Bernard-Marie Koltès, Heiner Müller, Sylvia Plath, James Joyce, Sarah Kane, Virginia Woolf, Marguerite Duras. Des figures exploratrices de la souffrance, du mal-être et du pouvoir de la prise de parole, si désespérée soit-elle. L’écrivaine et metteure en scène ne l’a jamais caché, son entreprise est celle d’un décloisonnement du verbe. Et en amont de cette profération intéressée, se trouve la constante question de l’asservissement et du rapport au corps et à la sexualité.
Difficile alors d’imaginer un texte plus porteur d’un dire en adéquation avec l’entreprise d’Haentjens qu’Une femme à Berlin, le témoignage de la journaliste allemande Marta Hillers, qui chroniqua, du 20 avril au 22 juin 1945, la vie quotidienne berlinoise, au moment des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, alors que l’Armée rouge venait d’envahir la capitale du Troisième Reich.
Demeuré orphelin jusqu’en 2003, lorsque Jens Bisky, rédacteur au quotidien Süddeutsche Zeitung, leva le voile sur l’identité de son auteure, Une femme à Berlin porte en lui la charge du cri étouffé de victimes dont les noms se contorsionnent encore aujourd’hui pour se tailler une place entre les monuments et les biens matériels, lors du dénombrement des «casualties of war».
Une dérangeante sobriété qui se heurte aux propos
Loin d’être une transposition réaliste du texte, l’adaptation signée Jean Marc Dalpé — partenaire de création d’Haentjens depuis ses débuts au Théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury — répartit les mots entre quatre interprètes porteuses de différentes sensibilités. Elles s’avèrent néanmoins prisonnières d’une même condition, d’un même sabot, celui d’être femme en temps de guerre. Une condition que leurs chaussures identiques et leurs robes taillées à la même longueur, aident à rappeler.
Dans ce Berlin que l’on découvre sous les déflagrations sourdes, la sobriété du décor accompagne le choix délibéré de la metteure en scène de dire la barbarie (en trois langues, par moments plus ou moins maîtrisées) plutôt que de la reproduire. Exit les mains encrassées des militaires russes, leurs véritables voix et leurs actes qui, additionnés à ceux des alliés, auront résulté en près de 2 millions de viols durant l’occupation soviétique.

Évelyne de la Chenelière, Sophie Desmarais, Louise Laprade et Évelyne Rompré se répartissent la tâche de mimer et d’incarner, parfois avec détachement, parfois avec violence et parfois avec résilience, un mal dont le paradoxe repose sur l’idée qu’on le croirait impossible à perpétrer en si peu de temps, mais d’un autre côté, impossible à supporter aussi longtemps. « 2 millions de viols »; la statistique voudrait nous échapper mais ricoche d’un tympan à l’autre comme les boules d’une pendule de Newton.
«Combien de fois vous ont-ils…?»
Dans un entretien avec le metteur en scène Florent Siaud (cofondateur de la compagnie Les songes turbulents, à qui l’on doit le 4.48 Psychose, de Sarah Kane, présenté en 2016 au Théâtre La Chapelle), Haentjens soulignait : «Quand on lit le livre, on ressent l’ironie de celle qui écrit. Mais quand on met le texte en scène, on sent que la douleur est finalement très présente. Le fait de l’incarner change complètement notre perception du texte.»
En effet, les choix de Dalpé et d’Haentjens se répercutent dans la manière dont certaines observations caustiques, comme celles sur la chute du Troisième Reich («Je suis assise sur un tabouret devant notre feu de bois, chichement alimenté de littérature nazie. Si tout le monde fait comme nous — et tout le monde le fait — le Mein Kampf d’Adolf va devenir une rareté, convoitée des bibliophiles
/01
/01
Marta Hillers, Une femme à Berlin, Paris, Gallimard, 2006, p. 201.
.») ont été laissées de côté au profit de préoccupations plus près de la corporalité. En font foi l’insistance sur les blagues grivoises des Russes, répétées à plusieurs reprises par les interprètes, au sujet de l’étroitesse du sexe des Allemandes, et les descriptions du froid et du manque de nourriture, dont la force pourrait percer de nouveaux trous dans les semelles du narrateur de La Faim, de Knut Hamsun.
L’impensable fatalité du «viol domestique plutôt [que du] viol sauvage, la moins pire des solutions» (selon les mots d’Haentjens, en entrevue avec Le Devoir) demeure de loin la plus atterrante question soulevée par le texte. Celle-ci s’exprime par cette phrase qui résume le sort de milliers de victimes : «C’est clair : ce qu’il nous faut ici, c’est un loup qui tienne les loups à l’écart.» Le sempiternel « Entre deux maux, choisir le moindre », répété en période d’élections, prend soudainement des airs plus sordides.
L’irrecevabilité de ces gestes et le tabou engendré par ceux-ci au sein d’une société allemande qui allait bientôt devoir composer avec les séquelles de la victoire des Alliés s’illustre à travers l’incrédulité et le détachement dont fait preuve le mari de la journaliste (joué par Frédéric Lavallée) lors de son retour à la maison. Des réactions inutiles au plan diégétiques, mais impeccables au plan symbolique.

Avec un peu de chance, le haut-le-cœur provoqué par la compréhension de l’ampleur du phénomène décrit par la pièce aura permis à quelqu’un de l’auditoire d’expurger son souper au visage du membre des forces constabulaires qui aurait confié à l’animateur Jean-François Fillion, à propos des récents événements de Val-d’Or : «Je regarde autour de moi, [les policiers] c’est tous des beaux gars […] mettons que là-dedans, il y en a qui ont envie de tromper leur femme. Je veux pas être méchant, mais ils feront pas ça avec quelqu’un qui a sans doute des problèmes d’hépatite […] des dents pourries […] le terme qu’on va utiliser : déboitées. Vraiment maganées.» Peut-être faut-il être un loup pour tenir les autres à l’écart. Une chose est sûre, il faut être un porc pour savoir en reconnaître un autre.
crédit photos : Yanick MacDonald