Pascal Gélinas, Montréal blues, Ateliers du cinéma québécois, 1972, 99 min.
///
« La reine savait que le miroir ne mentait pas… »
– Extrait de Blanche Neige et les sept nains
« Tout le pouvoir de l’art est de créer des copies si parfaites du monde dans lequel nous vivons que la fiction en vient à occulter le réel ».
–Guillaume Lafleur, Pratiques minoritaires, Fragments d’une histoire méconnue du cinéma québécois (1937-1973)
Le festival Fantasia clôturait cette année sa 19e édition avec la projection de Montréal blues, de Pascal Gélinas, un film qui venait clore le cycle «Genres du pays », durant lequel avaient également été projetés Scandale (Georges Mihalka, 1982), La lunule (Harvey Hart, 1973) et Les yeux rouges (Yves Simoneau, 1988).
D’entrée de jeu, lors de la présentation du film, entre les dithyrambes de Claude Fournier pour le mécénat de Québecor et les quelques mots d’introduction du réalisateur, fils du père du théâtre québécois Gratien Gélinas, le commissaire Marc Lamothe mentionnait que Montréal blues a échappé de justesse à la disparition. Le film produit par Jean Dansereau, qui avait connu une courte vie en salles, lors de séances de minuit, était devenu introuvable, malgré sa valeur de relique du Grand cirque ordinaire et son court périple à la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema de Rome, en 1972.
Coup de théâtre, à la mort du producteur, son épouse a découvert des boîtes rouillées dans la shed. Des boîtes verrouillées par la corrosion. On aurait voulu trouver meilleure image pour notre mémoire cinématographique que personne n’y serait parvenu.
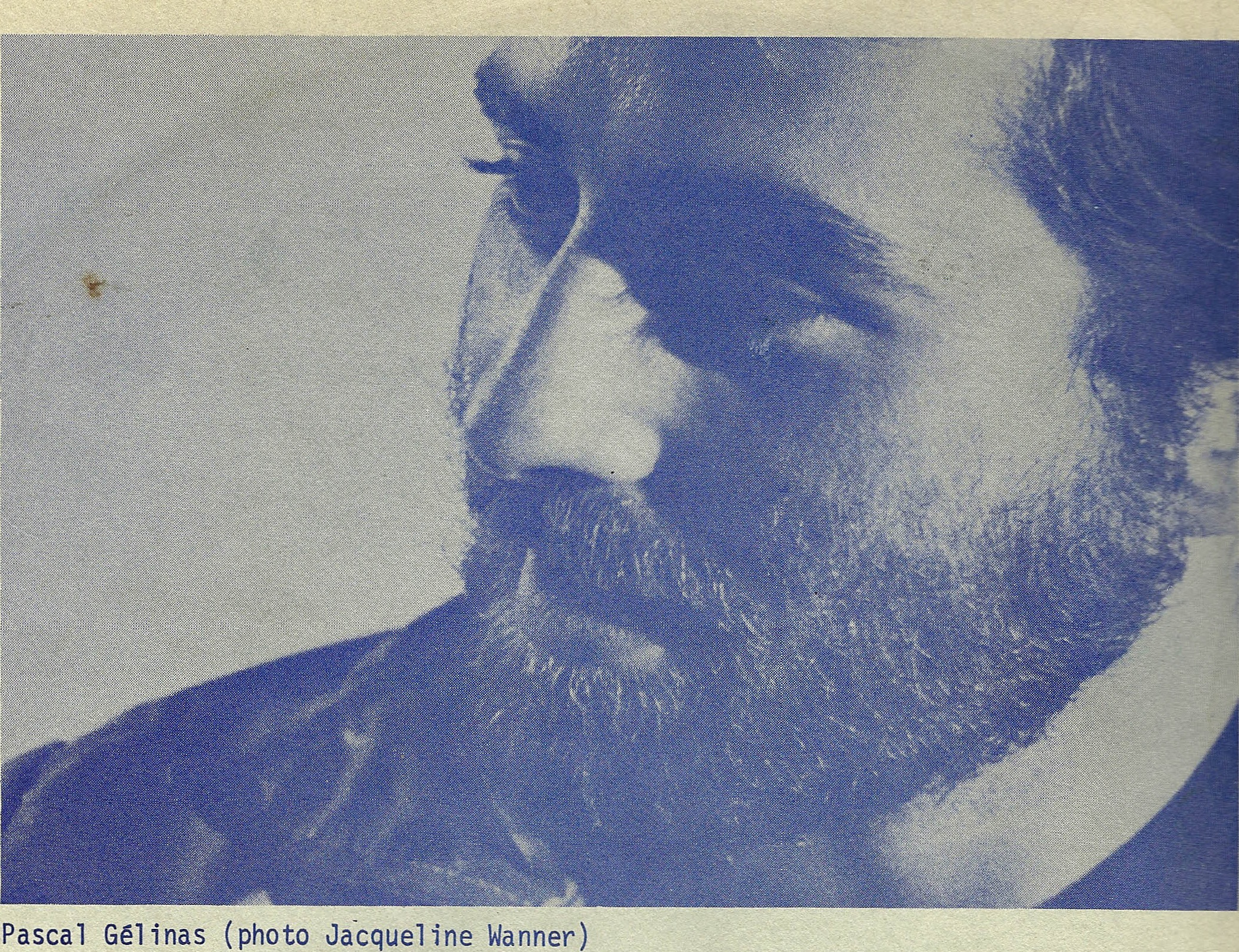
Tourné en super 16 – une technique que Mireille Dansereau avait été la première à utiliser au Québec, pour son film La vie rêvée –, Montréal blues fait figure de mise en corps de la fascination de Pascal Gélinas pour le Grand cirque ordinaire, une troupe issue du Théâtre populaire du Québec, qui avait pris le contre-pied du milieu dès sa fondation, en 1969.
Au sujet du Grand cirque ordinaire, Raymond Cloutier (membre fondateur, avec Paule Baillargeon, Jocelyn Bérubé, Suzanne Garceau, Claude Laroche et Guy Thauvette) confiait à Stéphanie O’Shea, en 1988, dans la revue Copie Zéro :
Nous considérions le théâtre québécois comme aliénant pour l’acteur parce qu’il n’y avait pas de possibilités pour nous d’investir dans ce théâtre. Aliénant pour l’artiste, le créateur, parce qu’on avait passé trois ans dans des écoles à se préparer pour raconter des choses qui ne nous ressembleraient jamais
/01
/01
Disponible au http://collections.cinematheque.qc.ca/wp-content/uploads/2013/10/CZ_1988…
.
Reposant sur un scénario de Gélinas, étoffé par Raymond Cloutier et Claude Laroche, Montréal blues met en scène tous les membres du Grand cirque ordinaire dans des rôles d’adulescents évoluant dans un espace marginal aux frontières floues, entre réel et fiction. Les personnages portent tous leur véritable prénom et fréquentent des lieux de l’époque maquillés. On y retrouve Josée Yvon en cuisinière, Paule Baillargeon en chanteuse, Gilbert Sicotte en chauffeur de taxi stoner et Jocelyn Bérubé en musicien au coude léger.
S’immisçant au travers des joints puffés avec Gilbert, des disques de Buffy Sainte-Marie et des moments passés au restaurant Montréal blues, les différends philosophiques au sein du groupe finissent par avoir raison d’une mollesse idéologique servant d’inspiration à cette commune urbaine. Le protocapitalisme à visage humain et l’idéologie collectiviste rencontrent alors la désillusion.
Sacré vaccin contre l’envie d’ouvrir un espace communautaire pour y popoter du manger bio, Montréal blues est avant tout une série de vignettes soulignant la constante opposition entre les personnages, les couples, les sexes, la vie urbaine et la vie de campagne. Des vignettes curieusement apolitiques pour leur époque, où la seule figure « adulte » que l’on croise en 99 minutes est celle d’un croulant poli et coincé, pas trop certain de vouloir se prendre les pieds dans un restaurant où il ne peut nommer les légumes dans son assiette.
La chaudrée de tapoche qui a précédé le tout
Ironiquement, Gélinas est peut-être le premier cinéaste de sa génération à avoir tourné un film explicitement « politique » (en collaboration avec son ami Pierre Harel), en 1968 : Taire des hommes, une percutante chaudrée de tapoches qui donne au public contemporain une impression de déjà-vu récent à chaque coup de matraque des forces constabulaires.
En entrevue, le cinéaste raconte :
Roland Smith l’avait présenté [Taire des hommes] au Cinéma Verdi, dans le cadre du premier Festival du film politique. Le tout tombait durant le voyage de Jean-Luc Godard au Québec, la même année où il est allé en Abitibi. Alors, puisque Godard est à Montréal, il se retrouve au festival, à la projection de notre film… il n’a pas aimé. Il avait trouvé ça « bourgeois »… il aurait fallu que ce soit projeté sur les murs d’une usine ou quelque chose. Il n’avait pas non plus aimé le fait que nous avions mélangé un roulement de tambour d’une chanson pop aux scènes de matraquage
/02
/02
Entrevue avec Pascal Gélinas réalisée par l’auteur, en août 2015.
.
On peine à imaginer ce que le Godard du début des années 1970 aurait pensé de Montréal blues. Aurait-il sursauté en apprenant qu’un tiers du salaire de tous les artisans du film avait été investi en différé pour que celui-ci aboutisse? Les réactions de la foule de la Mostra, devant Montréal blues, en donnent peut-être une idée :
Il a été reçu un peu mal… il n’y avait pas de plan-séquence de dix minutes où quelqu’un lit le journal… il n’y avait pas ce type d’hermétisme intellectuel particulier qui était très en vogue à ce moment
/03
/03
Ibid.
.
Ceci dit, bien que Montréal blues ne possède pas la charge de violence explicite véhiculée par les images de répression policière filmées par Harel et Gélinas le 24 juin 1968
/04
/04
Voir à ce sujet le livre de Paul Rose et Jacques Lanctôt, Le lundi de la matraque (Éditions Parti pris, 1968).
, ce qu’on y retrouve est le passage à tabac d’une idéologie commune à un groupe tentant de se convaincre qu’il peut s’abstraire de la logique du mode de vie duquel son « devenir » est inséparable.
La valeur du conflit
Ainsi, la valeur du projet de Gélinas tient peut-être en deux choses : le conflit qu’il met en scène et le politique qu’il choisit de taire. Le réalisateur qui a fait ses premières armes aux côtés d’Arthur Lamothe précise :
Le politique, on l’a vécu de proche à l’époque. Ce n’est peut-être pas présent dans le film, en raison justement du fait qu’il donnait plutôt une voix à notre vision utopique : « on l’a l’affaire, on est beau, on est fin »… on s’illusionne peut-être. On dénonçait un peu notre utopie, en fait. Et il faut dire que l’époque psychédélique nous permettait de nous en sauver. Je crois que c’est peut-être un film naïf, mais ce qu’il fait, au fond, c’est situer et montrer avec toute sa fragilité, notre utopie. C’est pourquoi je tenais à ce que Montréal blues contienne un conflit.
Ce conflit, comme Gélinas l’appelle, se cristallise dans une scène d’effeuillage débauchée à laquelle tous les protagonistes assistent. À travers la réaction de Gilbert aux pitreries de la jeune femme qu’il convoite, le spectateur est témoin de la triste mise au jour de tous les non-dits : inégalités des sexes, jalousie naissante, limite des couples ouverts, conséquences des prises de position radicales, etc. On entrevoit alors une certaine impasse de la libre pensée, à laquelle on aurait souhaité assister plus longuement, afin de constater pleinement le dénouement.
La scène finale du film, où apparaissent les membres du Grand cirque déguisés en clowns majorettes tournant sur eux-mêmes dans un petit kiosque à musique sur les flancs du Mont-Royal, vient à la fois complémenter le tout et rompre avec le rythme des événements et la volonté du personnage de Claude de quitter Montréal pour la côte Ouest, à l’issue du conflit idéologique qui l’oppose à Raymond. Un peu comme si le réalisateur pointait un révolver en direction de l’auditoire et qu’en appuyant sur la gâchette, un drapeau « bang » sortait du canon. À la vue de cette cohorte d’arlequins tambourinant à la queue leu leu, le spectateur est en droit de se demander si l’image ne lui renvoie pas la question suivante : l’aventure paraissait-elle plausible aux personnages par conviction ou par mimétisme?
À ce titre, dans un éditorial récent, Jean-François Nadeau commentait la transformation prochaine de ce kiosque à musique. Nadeau nous apprenait que ledit kiosque serait bientôt restauré par la ville, au coût de 535000$ et porterait le nom de Pavillon Mordecai-Richler. Pourrions-nous imaginer un meilleur scénario : un kiosque à musique « loin d’être une broderie architecturale », où des clowns tournent sur eux-mêmes sur les airs de leur propre musique, est restauré pour beaucoup trop cher, afin de lui donner des allures de grand monument à l’honneur d’un écrivain qui mériterait mieux… pour probablement moins cher. Ah oui, et on perdrait le film, au final, dans une shed.





