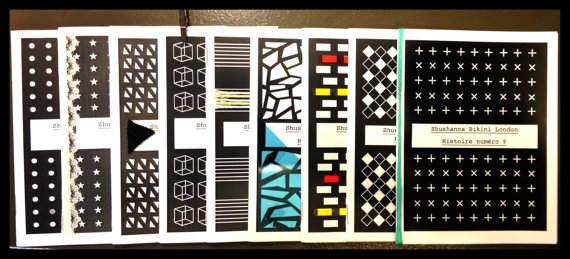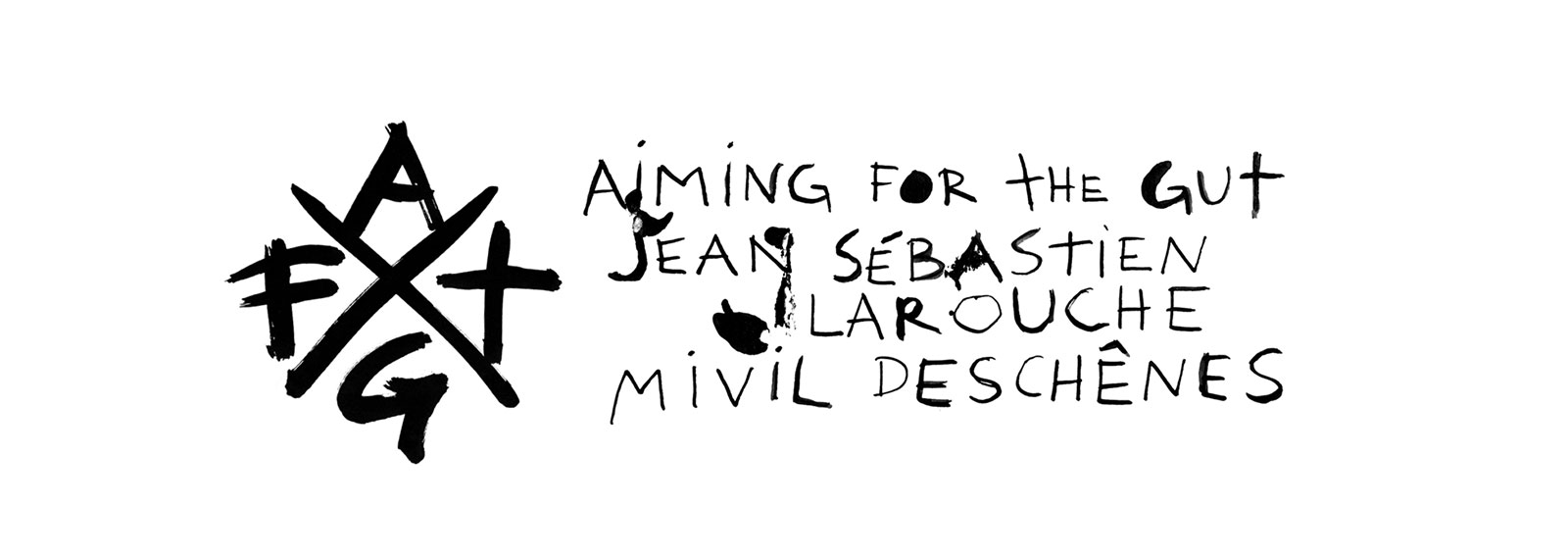Patrick Nicol, La Nageuse au milieu du lac, Montréal, Le Quartanier, 2015.
///
Il n’y a pas beaucoup de sang dans un oiseau, surtout de l’air et des os. (p. 61)
Un oiseau, c’est tout et presque rien. De l’air insufflé dans une merveilleuse petite mécanique. Une beauté qui nous est familière, que nous côtoyons, et qui n’est pourtant à portée de notre regard que dans une cage ou dans la mort. Poule, martinet, moqueur chat, oies, paruline, bruant, quiscale… Une faune ornithologique habite le dernier roman de Patrick Nicol, La Nageuse au milieu du lac, comme pour rendre hommage au plus mystérieux d’entre eux, c’est-à-dire la nageuse, la mère du narrateur, en fin de course, qu’une atrophie du cerveau condamne à lentement disparaître. À l’heure de sa mort, elle n’est plus qu’un «petit oiseau mouillé» dont on caresse la tête.
Cela peut être le signe d’un certain raffinement de prêter attention aux oiseaux qui nous entourent, de connaître leur nom, sans parler de commenter l’évolution de la taxinomie ornithologique – on ne dit plus une fauvette, mais une paruline. Tel est le narrateur du livre, professeur de littérature au cégep. Il vit la profonde douleur qui accompagne le déclin de sa mère selon un sens du détail, une attention sensible au monde qui l’isole en même temps qu’elle l’ancre dans une certaine réalité. Son récit s’attache plus aux objets, aux détails, aux petits gestes, à certaines paroles qu’aux situations dans leur globalité. Ou plutôt, dans ce livre, une situation simple, la fin de la mère, se décline en fragments. Pas d’introspection raffinée ni de pathos à outrance, pas de révélation sublime, seulement un monde perçu par un être bien élevé et baigné d’une douleur sourde ; une vie sans drame, mais une vie souffrante. «Baigné» convient tout à fait puisque le narrateur, à l’image de sa mère, semble lui aussi un nageur isolé, entouré de silence et de profondeur.
Aujourd’hui, la postmodernité, et je n’ai pas envie de parler de la mort des grands récits. (p. 145)
Roman sans action, La Nageuse au milieu du lac se présente comme une subtile atomisation du monde. Le livre se bâtit en chapitres relativement indépendants dont on pourrait modifier l’ordre. La narration oscille entre passé et présent, suivant souvent le cours d’une mémoire involontaire d’une conscience qui fragmente le monde. L’écriture paraît avoir été extrêmement travaillée et plusieurs pages sont de véritables réussites − le chapitre relatant la mort de la mère, magnifique, justifie à lui seul la lecture du livre. C’est un texte raffiné, maîtrisé, qui se fixe ici et là sur une situation, sur un sentiment, se construisant par touches d’analyse psychologique, de critique sociale, de prose poétique, sans jamais s’y attarder, ou plutôt toujours en revenant à l’image de la mère, et de celle-ci à celle de la mort. «Nous amorçons cet âge où les gens meurent autour de nous. Il n’a plus de plafond, a dit ma mère quand sa propre mère est décédée» (p. 108). Après le dernier de ses parents, on est théoriquement le prochain sur la liste… Le récit se rompt, sans cesse mais sans fracas, au rappel de la nécessité à la fois simple et effarante de la mort. Il n’y a ni temps perdu, ni temps retrouvé, seulement des morceaux, de vie, de temps, d’espace que le deuil venu et à venir rend à leur simplicité douloureuse.
Ce qui sort de nous est tellement mou, et tellement dur ce qui nous arrive. (p. 56)
La douleur et la beauté de ce livre ne se discutent pas, c’est d’autre chose que je veux à présent parler. J’ai ressenti à sa lecture une certaine oppression, voire une irritation. Par sympathie tout d’abord, partageant les sentiments du narrateur à l’égard de ce monde qui tantôt se réduit en bêtise humaine, tantôt se dérobe en mystère, puis par réaction contre sa douleur, ou contre la narration qu’il fait de sa douleur, trop maîtrisée, trop bien élevée, contente, peut-être, de se trouver à la jonction du langage et du deuil. Patrick Nicol refuse à son personnage tout débordement sublime, toute transgression existentielle, et il me semble, toute joie profonde. Que faire alors d’une douleur qui ne peut véritablement s’épancher ? La garder enclose dans les pages d’un livre ? Je ne réclame ni happy end ni consolation philosophique, je questionne juste cette souffrance trop calme, ce mystère trop juste, qui remplissent à merveille une narration intelligente. Encore une fois, beauté et douleur sont là, indiscutables, sacrées, sans laisser d’autre choix au narrateur, au lecteur, au texte que de les suivre. La littérature de la douleur peut-elle être toujours sage ? C’est la question que me pose ce livre beau et sincère.