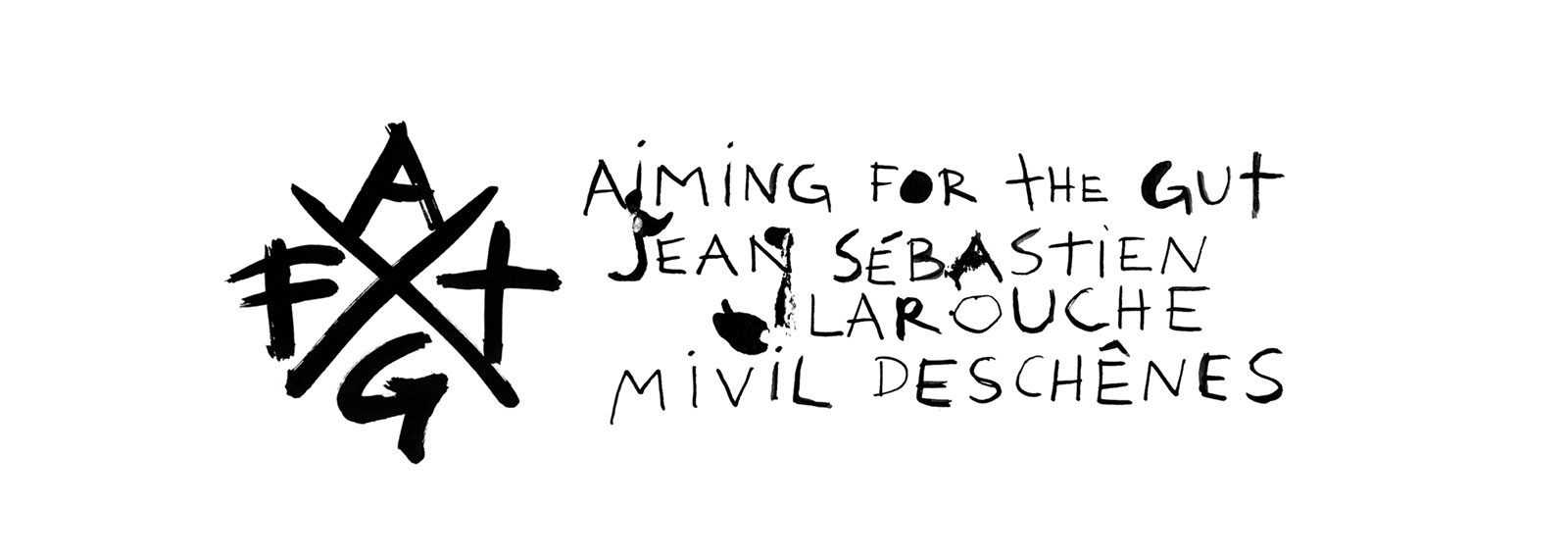Voltairine de Cleyre, «De l’action directe», D’espoir et de raison : écrits d’une insoumise, Montréal, Lux Éditeur, coll. «Instinct de liberté», 2008.
///
Il serait sans doute illusoire de rêver d’un âge d’or de la grève comme moyen de pression où elle aurait été louangée de tous et de toutes pour son mouvement libérateur. On ne l’estime qu’avec un recul historique, lorsque d’un lointain passé, elle évoque la richesse de constructions sociales entièrement manipulables. En 1912, Voltairine de Cleyre prononçait une conférence, publiée sous le titre de «Direct Action» (texte en anglais), en réponse à la déformation médiatique dont l’expression faisait l’objet. Ce texte paraît singulièrement actuel lorsqu’appliqué à l’analyse d’événements récents.
Il ne faudra pas plus qu’une machine distributrice éventrée et un désordre manifeste pour que les médias hurlent au saccage de l’UQAM. On pleure la marchandise comme si on pouvait, empathiquement, ressentir toute la souffrance d’un mur irrité par la peinture en aérosol d’un graffiti. Que la répression politique, policière et médiatique exerce une coercition brutale sur des individus et qu’elle soit à l’origine d’un climat de violence institutionnelle, financière, physique et psychologique pour des membres de notre collectivité, cela ne saurait s’énoncer chez les détenteurs de pouvoir acoquinés pour qui une occupation se réduit à du «vandalisme», pour qui une manifestation devient une «prise d’otage», et une grève, «illégale».
Le paradigme de l’acte «criminel» est constamment accolé à toute action directe. Au sein même de la gauche, une ligne est tracée entre les bons réformateurs pacifistes qui souhaitent remporter des parts sur le marché de l’opinion publique et les méchants révolutionnaires anarchistes adulateurs du chaos.
Pourtant, la question de la violence et de la non-violence d’un mouvement est profondément enracinée dans le rapport qu’entretiennent la coercition politique et l’action directe. Aussi pacifistes soient les tenants de l’action directe — car illes le sont —, la révolte est une forme de légitime défense et non un acte criminel. «Aujourd’hui, chacun sait qu’une grève, quelle que soit sa taille, est synonyme de violence. Même si les grévistes ont une préférence morale pour les méthodes pacifiques, ils savent parfaitement que leur action causera des dégâts.» (p. 153) Cônes renversés, circulation troublée, pavillons bloqués, levée de cours, ligne de piquetage, la grève est une violence symbolique à l’égard du capitalisme et de ses moyens de production. La réponse des autorités, elle, est dirigée contre les individus : brutalité policière, injonctions, expulsions. Quiconque affirmant qu’une grève n’est pas violente ment ou joue l’innocent : la grève est un affrontement.
Il y en aura toujours pour attester que tout acte de violence — entendre tout acte de violence de la part des grévistes — mine le mouvement, comme chaque acte de violence des autorités trouvera sa justification auprès d’un certain public, tel un parent qui frapperait son enfant pour imprégner à même son corps les leçons du pouvoir.
Dans les faits, peu importe l’opinion que l’on se fera sur les effets d’un acte isolé de son ensemble, «les forces de la Vie continueront à se révolter contre leurs chaînes économiques. Cette révolte ne faiblira pas […] jusqu’à ce que les chaînes soient brisées.» (p. 156) Dans l’expérience de la lutte, des solidarités se construisent, des consciences s’éveillent. La lutte peut prendre une pause, le temps d’une grande inspiration. Mais l’invivable oscille un peu plus à chaque offensive, et un jour, il finira par tomber, peu importe l’opinion méprisante de ceux qui jugent du haut de l’unique perspective des réseaux sociaux, des sondages ou des médias gavés aux relations publiques, sans réellement plonger dans les enjeux.
Certains diront qu’il vaut mieux se vouer à l’action politique : votez au quatre ans, impliquez-vous dans un parti, faites du lobbyisme. Or, «la base de toute action politique est la coercition; même lorsque l’État accomplit de bonnes choses, son pouvoir repose finalement sur les matraques, les fusils, ou les prisons, car il a toujours la possibilité d’y avoir recours.» (p. 141) Mais il y a pire, l’action politique mène à l’apathie : «elle détruit tout sens de l’initiative, étouffe l’esprit de révolte individuel, apprend aux gens à se reposer sur quelqu’un d’autre afin qu’il fasse pour eux ce qu’ils devraient faire eux-mêmes». (p.157) À attendre qu’un gouvernement la prenne en charge, la masse s’affaisse, se résigne et se soumet à ceux qui usurpent son pouvoir pour régner. Raconterait-il la fable du capitalisme à visage humain à qui mieux mieux, un parti aurait tôt fait d’entrer au pouvoir que celui-ci le gangrènerait de l’intérieur.
Les grévistes le savent et se méfient de toute forme de pouvoir. Ils n’accordent plus leur confiance aux partis politiques, aux institutions, aux médias, aux syndicats. De plus en plus, de nouvelles formes d’actions directes citoyennes se développent. On observe une fracture entre la base militante et les hiérarchies. Les désaffiliations de la FECQ et de la FEUQ ou les renversements de l’exécutif de l’ASSÉ en témoignent dans le mouvement étudiant. Un désir d’abolir la compartimentalisation du social témoigne d’une réaffirmation de ce qu’on ne peut plus ignorer, à savoir «que toute la structure sociale repose sur le prolétariat; que les biens des patrons n’ont aucune valeur sans l’activité des travailleurs». (p.158-159) Privilégiant ainsi à l’intérieur même des luttes, une orientation vers un pouvoir horizontal où chacun s’appartient tout en étant relié aux autres. Aussi, les mouvements sociaux préconisent la démocratie directe, s’allient par petits groupes d’intérêts sur les réseaux sociaux ou sur le terrain, créent des situations ponctuelles d’autogestion pour se faire entendre sans qu’aucune institution ne les gère. Ce sont ces actions directes spontanées et libres qui sont le moteur d’un mouvement plus large et qui échappent à une analyse politique qui voudrait faire de cette prise de pouvoir de la base par la base une faiblesse du mouvement.