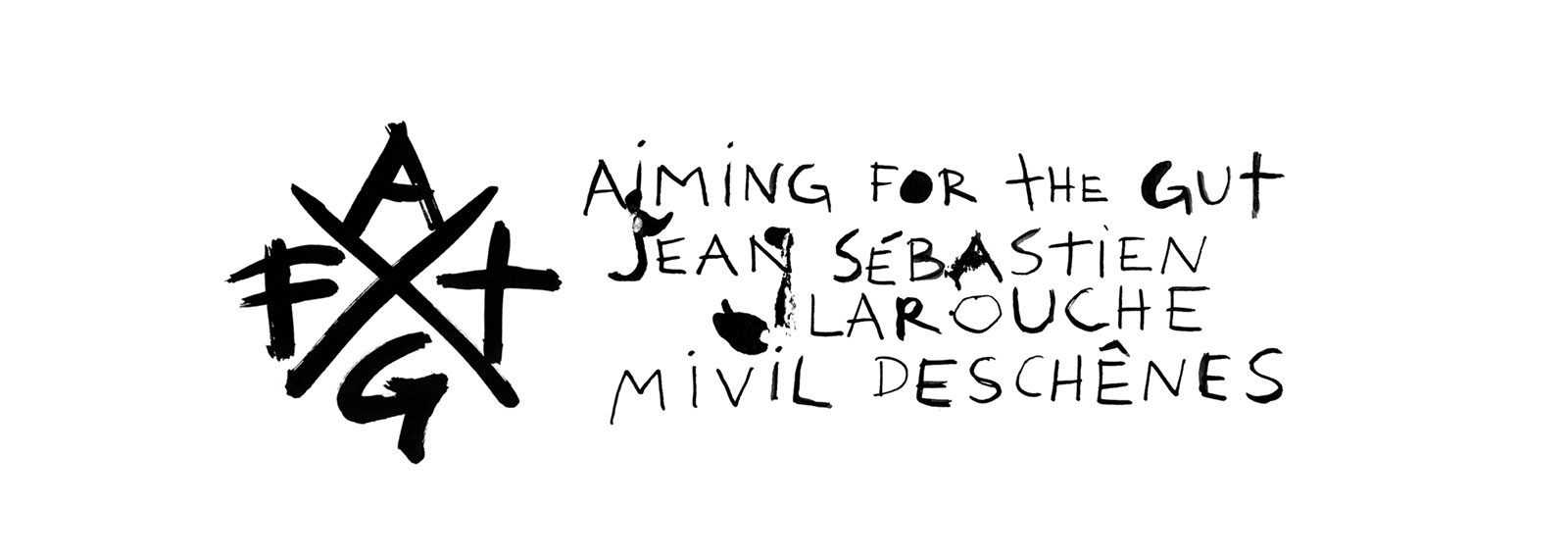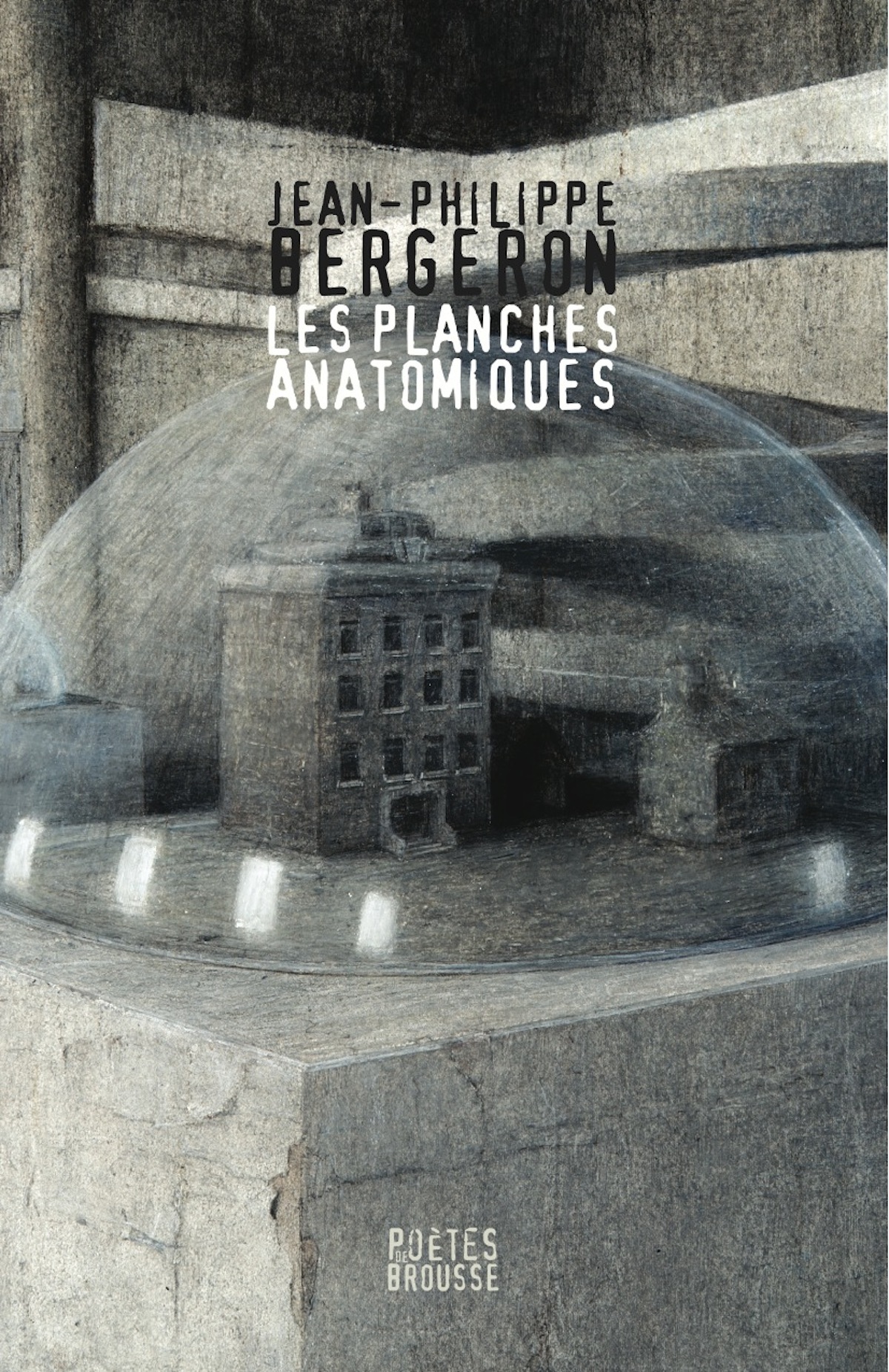Richard III
Drame historique de Shakespeare, traduit de l’anglais par Jean Marc Dalpé.
Mise en scène de Brigitte Haentjens, dramaturgie de Mélanie Dumont, scénographie d’Annick La Bissonnière, costumes d’Yso, lumière d’Étienne Boucher, musique de Bernard Falaise.
Avec Sylvio Arriola, Marc Béland, Larissa Corriveau, Sophie Desmarais, Sylvie Drapeau, Francis Ducharme, Maxim Gaudette, Reda Guerinik, Ariel Ifergan, Renaud Lacelle-Bourdon, Louise Laprade, Jean Marchand, Monique Miller, Olivier Morin, Gaétan Nadeau, Etienne Pilon, Hubert Proulx, Sébastien Ricard, Paul Savoie et Emmanuel Schwartz. Production de Sibyllines, en collaboration avec le Théâtre du Nouveau Monde et le Théâtre Français du Centre national des Arts (CNA, Ottawa).
Au CNA, du 21 au 25 avril 2015.
///
On ne peut que se réjouir de la faveur dont l’œuvre de Shakespeare fait régulièrement l’objet dans nos parages. On ne monte pourtant pas souvent le drame historique Richard III qui commande, il est vrai, une lourde distribution (même en confiant comme ici plusieurs rôles aux acteurs) et des budgets de production conséquents. Cela explique qu’il a fallu combiner les ressources de trois compagnies pour y parvenir.
Cette pièce de Shakespeare, écrite en 1591-1592, s’approprie librement, comme on sait, la chronique des rivalités sanglantes durant la légendaire guerre des Deux-Roses qui a dévasté l’Angleterre du XVe siècle, pour en tirer un personnage hors du commun, dévoré par l’ambition et hanté par la volonté de «jouer le rôle du grand méchant», pour ainsi dire, par hostilité envers son époque jugée frivole. Mais la pièce montre aussi comment c’est la société tout entière qui engendre un tyran, faute d’avoir instauré un véritable État de droit.
Richard est un être sans scrupules à n’en pas douter, mais c’est par son discours qu’il entend séduire et tromper. Sa monstruosité meurtrière n’a d’égale que ses talents dans la manipulation d’autrui. Shakespeare cherche ainsi à mettre en garde ses contemporains devant les dangers des luttes fratricides qu’instrumentalisent à leur profit les puissants, cyniques et cupides, et il construit son drame comme repoussoir aux tentations autoritaires qui menacent toute société inégalitaire. «Le pays est pourri et il va le rester», ne peut que constater amèrement Le Scribe, chargé de mettre au propre l’acte d’accusation d’un allié du roi devenu encombrant.
Le Barde anglais a dû toutefois se retourner dans sa tombe face à la production incertaine et frigorifique de son Richard III au Théâtre du Nouveau Monde, sous la gouverne d’une Brigitte Haentjens, dépassée à l’évidence par l’ampleur et les exigences ontologiques du texte, et qui, en dépit d’une distribution prometteuse sur le papier, ne passe pas le test de son premier essai en terrain shakespearien. J’ajoute sur-le-champ que j’ai vu la toute dernière représentation montréalaise (en prolongation) de cette production, le 8 avril dernier, en estimant par avance que ce serait, comme on dit, un spectacle parvenu à maturité, au terme d’une longue série de représentations. Que nenni !
Ce roi boiteux qui a déjà inspiré la verve déconstructrice d’un Jean-Pierre Ronfard, se dissout en effet sous nos yeux dans la proposition peu inspirée de Sébastien Ricard — un acteur pourtant doué s’il en est — dont la plupart des répliques se perdent dans les premières rangées de la salle. Voilà un monstre dont on ne tirera aucun trouble intérieur, aucune souffrance, et qui n’aura de démoniaque que ses effets de voix convenus ou ses grimaces. Comme si la méchanceté se chuchotait et n’avait rien à tirer des ricanements et des hoquets rageurs de l’humaine nature… Et peut-on croire, à l’opposé, que Gloucester se montrerait capable de se vautrer sur la pauvre Lady Anne ou de racoler Élisabeth comme un vulgaire troupier ? Vraiment désolant !

Malgré la grande qualité de la conception d’ensemble, notamment avec le dispositif en pente et polyvalent d’Anick La Bissonnière, la lumière réglée au quart de tour d’Étienne Boucher et les costumes sobres et inventifs d’Yso, la distribution peine à s’imposer en l’absence d’un pivot électrisant, à l’exception de la prestation franche et vibrante de Sylvie Drapeau en Reine Élisabeth, de l’aplomb d’Étienne Pilon en Hastings, de la dignité désarmante de Monique Miller en Reine Marguerite et du fougueux Richmond de Francis Ducharme (qui a pris, quant à moi, une solide option pour un grand rôle dans un prochain Shakespeare).
Tous les espoirs étaient pourtant permis lors de la toute première scène où Richard distille sa haine et fanfaronne, seul face à l’assistance : Sébastien Ricard s’y montre alors à la hauteur, avec une arrogance qu’il perd ensuite tout au long des cinq actes. Et c’est long longtemps ! La faute en revient à la décision d’«intérioriser» le rôle, si l’on en croit l’acteur dans l’excellent dossier, intitulé Entre chien et loup, que publie le Théâtre Français du CNA pour l’occasion. Or Shakespeare n’est pas le lointain prédécesseur de Tennessee Williams, et c’est par la rhétorique obscène de sa créature qu’il entend toucher et provoquer le public. Quel dommage que Ricard n’ait pas retrouvé ici la morgue (et la projection) de son mémorable Macheath dans L’opéra de quat’sous, mis en scène par la même Haentjens !
Quelques mots pour finir sur la traduction très convaincante de Jean Marc Dalpé qui s’emploie bellement à simplifier une intrigue foisonnante et à mettre dans la bouche des personnages des paroles qui coulent de source. C’est ce qui s’appelle réussir une véritable transposition en français contemporain d’une langue de théâtre aussi difficile à respecter dans son passage vers nous. Il ne reste plus qu’à espérer qu’un petit miracle se produise à Ottawa à compter du 21 avril.