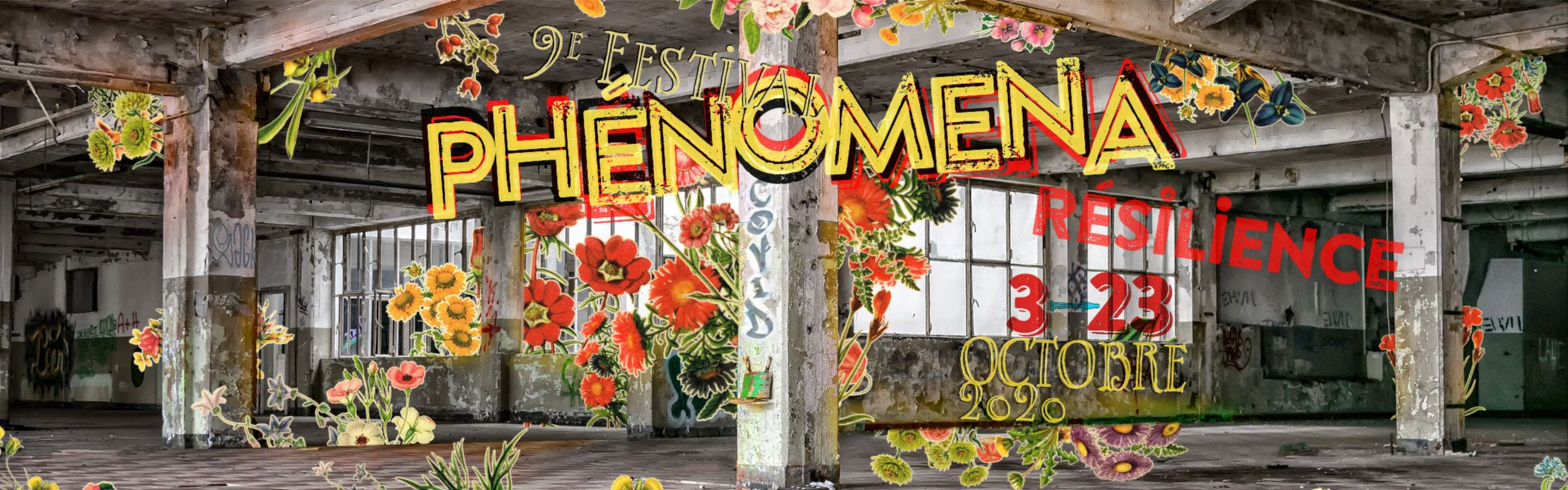Rencontre avec Cheryl Sim, directrice générale et commissaire de la Fondation PHI, dans le cadre de l’exposition RELATIONS : la diaspora et la peinture.
///
Marion Malique : Comment est né le projet de l’exposition RELATIONS : la diaspora et la peinture ?
Cheryl Sim : La diaspora est une question et un sujet qui me préoccupe, qui m’habite depuis très longtemps, je dirais depuis que je suis enfant et que je dois expliquer d’où je viens. Si je réponds que je suis née ici et que je suis canadienne, je comprends que ce n’est pas ce que la personne veut entendre. J’ai souvent dû expliquer mes racines. Les gens me posaient la question maladroitement, sans avoir le bon vocabulaire pour bien l’exprimer. Je voulais vraiment trouver un moyen pour que tout le monde soit à l’aise et que l’on puisse parler des vraies choses avec la bonne terminologie.
On vient tous de quelque part. En grandissant, je réfléchissais beaucoup à ma place dans le monde. Je n’avais pas de médium ni de méthode pour explorer la question avant la fin du secondaire, le début du CEGEP. Lorsque j’ai commencé à prendre des cours de sociologie, de poésie, quand j’ai découvert le féminisme et les discours post-colonialistes, j’ai commencé à me bâtir un vocabulaire et un discours autour de cette question. J’ai commencé à faire mes propres œuvres et à être inspirée par des femmes, des femmes de couleurs, des femmes autochtones. Je me suis retrouvée, je me situais quelque part au cœur de cette sorte de famille que j’ai découverte.
Quand j’ai commencé à travailler à la Fondation PHI en tant que commissaire, je me suis dit qu’un jour j’aimerais dédier une ou plusieurs expositions à ces questions. Il y a tellement de façons d’explorer la diaspora. Le piège, selon moi, c’est d’essayer d’être exhaustif. Il faut accepter d’être transparent à ce sujet, c’est une façon de construire le discours, de continuer la conversation.
MM : L’exposition est composée de plus de 50 œuvres de 27 artistes résidants au Canada, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Comment s’est fait le choix des artistes et pourquoi ces trois pays de destination ?
CS : Pour moi, la construction d’une exposition c’est plusieurs pistes qui avancent ensemble. Qui sont les artistes dont la pratique englobe cette réflexion, où sont-ils ? J’ai réalisé que ça serait important d’avoir un respect et un soin pour le contexte montréalais, au contexte colonialiste. Ça me semblait important et naturel de créer un dialogue entre les diasporas du Canada et des États-Unis, étant donné que les discours gouvernementaux qui y servent à construire l’idée de nation emploient deux procédés différents (le multiculturalisme et le melting-pot).
Nous partageons aussi une histoire importante avec la Grande-Bretagne. C’est un pays impérialiste et colonialiste qui a aussi reçu des grandes vagues d’immigrants provenant des pays qu’ils ont colonisés. Toutes ces histoires et ces situations contemporaines à propos de la diaspora peuvent s’entremêler et se parler. C’était aussi une façon de mettre une certaine limite et d’essayer de bâtir un travail de fond. J’aurais pu penser à la diaspora en France ou en Allemagne, où la culture est perçue d’une autre manière, très homogène, et l’hégémonie tellement profonde.

MM : Quelle place occupent les traditions, les symboles et la religion dans l’exposition ?
CS : La religion est importante comme stratégie de survie face au colonialisme, mais les artistes la critiquent aussi, tout en restant très respectueux. Larry Achiampong, par exemple, propose une réflexion sur la religion comme outil colonialiste au Ghana, où l’église et l’expérience d’être à l’église constitue aussi quelque chose de central dans la communauté.
Pour d’autres artistes de l’exposition, je dirais que c’est surtout la mythologie qui prend beaucoup de place. Surtout chez les femmes, lorsqu’il est question de la réappropriation de certains mythes et de figures féminines. Le fil rouge, c’était de retrouver des histoires et des sentiments positifs, puissants, résilients, à propos de figures féminines mythologiques dont la représentation a changé à la suite des contacts avec les européens (c’est le cas de Marigold Santos et la ciguapa de Firelei Báez). Au lieu d’être l’incarnation d’idées fortes ou de simples personnes, elles sont devenues des vampires ou des monstres séduisants.
MM : Parmi les concepts qui t’ont aidé à bâtir ton discours, tu as parlé de féminisme. Est-ce que, selon toi, on peut présenter une exposition qui soit à la fois ouvertement féministe et antiraciste ?
CS : Tout à fait, je crois que l’intersectionnalité s’impose. On parle de libertés, on parle d’anti-oppression, ce que l’on cherche c’est la liberté pour tout et pour tout le monde (c’est un peu comme le sutra dans le yoga Jivamukti). Ça ne veut pas dire qu’on est tous d’accord sur tout. Si on étudie l’histoire du féminisme, les approches se multiplient, mais au fond, ce que nous cherchons c’est une place plus libre pour les femmes.

MM : Il y a de nombreux portraits et plusieurs paysages, peut-être moins d’œuvres abstraites. Selon toi, est-ce que la représentation de figures et de lieux occupe une place plus importante dans le travail des artistes issus de la diaspora ?
CS : Plus je parle avec les artistes sur les questions de figuration et d’abstraction, plus je réalise que tout est important, possède une puissance propre. Je ne voudrais pas transmettre l’idée que les artistes qui explorent ces questions sont moins intéressés par l’abstraction, parce que c’est faux. La figuration peut être vue de manière abstraite. L’abstraction peut être très claire, autant qu’un portrait ou qu’un paysage figuratif (Julie Mehretu, Kamrooz Aram ou Manuel Mathieu). En dépit des différences entre les modes d’expression, plus je pense à ces catégories et moins elles tiennent.
MM : L’exposition a pu ouvrir au public entre deux fermetures des institutions culturelles, avant de refermer le 1er octobre. Le vernissage a dû être repensé, le lancement du catalogue de l’exposition aura lieu en ligne. Quels ont été les plus grands défis à surmonter et qu’est-ce qui est ressorti de positif de toutes ces contraintes ?
CS : Ce n’était pas difficile de concevoir la visite de l’exposition tout en respectant les mesures de distanciation, c’était même assez facile, en fait. Nos édifices nous ont permis de créer un parcours naturel. Mais au départ, c’était difficile d’accepter que si les gens ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas réellement expérimenter une œuvre qui a été conçue pour une expérience en direct. Il faut entamer un deuil et trouver d’autres moyens pour faire le pont, transcender les limites sans oublier de préserver l’intimité de l’expérience.
On a été émerveillés par l’ingéniosité des membres de l’équipe qui ont conçu, par exemple, un atelier de perlage en ligne avec Nico Williams, ou qui ont proposé d’offrir des trousses et des rencontres dans les salles de classe des écoles de secondaire ou de CEGEP. Comme les artistes viennent de partout dans le monde, les vidéoconférences nous ont permis de créer des tables rondes virtuelles malgré le décalage horaire. On n’aurait jamais pu faire 15 entretiens avec les artistes en direct si on était tous toujours figés dans ce genre de régime.
Je pense qu’en tant qu’êtres humains, on sait comment s’adapter, le corps est fait pour ça. On trouve d’autres muscles, on développe d’autres sens. Peut-être que l’on finira par développer de nouvelles capacités, comme les figures dans les œuvres de Rajni Perera. Pour moi, une réussite ne se mesure pas seulement par le nombre de corps qui franchissent le seuil de la porte, mais aussi à l’émergence d’une communauté et d’un sentiment d’appartenance.

MM : Vous proposez une visite guidée commentée sur votre chaîne YouTube et sur votre page Facebook. Est-ce que l’adaptation numérique de ce type de contenu rend le tout plus accessible, notamment auprès d’un public peut-être moins familier avec l’art contemporain ?
CS : Je pense que tu as touché le nerf de la guerre avec la question de l’accessibilité, étant donné qu’il y a tout un discours historique ayant été construit par l’élite pour servir un petit groupe de la société et pour faire sentir mal à l’aise les autres. Les musées sont des outils (d’autres disent qu’ils sont des armes), une extension, comme un bras des intérêts qui ne « nous » représentent pas. Notre mission, à la Fondation PHI, est de casser ces discours et de partager cette idée que l’art est pour nous. J’ai vu comment ces outils pourraient être bénéfiques pour cette mission-là et je pense qu’ils vont rester. Le numérique nous permet d’avoir une interface pour dialoguer et poursuivre la discussion tous ensemble.
MM : Moridja Kitenge Banza, qui fait partie des artistes de l’exposition, et toi, avez participés à un panel organisé par le média Résidence sur la question de l’inclusion dans l’écosystème de l’art contemporain. Je trouve que RELATIONS est, d’une certaine façon, une réponse à la situation actuelle. Au moment de la conception de l’exposition, est-ce que tu imaginais déjà toutes ces discussions et le contexte dans lequel elle allait voir le jour ?
CS : Pas du tout! Ça fait 30 ans que je travaille dans le milieu culturel à Montréal. J’ai commencé dans une ère que l’on peut qualifier de deuxième vague de réflexions sur les questions d’identité, au début des années quatre-vingt-dix. Il y a beaucoup de bon travail qui a été fait, mais tout le monde semblait tellement épuisé vers la fin des années quatre-vingt-dix, notamment en raison du backlash dans l’académie, dans le milieu culturel.
L’exposition RELATIONS révèle ma stratégie en tant que commissaire, qui se situe au niveau de la programmation. Le discours sort ensuite par la proposition de l’artiste. Ceci-dit, RELATIONS a été conçue avant cette nouvelle vague, qui prenait alors une puissance insoupçonnée. Ce qui se passe en ce moment dans le milieu culturel mondial, c’est incroyable ! On n’a jamais pensé que ça serait possible, honnêtement. Ce qu’il faut, c’est de continuer à élargir le discours, faire de la place à tout le monde au sein de cette révolution.

MM : En tant que commissaire, quel est, selon toi, le rôle des différents acteurs du milieu culturel dans le contexte actuel pour faire avancer la discussion (institutions, artistes, commissaires, public) ?
CS : Comme tu l’as probablement constaté, lors du panel de Résidence, même si on était tous des gens racisés, on n’était pas tous d’accord sur tout. C’est aussi lié avec l’expérience personnelle de chacun. Chacun a sa propre posture et sa façon de voir les choses. Je pense qu’on a constaté que la question du pouvoir est centrale. Si on veut parler d’un système, il faut suivre la tige jusqu’à la racine pour comprendre, analyser ses racines enterrées. C’est comme ça que l’on peut non seulement de démanteler ce qui préexiste, mais aussi faire pousser quelque chose qui nous ressemble davantage.
Ça veut dire qu’il y aura beaucoup d’inconfort pour les gens qui pensent qu’ils vont perdre quelque chose. Mais mon message, c’est qu’il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu’une fois que l’on reconnaît un système, on peut faire quelque chose. Si l’autre n’est pas libre, je ne suis pas libre non plus. Là, on commence à voir poindre le départ de quelque chose : comment on peut construire ensemble, ou construire autrement, différemment? On ne veut pas nécessairement reproduire ce qui a été fait. Donc c’est radical, sans être un déracinement complet. On peut infiltrer les structures existantes et faire en sorte que l’équité soit une pratique pour le bien être de chacun parce qu’on croit vraiment en une société qui peut être en bonne santé. Je pense que ça commence comme ça, par éclaircies, enlightment, par l’éclair qu’est ce moment où on réalise que l’on partage cette lutte.
Il n’est pas question de résoudre, on ne va rien résoudre, c’est une pratique. C’est un processus, les processus ne sont pas toujours très nets. C’est peut-être pour ça que l’écosystème était dans le titre de ce panel-là, parce que ça prend tous les niveaux, mais parce ça inclut aussi les publics, qui sont une partie majeure de l’écosystème du milieu culturel. Si on revendique l’imputabilité et la justice au sein des institutions culturelles, celles-ci vont répondre, parce que nous avons le pouvoir. On a juste besoin de comprendre que nous avons le pouvoir et d’y croire.

© crédits photos : Richard-Max Tremblay (Fondation PHI pour l’art contemporain)