Pourquoi les migrant.e.s importent peu ?
[RUBRIQUE DÉBAT/ACTUALITÉ]
Commençons par une évidence : il n’est plus possible aujourd’hui de prendre le pouls du monde et d’en penser l’avenir tout en balayant ce que l’on appelle la « crise migratoire ». Car lorsqu’un rapport de l’ONU estime à un milliard le nombre de réfugié.e.s qui afflueront vers l’Europe d’ici 2050, l’on ne peut que s’inquiéter que les États du Nord ne soient pas en mesure de forger une politique plus pérenne de la gestion des flux migratoires. Une politique non-complaisante, qui ne se soucie pas d’entretenir « l’image sécurisante d’un monde feutré, protégé et désirable de luxe, paillettes et justice tout en triant les ayants-droit à l’entrée », comme l’écrit l’anthropologue Michel Agier dans L’Étranger qui vient. Car, à force de chercher à le protéger à tout prix, c’est précisément cet idéal de confort-là que les États-nations du Nord sont en passe de sacrifier en l’absence d’une vision politique plus ouverte, d’une perspective qui pense en conjonction avec l’inéluctable plutôt qu’en disjonction, avec les personnes migrantes plutôt que contre et sans elles.
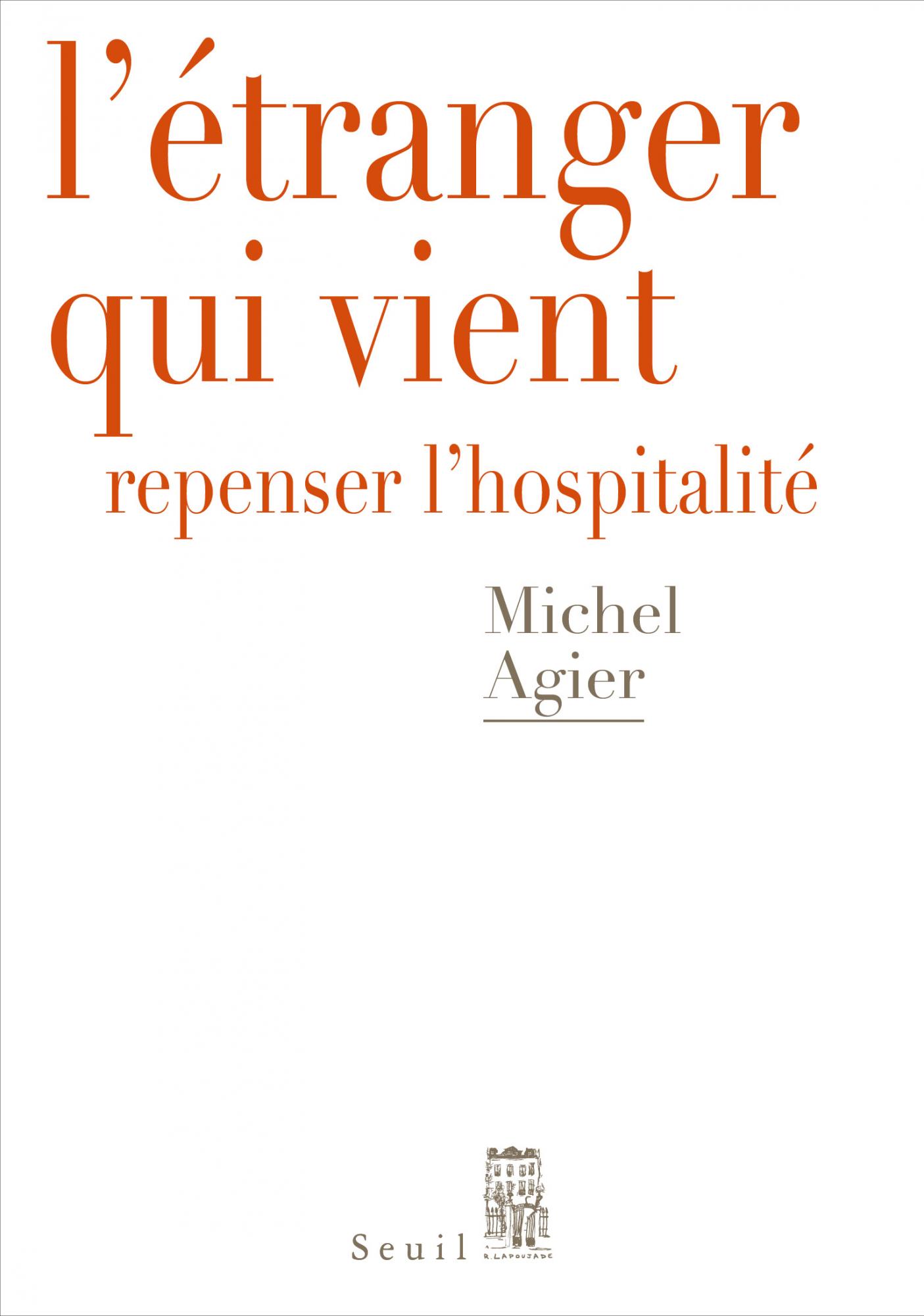
Inéluctable est cet avenir que charrient ces millions de migrant.e.s qui se bousculent aux portes de l’Europe. Un avenir auquel l’empire ferme ses portes en se laissant désavouer par son incapacité, après s’en être arrogé le privilège, à mettre en œuvre une politique d’accueil féconde : celle-ci s’est, en effet, vu arracher des instances sociales et communautaires pour se transformer en une politique pure et dure de gestion des frontières. Alors que le monopole étatique affaiblit les politiques collectives de l’hospitalité traditionnelle, celles-ci tendent à s’individualiser dans une forme de résistance, si ce n’est de dissidence, vis-à-vis des mesures gouvernementales – ce qui fut le cas de Cédric Herrou, en France, poursuivi pour « délit d’hospitalité » pour avoir hébergé 150 réfugié.e.s. Ce clivage entre les dispositifs publics et les actions locales et individuelles renvoie à une inadéquation entre l’idéal d’hospitalité en soi (ce reliquat d’un humanisme suranné) et l’absence d’un dispositif d’accueil légitime qui, non seulement ne criminalise pas l’aide aux étrangers.ères, mais qui puisse en plus normaliser ce principe humaniste au premier chef et l’intégrer au sein d’une vision sociale globale.
L’affaiblissement des dispositifs d’hospitalité est une entreprise radicale s’étant progressivement établie en Europe à travers une réélaboration de la nomenclature liée aux étrangers, depuis le xixe siècle, avec la sédentarisation progressive des masses, la domiciliation et l’assignation identitaire. Ainsi, en France, au début du Second Empire, l’on aura préféré « le qualificatif d’‘‘émigrants’’ plutôt que celui de ‘‘réfugiés’’, pour évoquer les étrangers venus chercher asile en France », ainsi que le rappellent Sylvie Aprile et Delphine Diaz dans Définir les réfugiés. Les auteures présentent cette substitution de vocables comme la « preuve d’une volonté d’effacer toute trace, même lexicale, de la tradition d’accueil du pays qui s’était alors transformé en terre d’exil ». Tandis qu’au Québec, le terme immigrant, calqué sur l’anglais, figeant l’immigré.e dans le participe présent, maintient ce.tte dernier.ère dans un perpétuel passage, en ceci que la vision plus ou moins romantique du mouvement continuel escamote la radicale altérité et, dès lors, le « stigmate » que suppose cette mise à distance, ainsi que l’écrit la sociologue Myriam Hachimi Alaoui dans ses travaux comparatifs entre l’immigration en France et celle au Québec.
Heurs et malheurs d’une figure
C’est que la figure même de l’Autre pose un défaut de définition – ce qui, de fait, empêche d’interagir de manière efficace avec la personne qu’elle désigne. Renvoyant d’abord à un statut entériné en 1949 par la Convention de Genève, la catégorie de « réfugié » pouvait servir à désigner toute personne, en situation de danger, devant fuir son pays. Aujourd’hui, nous parlons plutôt de « demandeurs.euses d’asile », uniquement éligibles au statut de « réfugié.e.s » s’illes sont en mesure de fournir la preuve de leur persécution. La construction du récit de l’exil et de la souffrance, artificiel de bout en bout, révèle alors son implacable violence sur le corps assujetti ; c’est ce que Viktor, demandeur d’asile ukrainien dans la brillante série Years and Years (2019), confie à Daniel, agent de logement britannique (et son futur amant) : torturé par des électrodes aux pieds, comment donnerait-il à voir ce dont seuls les cauchemars gardent la trace ? La recherche obstinée d’objectivité dans ce qui ne peut être que son antipode se double inévitablement de l’objectivation de la personne migrante. Ceci fait d’elle ce que Michel Agier appelle, tantôt un spectre – à l’interface du réel et de l’imaginaire –, tantôt un alien, cette figure qui incarne, dans la science-fiction, celui ou celle qui vient de loin et qui, radicalement différent.e, si ce n’est sauvage, ne peut être qu’un.e ennemi.e.

L’instauration de cet.te autre absolu.e s’inscrit dans le cadre d’un processus narratif institutionnalisé visant à éradiquer toute possibilité de dissonance que favoriserait l’entrée en contact avec une subjectivité autre. Il s’agit évidemment d’un désir de contrôle, ainsi que le relève Michel Serres dans son ouvrage Le parasite : l’étranger est toujours maintenu dans la position du tiers exclu, alors que sa présence est nécessaire à la survie du système hôte, fondamentale pour sa régénération, sa pérennité même. Contrôler le corps et la voix de celui ou celle qui arrive, c’est aussi et surtout maintenir le contrôle sur sa propre intériorité et, par conséquent, sur sa souveraineté. L’impératif sécuritaire se voit ainsi superposé à un calibrage des récits des migrant.e.s, que les aidant.e.s (par exemple, les avocat.e.s au Canada, les travailleurs.euses sociaux.ales en France), assistent dans le montage de leur histoire afin qu’elle colle le plus fidèlement possible à l’image que l’hôte se fait de la personne réfugiée, non pas idéale, mais tolérable.
Or, la normativisation du récit de la migration peut être aussi négative que supposément positive, notamment lorsque la figure de l’étranger est sacralisée selon une loi suprême qui serait descendue du ciel, ce qui est par ailleurs l’idéal derridien d’une hospitalité inconditionnelle. Toutefois, cet idéal sacré, irréaliste, mérite aujourd’hui d’être remis en question afin, plutôt, d’humaniser la figure de l’étranger.ère, recueillir sa voix et céder l’espace à sa subjectivité.
Étranger.ère par-delà la frontière
Une telle entreprise semble ardue du fait de notre manière même de penser l’altérité à travers le concept de frontière et le rapport entre extériorité et intériorité. Il est couramment admis chez les anthropologues que la frontière est un espace de métamorphose et que la rencontre avec l’Autre peut parfois susciter des chocs, ainsi que des changements de vision et d’être, voire d’être-au-monde ; c’est tout le propos, par exemple, d’un film comme Terraferma, de l’Italien Emanuele Crialese (2011), où le quotidien des habitants de l’île Linosa entre en collision avec des vies régurgitées par la mer. Michel Serres, dans son ouvrage Atlas, qualifie cet espace de rencontre d’« espace blanc », où l’être déploie ses possibles, laissant apercevoir une direction à prendre éventuellement, un devenir, le « fantôme d’un troisième homme ». Près d’un quart de siècle après ce postulat humaniste, Michel Agier, pour sa part, voit se multiplier dans le monde des « situations de frontière », que ce soit dans les camps de réfugié.e.s – ces espaces-frontières – ou dans la vie de tous les jours, dans une forme de cosmopolitisme ordinaire qui peut donner « le signal du monde ». À la suite de Kant, Agier considère le passage des frontières comme nécessaire « pour faire l’exercice du monde et des autres, sortir de soi, du périmètre identitaire assigné ». Or, le paradoxe est que la multiplication des situations de frontière taille dans le tissu du monde des enclos identitaires où les individus, assignés à leurs nationalités, maintenus derrière leurs origines ethniques et culturelles, sont pris dans une forme d’instance identitaire difficilement subvertie.
La figure de la personne migrante a toujours été pensée à travers la frontière, qui se décline en différentes nuances, comme celle du « passage » ou encore du « seuil », des concepts qui toutefois s’avèrent précisément perdues de vue aujourd’hui, d’où la difficulté de les problématiser et peut-être même de les dépasser. La difficulté réside justement dans l’incapacité qui est la nôtre, dans un monde où l’idée même d’hospitalité, si elle n’est pas éradiquée conjointement aux instances qui en étaient jadis garantes, est du moins dénaturée puisque calibrée selon des stratégies narratives bien précises ; un storytelling qui répond lui-même à l’impératif sécuritaire et à la protection des frontières. Toute la difficulté réside aujourd’hui dans le fait de penser l’hospitalité, de l’écrire et d’accueillir la personne migrante en dehors de la frontière (que ce soit en politique ou dans les arts et les domaines du savoir), c’est-à-dire de l’accueillir et de lui céder la place, la parole à l’intérieur, après la frontière et le passage, là où elle peut enfin devenir le sujet qu’elle est et non pas cet objet exotique qui cristallise les fantasmes du dedans, autant les peurs que les désirs.
Exister sans être personne
C’est bien cette aporie que semble interroger le documentaire Les Messagers d’Hélène Crouzillat et Laetitia Tura (2014). Le long-métrage est essentiellement tourné au Maroc, à la frontière de l’enclave espagnole de Mellila, un dispositif frontalier des plus hermétiques, que les migrant.e.s subsaharien.e.s tentent de franchir et tout autour duquel illes se voient obligé.e.s de camper, en instance, incapables d’entrer ni de repartir. Le film fait la part belle aux témoignages de ces passagers.ères, à leurs histoires rythmées par des clichés silencieux et immobiles, parfois sur fond de bruit de vagues ou de vent ; des sons qui essaient de restituer la trace de l’exode, de capter l’empreinte de silhouettes à jamais disparues, pour peu qu’elles aient existé. Le parti pris esthétique des réalisatrices est très clair : offrir à voir des paysages en apparence imperturbables – routes, quais et ruines. Les photographies sont indifféremment agencées, sans identification de lieu, comme pour dire l’errance de ces personnes disparues ; ces images que ces dernières semblent encore habiter de leur éternelle absence, de l’invisibilité qui a toujours été la leur, et qui saute aux yeux désormais qu’illes sont mort.e.s. La gamme chromatique est réduite aux nuances d’une même couleur, gris ou vert : la limite entre la vie et la mort est à peine perceptible. Ici, des cadavres nourrissent les herbes sèches. Là, les dépouilles enveloppées de blanc se confondent avec le décor. Certes, les réalisatrices ne dérogent pas à la convention qui consiste à esthétiser la condition des personnes migrantes, comme si celle-ci était intransmissible autrement. Plus encore, ces images dépouillées, au lyrisme silencieux, servent à dire l’espace-frontière qui engloutit ces individus, les maintenant dans une sorte d’éternel entre-deux, ni dedans ni dehors, à l’écart de toute expérience concrète de rencontre avec l’Autre et du déploiement d’une éventuelle intersubjectivité.
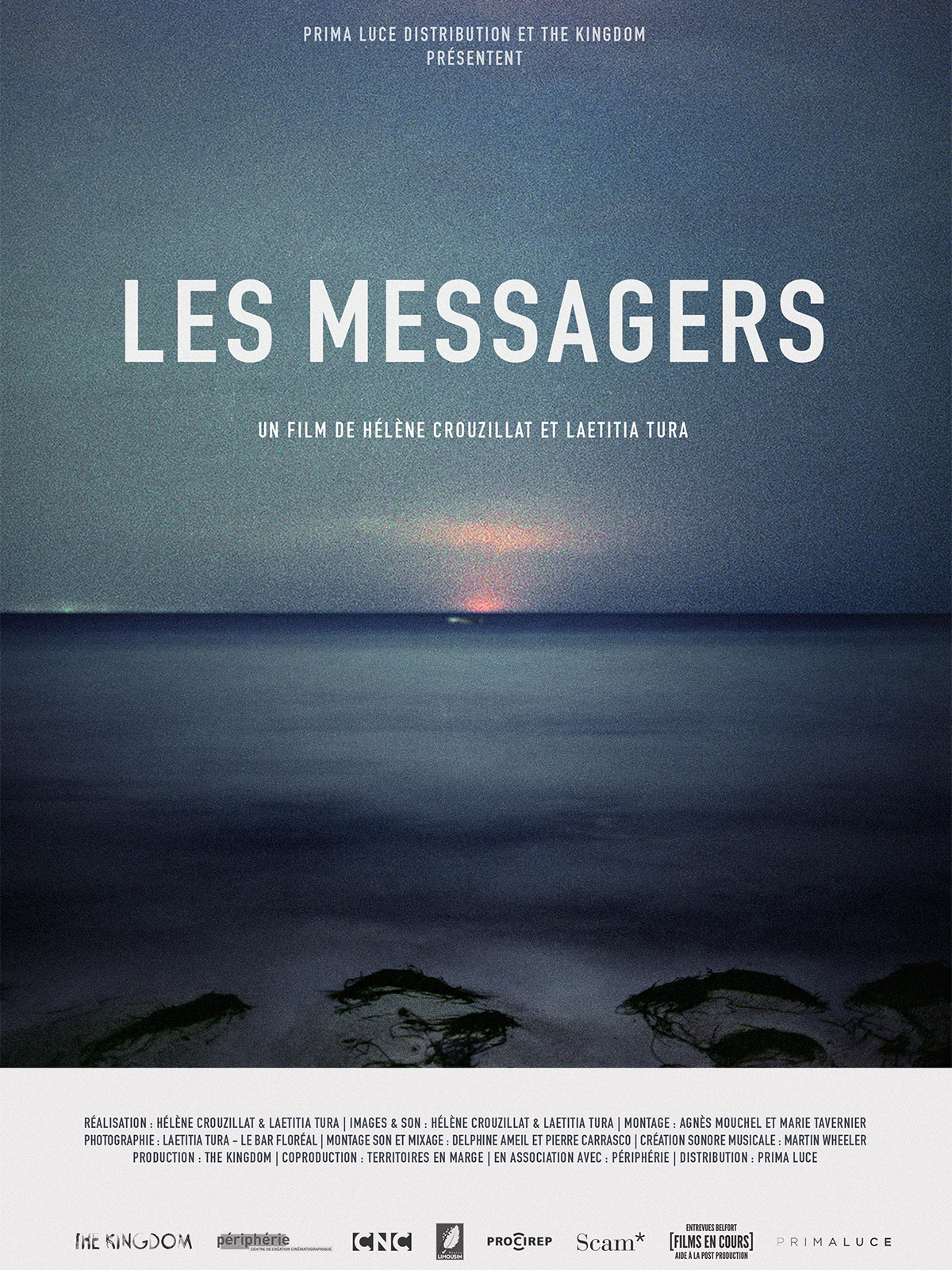
La structure narrative du documentaire, le choix des images et le montage semblent dire, en effet, que les personnes migrantes ne peuvent être qu’objectivisées. Cela, ces dernières en sont elles-mêmes conscientes, et là est tout le drame, là est le silence auquel elles sont souvent obligées de se résigner. Dans cet entre-deux que les migrant.e.s habitent, ne semble pas exister la possibilité d’une stratégie narrative collective à même de les faire exister. Illes n’ont pas d’autre domicile que la mort, hors du circuit des vivants, hors contrôle ; et c’est précisément ce que dit ce père blanc qui leur offre une sépulture : la tombe est là pour leur donner une « visibilité ». Et c’est à cet hors-espace que renvoie Fabien Didier Yene, l’un des protagonistes du documentaire, lorsqu’il dit que les « migrants sont les messagers d’une époque ». Fabien recourt au registre prophétique et à la transcendance de l’invisible pour donner un sens à son expérience, à sa vie et à celle de ses frères et sœurs assigné.e.s à l’inexistence, à la « chosification » (un terme dont il cherche justement la définition dans le dictionnaire).
Fabien Didier Yene mourra d’un AVC en avril 2019, après des années de traversées échouées et de militantisme, et surtout après avoir fait paraître un livre, Migrant au pied du mur, qui lui aura permis d’atterrir en France, d’enchaîner les titres de séjour, puis de devenir agent de sécurité incendie le matin et chauffeur de taxi le soir.
Prophète sans fidèles, il aura regagné son inexistence primordiale ; messager de la catastrophe qui vient, il est un parmi ce milliard d’individus qui, d’ici un demi-siècle, viendront nous dire le monde d’après.
