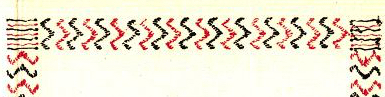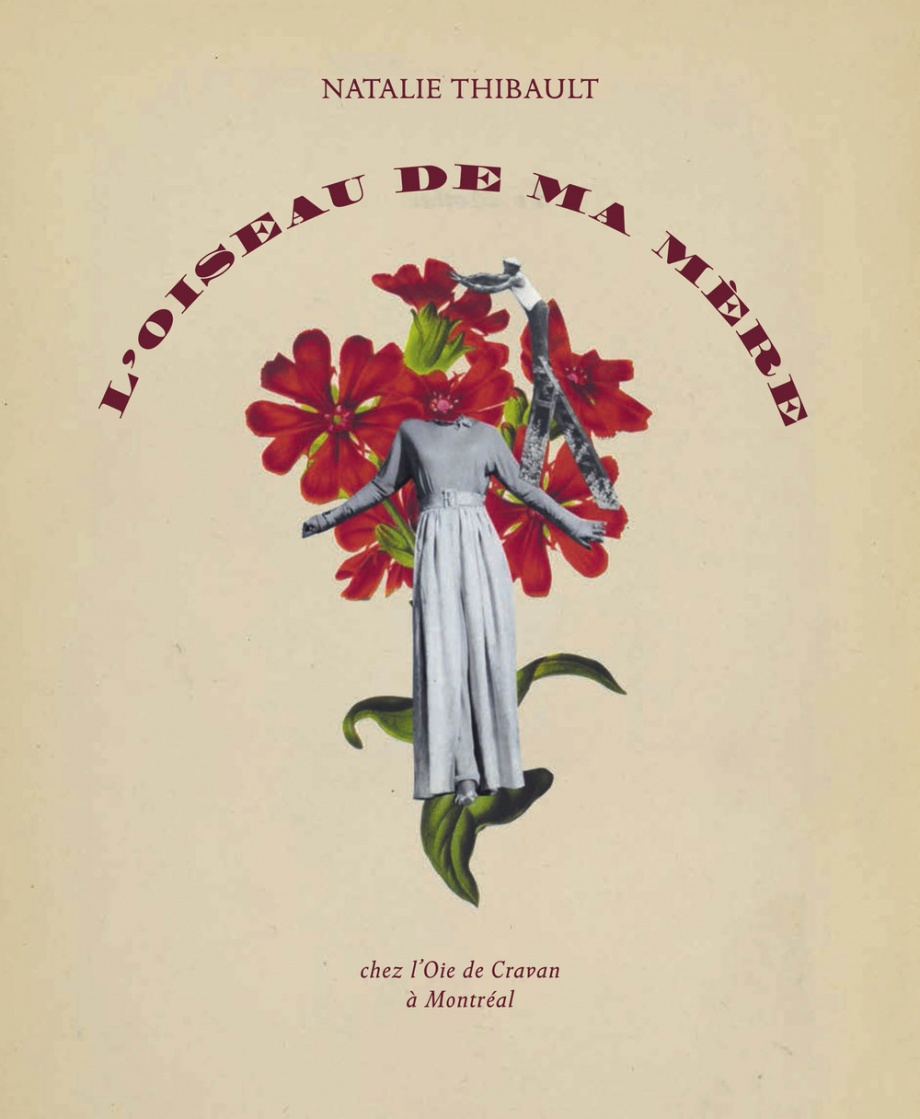Christophe Bernard, La bête creuse, Montréal, Le Quartanier, coll. Polygraphe, 2017, 720 p.
///
Ça boit. Ça hallucine. Ça s’haït. Ça boit. Le roman de Christophe Bernard, un livre bien nourri, lourd de ses quelques 700 pages, raconte la Gaspésie du XXe siècle, de ses débuts à une époque proto-contemporaine – pour dire vite : des calèches aux Ipods. La langue y est verte, c’est donc que des tournures fort exotisantes ponctuent le récit. La trame paraît d’abord méandreuse, elle s’éclaire assez vite, mais d’une lumière blafarde : on nous raconte la haine d’un gardien de but pour un arbitre indolent ayant accordé un but qu’il aurait dû refuser, on nous raconte ensuite la haine d’un homme au printemps de sa vie pour un facteur libidineux – ce sont les mêmes hommes –, on nous raconte enfin la haine d’un entrepreneur fortuné pour un facteur peu fortuné. Ces deux hommes appartiennent d’une certaine manière aux origines mythiques de La Frayère. La bête creuse tente de tirer de ces mythes des conséquences transgénérationnelles, sous la forme d’une malédiction ou quoi d’autre encore ; on plonge dans la légende volontiers, on espère même un peu l’épopée.
On pourrait évidemment prendre le roman par l’autre bout : un jeune doctorant désargenté, alcoolique, perdu à Montréal loin de sa famille, erre, poursuivi par une bête mystérieuse qu’il craint plus que tout. Au bout d’une traversée un brin épique, il revient dans sa Gaspésie natale où il est à même de mesurer sa médiocrité, mais s’en gardant bien.
Le poids du mythe
Ces trames se collent, s’additionnent, se relancent, à la recherche d’un peu d’air dans un récit asphyxié sous son propre poids : très vite, à peine dépassées les 200 pages, l’essoufflement devient palpable, et les relances, les accélérations de l’intrigue achoppent un peu. L’affirmer comme ça, remarquez, c’est jouer au médecin, il ne respire plus – ça ne suffit pas. Il faut saisir ce que ce poids nous révèle. À cet égard, on peut dire que le roman de Christophe Bernard s’avère des plus conscients des menaces qui le guettent.
« Y a plus de mythe possible chez nous, c’est ça le problème », grommelle Honoré Bouge dit Monti dans les dernières pages de La bête creuse. Il franchit lui-même les derniers miles de sa vie et regarde avec nostalgie toutes les légendes que son élévation sociale a disséminées dans le village de La Frayère. Ce mythe impossible grève le roman de Christophe Bernard comme l’espoir d’un ton capable de faire naître l’extraordinaire possible, l’extraordinaire partagé, mais tout cela paraît trop alourdi du simplissime réel. Un peu comme les fictions d’Éric Dupont – d’ailleurs elles aussi plantées dans le paysage gaspésien –, ce roman cherche à se détourner du réel, s’y bat au corps à corps, pour faire surgir la fantaisie. Et ce n’est pas faute que les légendes ne soient véhiculées; elles s’actualisent dans ce roman, sont partagées, fondent un récit collectif, mais de plus en plus délesté de sa pertinence. Ainsi de Yannick, le petit-fils du légendaire Monti : « T’avais des versions de la légende qui se transmettaient encore tout le tour de la péninsule chez les aînés. Les jeunes comme Yannick connaissaient l’anecdote aussi, leurs parents ou grands-parents la leur racontaient depuis qu’ils étaient aux couches. Mais cette génération-là en pouvait plus des histoires du genre. Pour Yannick et ses amis, c’était rien que des fabulations, des délires de gars chauds, des coups montés qui comme tant d’autres choses avaient pris une ampleur irréversible par le bouche-à-oreille. » (534)
Désirer malgré tout
La fiction inacceptable, voilà sans doute ce qui accroche dans La bête creuse : un désir de grand, de gros, un désir d’épopée que le livre sait impossible. On aura beau mettre en scène une fête obscène où beaucoup trop d’alcool, de drogue, de violence seront consommés, on a beau raconter un périple confus de Montréal à La Frayère ou expliquer comment, grâce à un ersatz de ruée vers l’or, un cul-terreux devint l’âme (économique) d’un village, cet ensemble ne suffit pas. On se retrouve à la fin un peu comme Monti, ce pilier de légende qui, ayant aux débuts de sa vie découvert l’Odyssée d’Homère dans une chambre d’hôtel bas-de-gamme de Toronto, renoue avec sa lecture dans les rayons de la belle bibliothèque du village qu’il a lui-même fondée. Reperdant le livre durant plus d’une décennie, il remet enfin la main dessus pour en poursuivre le décodage, mot à mot, espérer l’épopée une dernière fois. Il y a là, en effet, tout le désir de La bête creuse, et toutes les conditions de son impossibilité.
Émane de ce roman, de-ci de-là, des moments d’humour burlesque, des scènes rythmées, dynamiques ; à l’instar de la communauté de La Frayère, on habite les légendes, à ceci près qu’on les voit par la lorgnette d’un livre, par sa mise-à-plat obligée. C’est moins la réjouissante inventivité qu’on perçoit, alors, que la difficile adaptation livresque de ce genre qu’est la légende, genre de récits en bouche molle partagés au comptoir de la taverne.