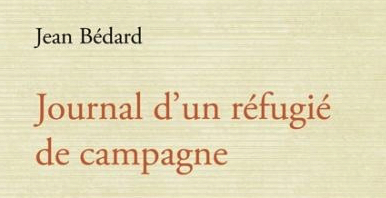Nyotaimori, texte : Sarah Berthiaume ; mise en scène : Sarah Berthiaume et Sébastien David ; avec Christine Beaulieu, Macha Limonchik et Philippe Racine ; scénographie, costumes et accessoires : Karine Galarneau ; musique : Navet Confit ; présenté au Théâtre d’Aujourd’hui (Montréal) du 16 janvier au 3 février 2018.
///
Il y a deux spectacles dans Nyotaimori, l’un nettement meilleur que l’autre. Il y a d’abord l’histoire de Maude et de sa blonde (jamais nommée), du travail incessant qui s’immisce dans leur vie de couple – Maude est rédactrice-autrice-blogueuse-chroniqueuse-journaliste et j’en passe, bref, c’est une pigiste payée plus en « visibilité » qu’en espèces sonnantes et trébuchantes – et d’un homme qui participe au concours Hands on a hard body à Austin, Texas dans le but de gagner une Yaris. Après que la vie du couple ait magiquement croisé celle de l’homme s’ajouteront deux travailleurs d’usine (une femme qui confectionne des « Empowerment Bra » dans une usine de textiles en Inde et un homme, au Japon, qui caresse des carrosseries de voitures pour traquer les imperfections) dont la quête de liberté sera liée à celle de Maude.

La première partie est certainement solide : Berthiaume attaque différents sujets avec la justesse réaliste qu’on lui connaît dans les dialogues et une grande efficacité dans l’enchaînement des situations, dès la première scène où Maude interviewe un « créatif » dans une start-up jusqu’au découragement de la blonde qui apprend que les vacances sont compromises par un énième rush de travail. En s’inspirant de faits divers, l’autrice trouve dans le réel une matière féconde et brosse un portrait juste, à défaut d’être original, des enjeux professionnels de sa génération. Le travail peut-il être un espace de liberté ? Comment tracer la limite entre le travail et la vie quotidienne pour un pigiste ? Jusqu’à quel point utilise-t-on l’idée d’être toujours débordé par le travail pour se valoriser ? Quiconque connaît la précarité d’emploi et le travail à son compte – j’en suis – reconnaîtra ce mode de vie reproduit avec acuité, jusque dans le défi de finir le texte à écrire au lieu de procrastiner en ayant onze tabs ouverts sur Chrome…
À cela s’ajoute, comme dans les textes précédents de Berthiaume, une dose de réalisme magique qui crée des situations à priori improbables en plus de laisser les personnages tour à tour narrer l’histoire et connaître les pensées des autres. Le tout culmine dans une séquence haletante – bruits amplifiés de battements de cœur et lumière rouge en prime – où l’homme du concours, Maude et sa blonde sont liés parce que cette dernière traverse l’écran d’ordinateur, comme Alice le miroir ou le terrier du lapin, pour se retrouver au Texas.
Sens dessus dessous
La blonde disparue, l’homme du concours laissé à son sort, on suit ces deux nouveaux personnages – les travailleurs d’usine – dont la vie croise celle de Maude par des portails improbables (le coffre d’une voiture ou la porte d’une usine de soutien-gorge) qui permettent de voyager d’un lieu à l’autre. Alors, Berthiaume commence à se répéter, enfonce le même clou et alourdit le récit qui prend une tournure trop didactique ; le texte prend des allures prêchi-prêcha qui rejouent des situations déjà connues sans qu’on y apporte un éclairage particulier.

On a l’impression d’être assis entre deux chaises : Berthiaume semble vouloir construire ces nouveaux personnages, leur donner une chair et un corps pour qu’on s’intéresse à eux, mais en même temps, elle multiplie les ruptures de ton, les écarts ironiques et métatextuels qui d’une part empêchent d’être happé par l’histoire et, d’autre part, diminuent la portée du discours. On est presque exclusivement dans le « réalisme magique », mais celui-ci est toujours mis à distance par de courtes répliques des personnages, toujours bien conscients de leur situation et qui continuent de prendre en charge la narration.
C’est que Nyotaimori ratisse large, trop large : objectification du corps des femmes (ce que le titre, référant à une pratique japonaise qui consiste à manger des sushis sur le corps d’une femme, suggérait déjà), limites poreuses entre le travail et la vie personnelle, instrumentalisation de la liberté par les entreprises, aliénation psychologique et physique du travail, vacuité et pouvoir écrasant du marketing, tout y passe sans que la deuxième partie approfondisse ce que la première avait déjà brillamment illustré.
De plus, l’analogie entre la vie de Maude et celle des travailleurs d’usine reste peu féconde. L’alternance des scènes entre leurs réalités (économiques, physiques, intellectuelles) distinctes finit, peut-être sans le vouloir, par créer une adéquation maladroite. Berthiaume n’arrive qu’à effleurer le cœur de tous ces sujets, ne laissant au final qu’une sentence un peu tarabiscotée : la vraie liberté, c’est l’échec, l’impuissance, ne pas avoir de choix, bref, n’avoir rien à faire.
Scène sans relief
Malheureusement, la lourdeur du discours est redoublée d’une mise en scène peu inventive jusque dans les déplacements, qui semblent obéir à la seule logique de « ça fait quelques minutes qu’on est statiques, il faudrait bouger » (l’ouverture du spectacle est exemplaire en ce sens). Le tout se déroule sur une estrade surélevée carrée, placée au milieu de la salle et entourée de gradins sur les quatre côtés. Avec l’éclairage presque toujours plein feu qui laisse le public se voir, on se doute bien que Sarah Berthiaume (qui cosigne sa première mise en scène) et Sébastien David espèrent que les spectateurs se reconnaissent dans les situations jouées ; de même, on imagine que l’espace de jeu réduit doit refléter l’enfermement psychologique que vivent les personnages. Pour un spectacle qui s’appuie autant sur l’idée de lieux revitalisés, détournés de leur fonction première ou hors-normes (une ancienne usine désaffectée, un quartier ouvrier construit comme une ville), il est dommage que la scénographie et la mise en scène donnent autant peu à voir.

Vers la fin, les personnages se décrivent essentiellement comme « trois imperfections autour d’un tas de sushis qui ont eu chaud, mais qui font la job ». À l’image du bonhomme tubulaire gonflable (inflatable tube man) gesticulant dans tous les sens, prisonnier et libre de son souffleur à air, qui fait son apparition au mi-temps du spectacle, Nyotaimori s’essouffle et s’éparpille en ne nous laissant qu’un plaisir passager.
crédits photos : Valérie Remise