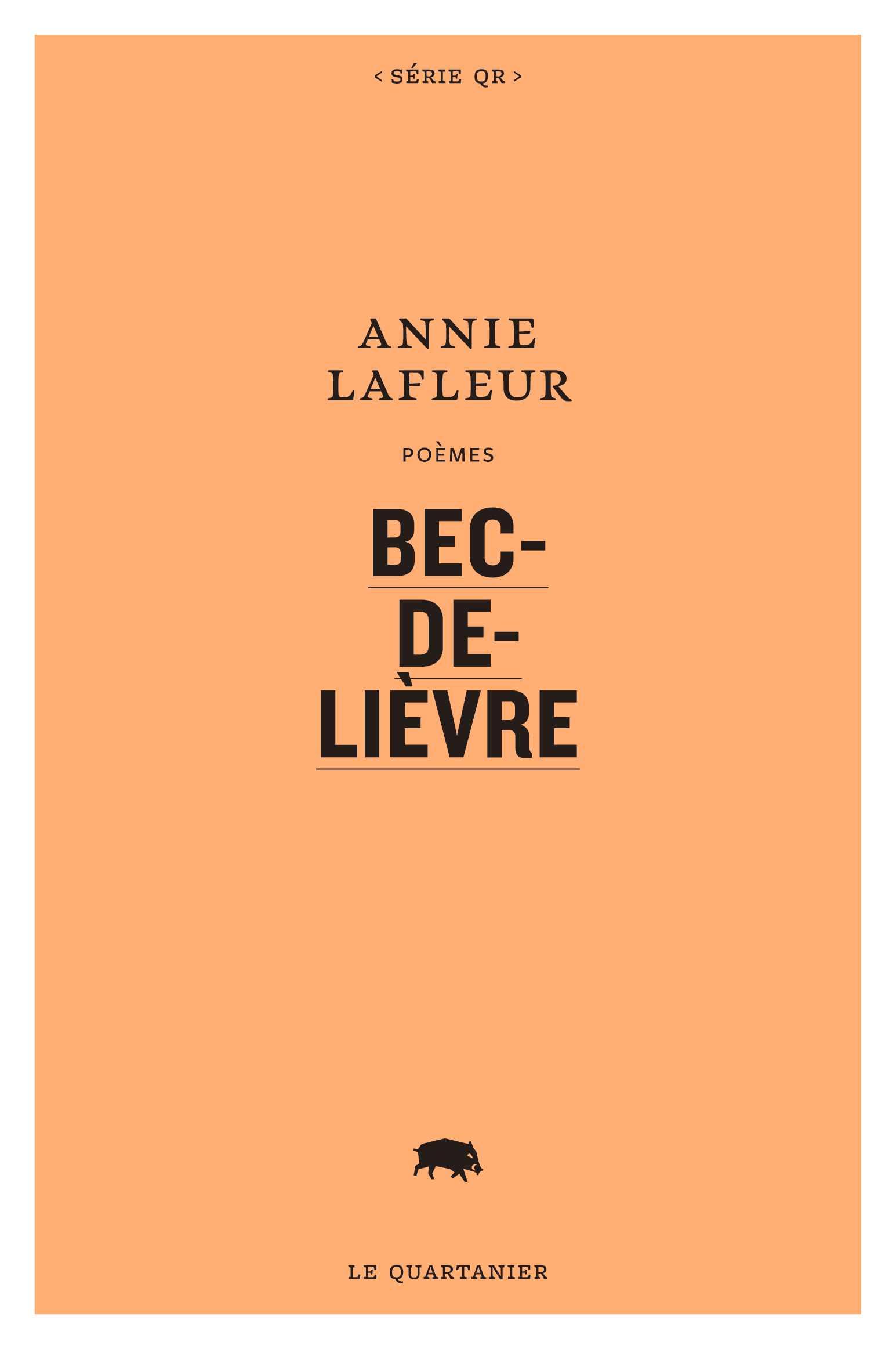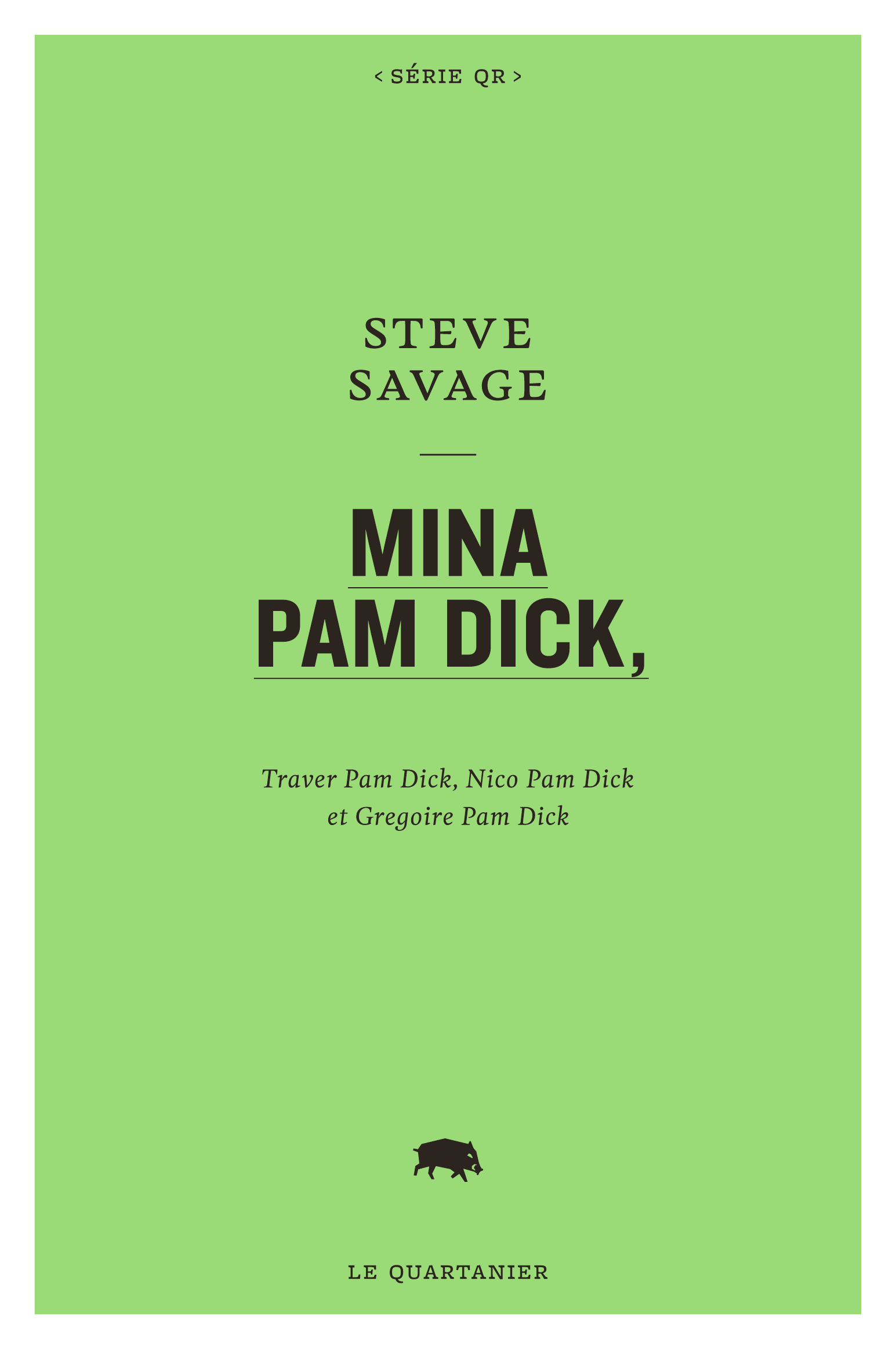Annie Lafleur, Bec-de-lièvre, Montréal, Le Quartanier, 2016, 64 pages.
Steve Savage, Mina Pam Dick, Montréal, Le Quartanier, 2016, 88 pages.
///
Annie Lafleur, avec Bec-de-lièvre, signe son quatrième recueil, son deuxième au Quartanier. Son travail se caractérise par sa problématisation de la représentation : ses poèmes accumulent les saillies et les lignes de fuite autour d’objets ou de situations qui se dévoilent à peine. La lecture, réduite à des hypothèses et à des tâtonnements, ne restitue que l’incertitude quant à ce qui évoqué. Son plus récent livre poursuit cette exploration, comme en témoigne la quatrième de couverture, où Lafleur circonscrit son projet d’écriture en multipliant les énigmes : « La lèvre déchirée cherche le reste du corps dans l’habit des animaux. S’il n’y a personne, il y a beaucoup de choses, à déterrer, à casser, à perdre. » Cette « lèvre déchirée » serait-elle une métonymie qui renverrait à la bouche, et par corollaire, à la parole ? Et ce « corps » recherché serait-il cet être authentique dissimulé sous « l’habit des animaux » ? Qu’en est-il de cette « langue [qui] fuit la bouche, gagne du terrain, fouille les buissons » ? Est-ce la poésie ? Sans doute, mais sur quoi gagne-t-elle « du terrain » ? Que sont « les buissons » ? Et puis, que doit-on comprendre de ce passage vers la fin du texte : « De l’enfant à la vieille bête, celle qui aura tout avalé voudra tout revoir, pour une dernière marche en forêt » ? Doit-on l’interpréter comme l’aveu d’un projet autobiographique ? À quoi renvoie cette ténébreuse « dernière marche en forêt » ?
Ces incertitudes qui s’amoncellent, ces équivoques qui désarçonnent, voilà cette forêt que doit traverser le lecteur en compagnie de la poète. L’absence soigneuse de référents renvoie à l’opacité du rapport à soi et à l’autre façonné par l’indicible, comme l’affirme le second poème du recueil : « Ne jamais être morte / ni tout à fait claire / […] ne jamais en finir avec soi […] / tu naitras ici / criblées de finales / paumes sorties des mains ». En effet, part réinvention, part investigation d’une mythologie toute personnelle, le propos de Bec-de-lièvre ne se livre pas aisément. Le lecteur doit naviguer à travers une série de moments rapportés sur le vif : « l’eau du miroir bu / avec l’hirondelle / éveillée de partout / elle écoute aux chambres / le vol des voitures ». Des motifs thématiques récurrents, comme la bouche, les doigts, le chien, le cheval, les miroirs, peuplent des textes elliptiques à la syntaxe minimale : « Elle court elle boude / vide sa ligne de vie / ce n’est plus une enfant / ces choses qu’elle vit maintenant / qu’elle lit maintenant ». L’énonciation oscille aussi entre la première, la deuxième et la troisième personne du singulier d’un poème à l’autre, ce qui complexifie d’autant plus l’identification de l’énonciataire : est-ce que la poète s’adresse à une complice ou à elle-même ? À celle qu’elle aurait pu être ou à celle qu’elle a été ?
Se perdre et se retrouver
L’énonciation flottante, la syntaxe simplifiée et le phrasé elliptique confèrent à ce qui est évoqué une impression brute, un peu comme si un enfant décrivait les choses qu’il voyait sans les expliquer : « la cuillère brûle / sous le jupon / dans le train on m’ouvre / sa lèvre mère ». Il y a dans ce sens fuyant quelque chose d’aliénant, d’étouffant, comme si la fragmentation du texte figurait un traumatisme dont la source est difficile à identifier. Pour l’éclairer, il faut revenir un peu en arrière et relire les deux poèmes liminaires ouvrant la première et la deuxième partie, plus longs que les autres. Dans l’extrait suivant, la volonté de rompre avec soi est explicitée, ce qui donne une assise au morcellement auquel se livre la poète :
on a blanchi
on a campé marché dans les sentes coupé du bois en petites roches
on a détruit nos photos nos cahier nos visages
on a tout jeté au feu
déchiré nos ceintures mangé les baies
L’ensauvagement est une manière de rejeter une identité construite de l’extérieur, imposée par les institutions sociales et le regard d’autrui. L’impuissance qui résulte de cette identité subie est thématisée dans le second poème liminaire :
à bétail égal ta pensée t’abat jour et nuit
les drones te cherchent dans tous les dessins
au centre de tes poings mal pliés personne
ne te sauvera du bout des bras personne
dans l’arbre léger les bagues te lâchent déjà
La liberté, dans ces conditions, réside dans l’abandon de ce carcan identitaire, « châssis du système » comme l’écrivait Paul Chamberland dans Éclats de la pierre noire d’où rejaillit ma vie, en élaborant une langue personnelle qui s’opposerait aux « codes courants », pour citer une fois de plus l’auteur d’En nouvelle barbarie. La défamiliarisation poétique répondrait donc à un impératif d’authenticité qui permettrait à la poète d’exercer une souveraineté sur son passé et son identité : « J’apprends à me lever / à toutes les hauteurs. »
Aussi, le recueil gagne en unité à mesure de sa progression. La troisième partie affiche un « je » beaucoup plus assumé, comme sorti des broussailles : « Le miroir cassé / évente mon visage / je n’ai pas besoin d’aide / je n’ai besoin de rien / et la mort ne vient pas ». La poète y affirme visiblement sa réconciliation avec elle-même, avec ce « visage » qui demeure en dépit du « miroir cassé ». La sérénité qui se dégage des phrases affirmatives de cet extrait est à l’avenant : la poète, en refusant le secours extérieur, accepte d’affronter seule, il me semble, la précarité d’une identité fragmentaire et morcelée, mais authentique. Cette conquête de soi, pour ainsi dire, ouvre la voie à des possibilités inédites. C’est du moins ainsi que j’interprète les derniers vers du recueil de Lafleur : « aile soudée aux doigts / une fois prise la main / une fois lâchée l’aile / aucune ne sauve / l’ancien toi qui dure / le pigeon d’argile / masquant le soleil / ses miettes divines / son premier noir ».
Recueil dense, souvent déroutant, Bec-de-Lièvre se révèle au final l’expression d’une résistance poétique nouée aux fibres les plus profondes de l’intime.
///
Les livres de Steve Savage sont fascinants. Et un peu effrayants. Bon, d’accord, ils sont surtout effrayants. Ils effraient quiconque tente de leur faire entendre raison. Ils effraient le critique que je suis, celui qui doit donner l’impression d’une certaine maîtrise de la matière abordée pour convaincre de son utilité, du bien-fondé de son jugement. Or, les objets littéraires de Savage déjouent les attentes en bousculant les habitudes de lecture.
Hors normes dès son titre qui déborde dans le sous-titre, Mina Pam Dick, Traver Pam Dick, Nico Pam Dick et Gregoire Pam Dick, son quatrième opus au Quartanier, n’échappe pas à la règle. Il s’agit d’un hommage explicite à Delinquent, un ouvrage publié par celle qui se fait appeler Mina Pam Dick en 2009. « Mésadaptation » plutôt que traduction, le livre de Savage dynamite la langue et la philosophie en le faisant passer à la moulinette de l’irrévérence punk. Foin de l’ordre et de la logique, des lois du réalisme et de l’identification, de la bienséance de la représentation ; au contraire, on assiste à une réelle célébration des mots et de la richesse de leurs possibilités, au pouvoir pratiquement infini de l’invention verbale lorsqu’on daigne la libérer du carcan des cooccurrences et de l’isotopie. « Vive l’unité imaginaire ! » entonne l’auteur avant le tout premier texte du recueil, en italique s’il vous plait.
En effet, dans Mina Pam Dick, tout est en trompe-l’œil. Les mots cèdent et se déforment sous les pas de l’aventurier-lecteur. Il est entrainé dans tous les sens par des chaines d’associations qui tiennent souvent à l’homophonie ou à l’homonymie : « Faire des verres, faire des vers. Libres, non libres. Le vers, a verse, verse une larme, a tear ou a tear, une entaille, l’anagramme de raté sans accent. » Traducteur, Savage s’amuse périodiquement à passer du français à l’anglais ou inversement, en puisant ici et là dans l’allemand.
La forme éclatée est aussi particulière : tantôt empruntant aux paragraphes aphoristiques qu’on retrouverait dans les œuvres de Nietzsche ou les carnets de Wittgenstein, tantôt adoptant des listes de propositions numérotées, un peu comme dans L’éthique de Spinoza, Mina Pam Dick favorise une discontinuité désormais familière pour nous à cause d’internet. Ainsi, le propos progresse par sauts, passant d’une idée à l’autre, un peu comme la navigation entre les différentes pages du web, liées entre elles par des hyperliens :
11
Hermès (her mess – une mauvaise blague), aussi connu sous le nom de Mercure, est le dieu de l’invention. Je ne connais ni les chefs-d’œuvre de la poésie ni les citrons de la poésie.
11.1
Un vieux thermomètre gradué.
12
J’allais m’attacher à ma Hermes Rocket pour décoller. Je n’ai pas d’ailes aux pieds.
L’extrait précédent l’illustre assez bien : le danger que pose une entreprise de déconstruction aussi radicale est de vers dans la gratuité et le non-sens. Ici, ce n’est pas le cas grâce notamment à l’abondant intertexte culturel qui sert de caution à l’humour de Savage. En puisant dans l’encyclopédie des monuments de la philosophie et de la littérature, il s’assure d’une entente minimale avec son public, qui peut à partir de là apprécier les effets de décalage imaginés par l’auteur. Leur conjugaison avec des références issues de la culture populaire, comme John Denver ou Lou Reed pour ne nommer que celles-là, crée une proximité, voire une complicité avec les lecteurs.
La dimension personnelle de Mina Pam Dick se révèle d’ailleurs en filigrane, soutenue par des remarques autoréférentielles comme celle-ci :
Sauvage est le nom de mes ancêtres. Un jour, sans trop qu’on sache pourquoi, mes ancêtres changent de nom, deviennent Savage. Mais l’anglais savage, c’est toujours sauvage. On n’échappe pas à son nom. On ne se sauve pas de son nom.
Jouer aux mots
La constellation des références et des pseudonymes doit aussi son unité à la présence de cette conscience joueuse, qui se livre sans jamais réellement se nommer par le jeu de l’écriture. L’identité se meut dans cet espace infime entre la dénotation et la connotation, entre un nom dans le dictionnaire ou sur une liste électorale et le sens qu’il revêt lorsque la parole de quelqu’un l’anime. L’ensemble des permutations, commutations, altérations que Savage fait subir aux mots les vident du poids de leur définition et les rend malléables, ouverts au jeu de l’écriture et de la création, ce qui permet leur appropriation, leur personnalisation. Autrement dit, il est possible de lire Mina Pam Dick comme une autobiographie qui tait obstinément son nom, une autobiographie qui offre aux lecteurs non pas un ensemble de faits pour reconstituer un vécu, mais plutôt un instantané des références culturelles qui l’anime, dont l’agencement particulier révèle un style, un esprit, une originalité, bref, une âme.
Cette exploration rafraichissante des tensions entre la langue et l’identité n’est pas la moindre force de cet ovni littéraire : derrière le florilège verbal, les coq-à-l’âne contrôlés, les listes sans queue ni tête et les blagues sur les philosophes, on ne sent pas la poussière d’une thèse ou la mécanique d’un projet d’écriture. Mina Pam Dick amuse. En effet, Savage fait figure de libérateur : la souplesse anarchique de ses associations transforme en jeu ce qu’on croyait enterré dans le cimetière des humanités. La bonne humeur facétieuse de Savage est contagieuse : on se surprend, une fois le livre refermé, de voir des Mina ou des Traver un peu partout, de chercher des anagrammes sur les panneaux routiers ou les affiches dans le métro ; on se surprend, une fois le livre refermé, à poser un regard neuf sur notre monde.