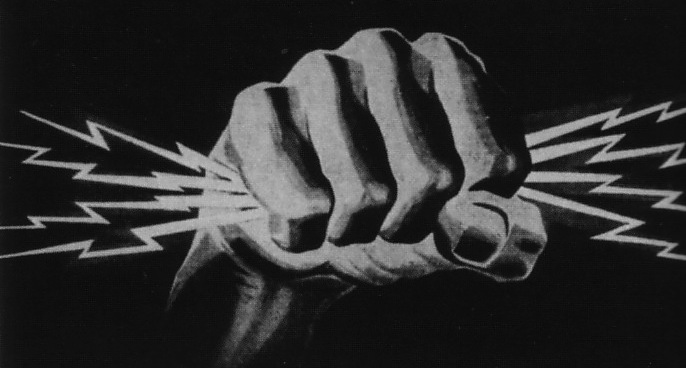Mauricio Segura, Oscar, Montréal, Boréal, 2016, 240 pages.
///
Oscar Peterson est de ces bêtes lumineuses au fantôme pesant que l’imaginaire collectif québécois se permet de réincarner périodiquement, à travers des espaces communautaires, des parcs et des murales. Fils d’immigrants caribéens né en 1925 dans la Petite-Bourgogne, Peterson jouit d’un récit personnel qui présente tous les éléments propres à une réécriture de l’histoire avec un grand H., notamment en raison de la complète disparition du quartier et de la dissémination d’une bonne partie de la communauté au sein de laquelle il a évolué.
Ne nous leurrons pas, en 2016, il ne reste plus rien de la Petite-Bourgogne d’Oscar, de la communauté qui y avait posé ses cotonnades colorées, de l’église que celle-ci fréquentait ou même des établissements qui hébergeaient les premiers contingents d’adeptes de swing (et de la plupart des autres mouvements qui jalonneraient l’histoire du jazz, du bebop jusqu’au «fusion», en passant par le «free»).
Oscar, le plus récent roman de Mauricio Segura, publié chez Boréal, reprend le mythe d’O.P. sous le couvert de la fiction, mais peine toutefois à convaincre tant l’esprit potache et la forme mal maîtrisée l’emportent sur le fond et l’idée de départ, pourtant inspirée.

Oscar Peterson, avec sa soeur Daisy. Source : Library and Archive Canada
Oscar le magnifique, Oscar le virtuose, Oscar le Montréalais?
Montréalais, Oscar? Rien de moins certain, si l’on se fie à l’histoire officielle. En effet, comme Segura le confiait à La Presse, plus tôt cette année, lors de ses recherches initiales pour retracer le parcours du pianiste lauréat de plus d’une demi-douzaine de prix Grammy, l’auteur a été surpris de réaliser qu’aucun ouvrage portant sur le jazzman n’avait été traduit en français. Pis encore, la plupart péchaient par révisionnisme historique en tentant de gommer l’enfance et le passé montréalais de ce Chevalier de l’ordre national du Québec.
Curieux, car durant quelques décennies, Montréal a été un centre névralgique du jazz en Amérique du Nord. En témoigne d’ailleurs de manière fascinante l’admirable livre de John Gilmore, Une histoire du jazz à Montréal, publié chez Lux, en 2009.
Un détail crucial que Segura met en scène de manière plutôt candide dans Oscar vient peut-être expliquer le tout : «Quant à leur communauté [caribéenne], tout le monde était convaincu qu’ils étaient les alliés des Canadiens anglais». En effet, il est de notoriété publique qu’après le départ de Peterson pour l’Ontario, en constant filigrane de son amour inconditionnel du fédéralisme pancanadien, se trouvait le fait qu’il ne se reconnaissait plus dans sa ville natale ni dans la province de Québec.
Excaver les voûtes ou inventer de toutes pièces
À l’image de l’irréprochable couverture signée Larysa Ray, sur laquelle les touches déglinguées d’un piano nous font souhaiter à l’instrument une intervention parodontale, Oscar est un roman au tranchant émoussé et aux chapitres inégaux, jouxtés à l’emporte-pièce, surtout en fin de récit. La diégèse du roman, dont l’auteur confiait qu’environ 80% était fabulée, souffre d’un manque flagrant d’homogénéité souligné par la présence exiguë d’un réalisme magique pourtant bien exploité en début de récit. Étrange donc de se dire que le diable affectionne les détails, puisqu’à travers le pacte faustien qui sert de trame narrative à Oscar, un manque de repères (bonds dans le temps, mariages en série à peine effleurés, etc.) nuit à une histoire convenablement entamée.
En effet, au sein d’une famille où, un peu comme il est coutume dans les Antilles, le mysticisme côtoie le christianisme, on aurait cru que le souffle de ce roman serait véritablement porté par une touche de vaudou raccordant la fiction au réel. La manière de raconter les premiers pas des Peterson à Montréal tient toutefois bien la route. Du court succès d’estime dont jouit Brad, le grand frère – musicien lui aussi – que la tuberculose («la peste blanche») emporte, jusqu’aux premiers sons de la trompette qu’Oscar abandonnera pour le piano lors d’un séjour à l’hôpital (tuberculose, lui aussi), on sent la présence de tous les ingrédients nécessaires à un récit qui aurait pu inscrire Peterson dans un imaginaire autre que celui de bon jazzman souriant.

À vrai dire, le personnage de Davina, la mère d’O.P., dont les discours sont parsemés de mots créoles, d’incantations et de prémonitions, fournit au livre ses meilleurs moments. Du moins, jusqu’à ce qu’un certain rythme, malheureusement éphémère, mène le lecteur à la tumescence de la popularité du pianiste, dont l’imprésario, Norman Granz (Norman G., dans le roman), est ici imaginé comme un dandy méphistophélique.
Interprétation forcée
L’un des problèmes majeurs de la prose de Segura dans ce roman est l’utilisation de tournures – souvent à l’imparfait – qui placent le lecteur sous la contingence des règles tutélaires de l’interprétation forcée. Une mainmise sur le discours qui non seulement alourdit le texte, mais incite à s’extraire du récit pour regarder autour de soi et tenter de trouver quelqu’un en position d’autorité qui voudra bien dire au romancier de nous laisser lire en paix sans commenter le déroulement de son propre texte.
Dommage, car pour avoir lu d’autres histoires signées Segura et, surtout, en sachant bien qu’il a déjà utilisé le jazz comme véhicule (voir à ce sujet la nouvelle «Aimez-vous le jazz?», parue dans Liberté, en 1994), on se serait attendu à une plus grande cohésion et une appropriation de la fiction plus assumée.
À ce sujet, on apprenait en début d’année que l’artiste plasticien indo-britannique Anish Kapoor avait acquis les droits exclusifs d’utilisation du Vantablack, une couleur qualifiée d’«ultra-noir», développée en 2014 par l’entreprise Surrey NanoSystems, dont les pigments absorbent la lumière dans une proportion de 99,96%, faisant de cette teinte le noir le plus «intense» sur le globe. En repensant à cette initiative où «peinture» et «liquidité» n’ont jamais aussi bien rimé, on se dira qu’au moins, l’histoire de Segura aura servi à inscrire officiellement Peterson dans un imaginaire livresque, où entre deux couvertures (et sous le couvert de la fiction), il pourra faire un pied de nez à la véritable appropriation culturelle : le monopole de la noirceur détenu par les révisionnistes qui ne sont ni auteurs de fictions ni détenteurs de droits exclusifs.