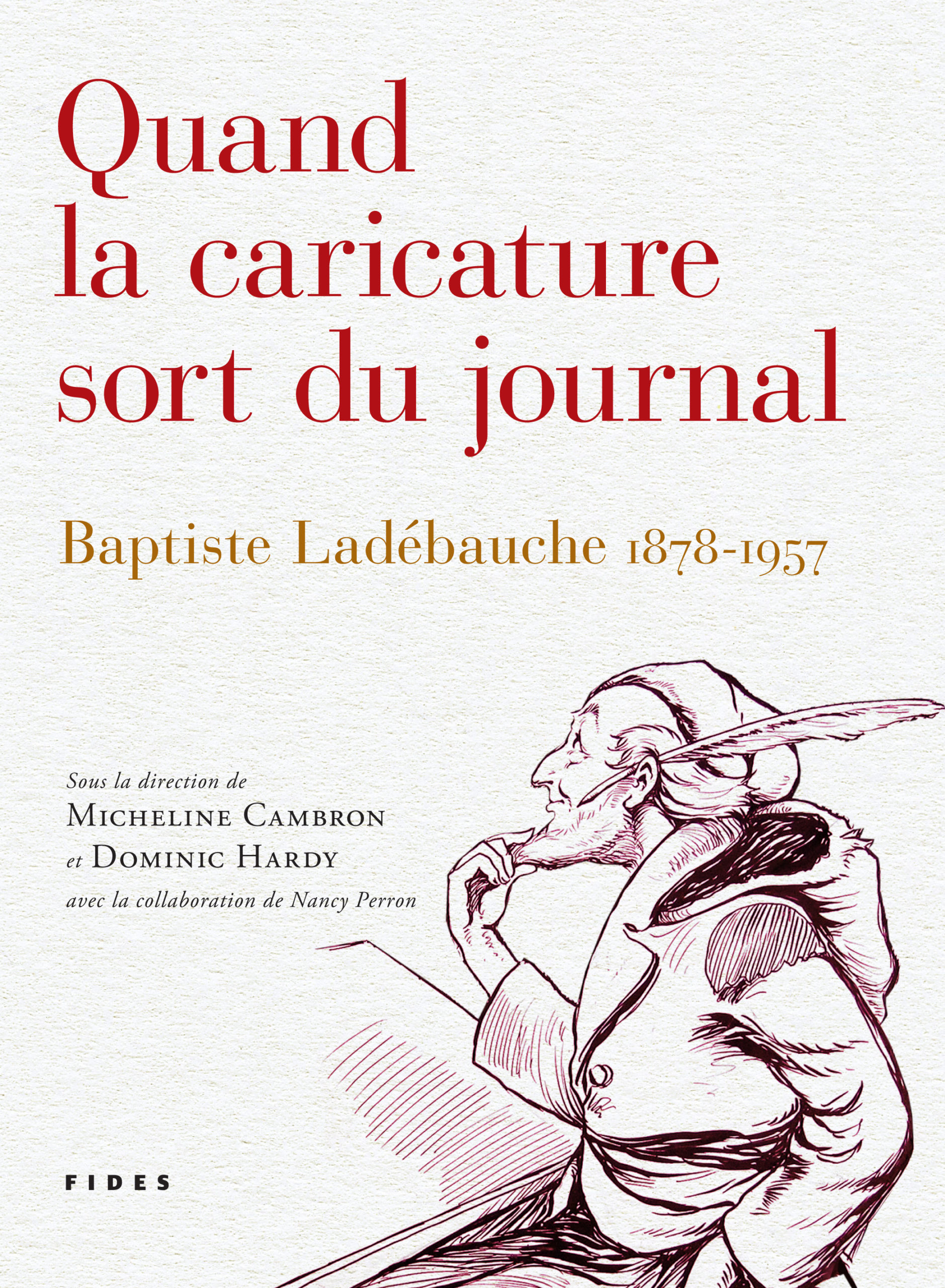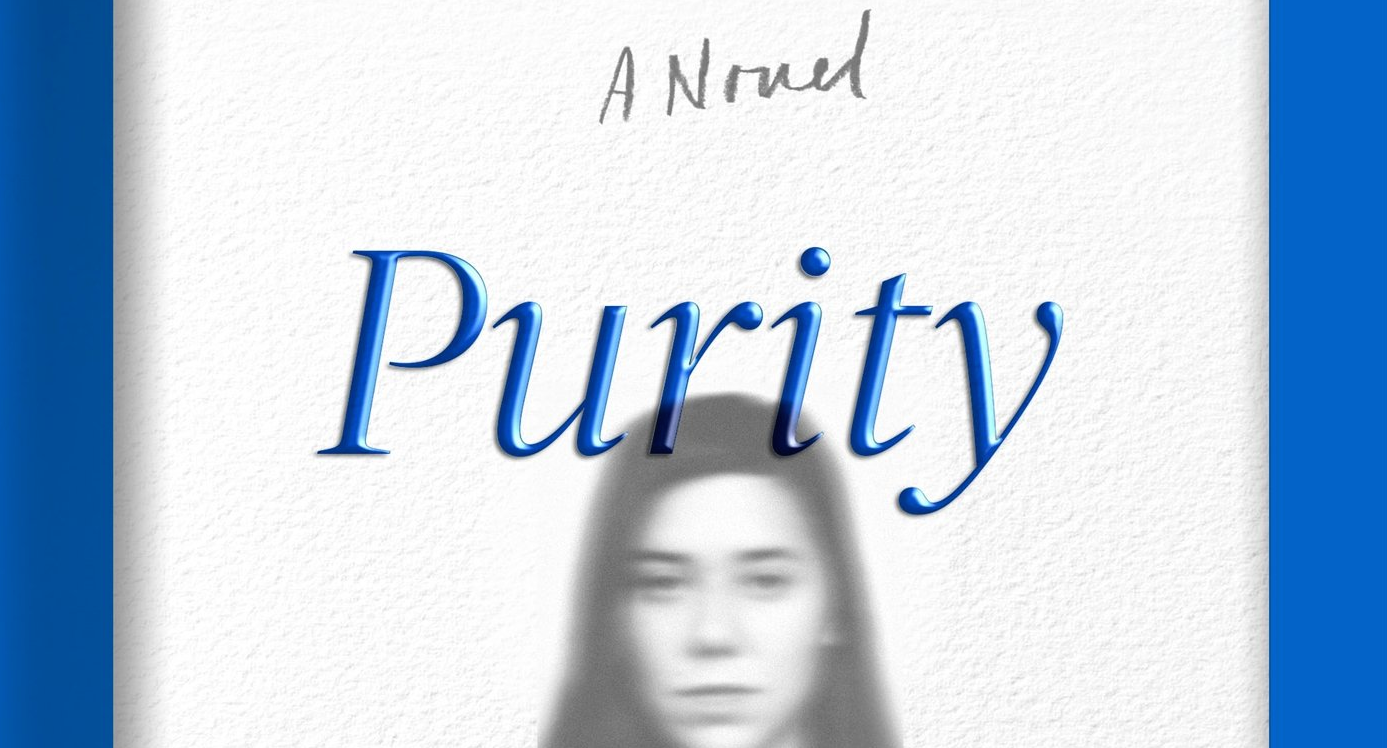Dans l’interstice séparant la publication de la chronique de Mario Girard de La Presse le 13 février dernier et celle quatre jours plus tard du premier témoignage d’une victime du cinéaste, s’est glissé ce qu’on trouve de plus bête et gauche chez l’homo quebecensis. D’un côté, un public en beau fusil qui a condamné au bûcher Claude Jutra sans procès, sans se donner la distance minimale nécessaire devant de telles allégations de pédophilie. De l’autre, le défilement d’un cortège d’artistes à la perspective tout aussi distordue, qui a pris la défense du cinéaste et tenté par la même occasion de discréditer Yves Lever, l’auteur de la biographie polémique en librairie depuis peu et dont les recherches sont à l’origine de cette triste et sordide affaire. De part et d’autre, c’est comme si les cinq étapes du deuil selon la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross (déni, colère, marchandage, dépression et acceptation) avaient tenté de se sauver d’une maison en feu en passant par le chas d’une aiguille. En somme, du beau gâchis d’où la vérité n’avait d’autre choix que de se tenir en apnée. À carreau.
Au cœur et en périphérie de l’industrie du cinéma québécois, quelques gueulards ont tôt fait de déplorer la promptitude avec laquelle Jutra, considéré comme l’un des plus grands cinéastes du pays, a été rayé de nos registres, publics ou toponymiques. En l’espace d’à peine deux jours ont été débaptisées la remise de prix annuelle qui portait son nom depuis 1999 et la principale salle de la Cinémathèque québécoise. Maints parcs, rues et avenues vont l’être également un peu partout dans la province au courant des prochains jours. Selon ces représentants – qu’ils le veuillent ou non – des «maudits artisses», ces décisions relèveraient d’un lynchage médiatique indu.
Au Journal de Montréal, Guy Fournier a d’abord rejeté les accusations graves d’une légère pichenotte. Yves Lever, motivé par l’appât du gain et le désir d’une notoriété lui faisant défaut, aurait fomenté un scandale afin de mousser les ventes de son ouvrage. Le reste de l’argumentaire béton de cet écrivailleur patenté? Si c’était vrai, on l’aurait déjà su. C’est ce qui s’appelle être sensible aux dizaines de raisons qui peuvent convaincre les victimes d’agression de se taire. Si c’était vrai, «[s]es amis les plus intimes l’auraient mis en garde contre les dangers qu’il courait en raison de sa notoriété.» M. Fournier, parle-t-on des mêmes amis qui acceptent difficilement une évidence de plus en plus incontestable?
Après l’apparition du premier témoignage d’agression dans les médias, Fournier feindra les remords dans une chronique subséquente. Il continuera de blâmer à demi-mot Lever et les Éditions du Boréal, tout en sous-entendant que rien ne changera au dénouement de cette saga. Agacé par le «désordre public» engendré, il va même jusqu’à suggérer que si on doit aujourd’hui «déboulonner les monuments, débaptiser les rues, les parcs, les salles et les trophées», c’est en partie à cause du silence des proches de Jean (pseudonyme de la première victime à dénoncer publiquement Jutra), qui eux savaient depuis des années.
S’il ne fallait s’attendre à rien d’édifiant de la part de Fournier, que doit-on faire de cette intervention du cinéaste Denis Côté, acculé par Nathalie Petrowski à la Berlinale, alors que celui-ci y présentait son dernier film Boris sans Béatrice : «Moi, je n’aurais jamais honte de recevoir un Jutra, pas plus que j’ai eu honte de recevoir un prix à Berlin, en Allemagne, un pays qui, avec le nazisme et l’Holocauste, n’a pas exactement un passé glorieux»? Aurait-on déjà atteint le point Godwin du débat? Difficile à dire, tant le précédent sophisme ne fait aucun sens. S’affublant ensuite d’une calotte de Sherlock Holmes, Côté ajoutera : «Yves Lever était un de mes profs de cinéma au cégep d’Ahuntsic et, si ma mémoire est fidèle, je ne l’ai jamais entendu dire du bien de Claude Jutra.» Eh ben voilà. C’est ce qui s’appelle faire preuve de déduction.
Pas la peine de revenir sur la désastreuse contribution de l’acteur Marc Béland à l’émission 24|60 (il a depuis fait son mea culpa à Tout le monde en parle), aux sénilités couchées par Lise Payette dans Le Devoir, à Chloé Sainte-Marie, qui aimerait que tout ce qui est associé au nom de Jutra demeure et qui a envoyé au Soleil une lettre contenant ce diamant brut : «J’ai le sentiment qu’à travers la répudiation unanime de Claude Jutra, le Québec tente de régler son compte avec un quelque chose en lui que je n’arrive pas à saisir.»
Sommes-nous étonnés que Richard Martineau et Sophie Durocher fassent leurs choux gras de ces sorties gênantes? Toute cette logorrhée vaseuse et ininterrompue, creusant davantage le fossé séparant la faune artistique du reste du monde, est faite du même moule que la chasse aux sorcières déplorée par ces premiers.
L’œuvre d’une vie
À force d’être exposé à cette friture, c’est à croire que les victimes ne sont plus les agressés, ceux brisés et contraints au silence, mais À tout prendre et Mon oncle Antoine. Des vues, bien belles reconnaissons-le, que nous voudrions collectivement priver de leur postérité par négationnisme. Si le hasard veut qu’en ce moment même je lis Pompes funèbres de Jean Genet, pédéraste devant l’Éternel, soyez sans crainte : les films de Jutra perdureront. Comme l’idée chez certains qu’il aurait été préférable de n’avoir jamais connu la vérité. L’Office national du film, qui détient les droits d’une quinzaine de films de Jutra, a annoncé qu’il continuera de diffuser ceux-ci sur leur site Internet. C’est ce qui importe. Pourquoi regretter parallèlement qu’un carré de tourbe change de nom sur le Plateau Mont-Royal?
Les actes odieux commis par Claude Jutra, s’ils ne viennent pas invalider son œuvre, lui confèreront à tout le moins de nouvelles teintes. Chaque film revu sera désormais mesuré à l’aune de cette tache indélébile qui, en plus de ternir une filmographie riche et puissante, touche directement tous les membre de la famille, amis et collaborateurs de l’artiste.
Avec À tout prendre en 1963, Jutra avait inventé avant l’heure l’autofiction au cinéma. Cherchait-il déjà à se prémunir d’un mal qui le rattrape aujourd’hui, 30 ans après sa mort? Se mettre en scène aux yeux du monde contient sa part de risques.