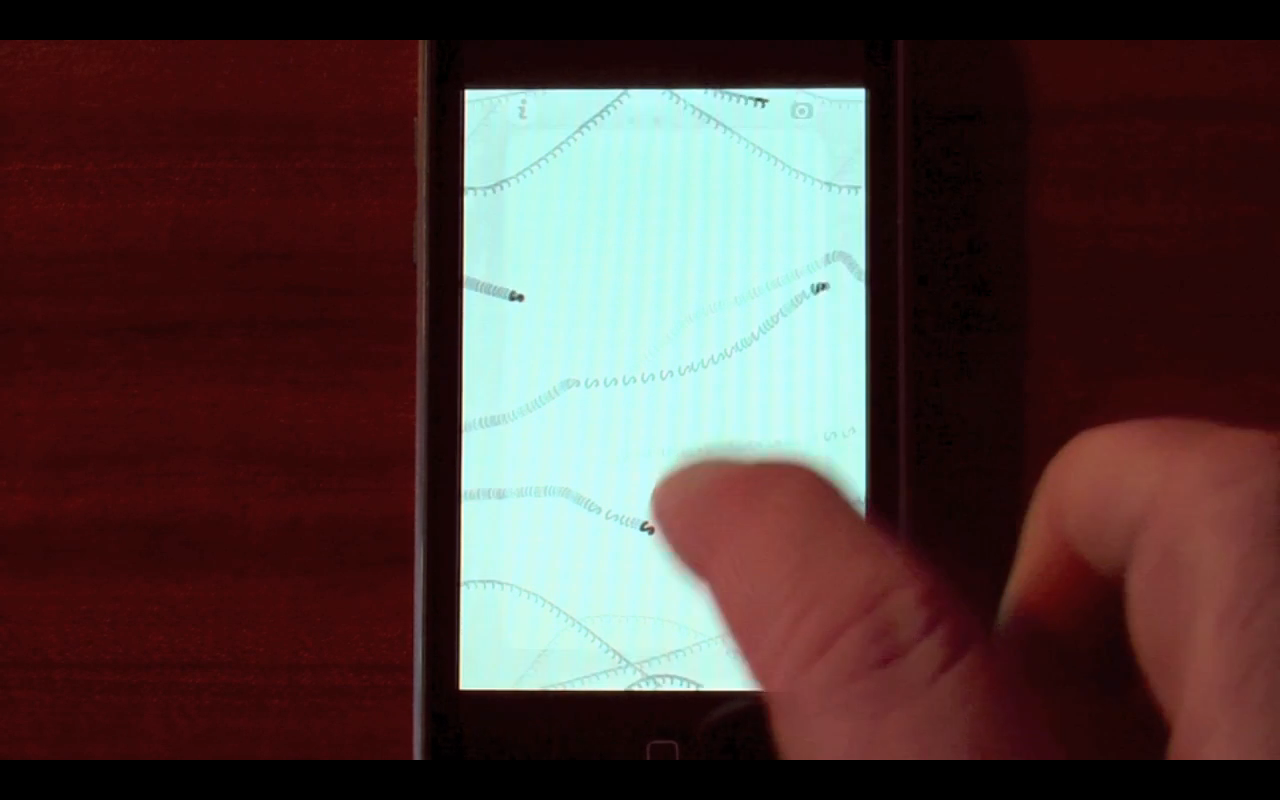Isolde
Texte et mise en scène de Richard Maxwell, scénographie de Sascha Van Riel, lumière de Zack Tinkelman, costumes de Romy Springsguth et Kaye Voyce. Avec Jim Fletcher, Brian Mendes, Chris Sullivan et Tory Vazquez.
Un spectacle de New York City Players présenté du 2 au 4 juin 2015 à la Maison Théâtre dans le cadre du Festival TransAmériques.
///
Au début de la pièce, Patrick suggère à sa conjointe amnésique, pour retrouver sa réplique, d’exprimer ce qu’elle ressent. En anglais, une réplique se dit a line. Les lignes oubliées de l’actrice trouvent leur écho dans celles proposées par Massimo, l’architecte qui a pour dessein de bâtir, à sa cliente qui veut du solide, une somptueuse demeure. Le projet n’aboutira pas et, au final, les seules lignes qui seront tracées seront celles que le temps aura laissées sur le front d’Isolde parce que, de son propre aveu, elle aime rire.
C’est à ce mot que je me suis accroché pendant que je m’ennuyais un peu. Car il y a bel et bien ici un réseau de sens qui se construit, pas celui dont Maxwell se sert volontiers pour parler d’Isolde, c’est-à-dire cette mythologie supposément immortelle qui lui permet de coller Tristan et Iseult à son spectacle créé en 2013, mais cette direction qu’il a donnée à son œuvre et qu’une autre réplique du spectacle peut évoquer : «There is no straight line in nature», ce qui marque en quelque sorte le tournant que vient de prendre son travail qui rimait jusqu’alors avec jeu désincarné – ce que les festivaliers montréalais ont pu admirer avec House (2001) et, plus récemment, avec Neutral Hero (2011).

photos : Michael Schmelling
Un jeu plat, oui, qui se voulait en réaction contre la tradition étatsunienne, et qu’on peut sans doute entendre dans Isolde lorsque la protagoniste lance à l’architecte devenu son amant, suivant une baise précipitée : «I don’t like when you talk about it.» Ne pas exprimer ses sentiments, donc, rendre plutôt platement les actions, presque machinalement, ne permettant ainsi pas aux acteurs de monter en scène avec leur intériorité, et leur passé.
La mémoire d’Iz – pour les intimes – flanche, autant lorsqu’elle répète son rôle que lorsqu’elle est elle-même ; «How can you mourn what you cannot recall ?», demande-t-elle, ce qui peut faire penser quelques instants à Annie Ernaux dans La place («Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L’écriture plate me vient naturellement […]»), mais pas trop puisque Maxwell, avec Isolde, se risque à mettre en scène certains soubresauts animés dont la ligne de partage avec son traditionnel jeu froid s’explique mal, pour ne pas dire pas du tout. En effet, on est tenté de voir dans les moments désincarnés moins un relent de sa signature esthétique que du mauvais jeu, surtout lorsque se pointe l’Oncle Jerry qui viendra aider le couple à foutre l’architecte rêveur à la porte ; scène qui n’est pas, du reste, sans illustrer l’idéologie capitaliste dont les enveloppes servent désormais à passer de l’argent plutôt qu’à envoyer des lettres d’amour.
Cet air du temps se manifeste également dans la posture de l’actrice qui s’inquiète d’arriver à un âge où les femmes disparaissent, clin d’œil angoissé à la tendance actuelle de tout consommer, même les êtres. C’est peut-être pour cette raison que Massimo (se) demande pourquoi on a cessé de créer de grandes œuvres, cela après avoir évoqué une mélancolie tout européenne.
La question de l’héritage est certes centrale et le spectacle se clôt avec une scène en fast-forward du mythe breton qui l’a inspiré, ce qui n’a pas manqué de désopiler l’auditoire particulièrement hilare. Cependant, la ligne que trace Maxwell entre le fameux roman et son Isolde se veut plutôt mince ; il aurait pu, après tout, pour traiter du «traditionnel triangle amoureux» (!), piger dans l’énorme bassin des fabliaux, voire dans une bonne partie du répertoire vaudevillesque. La passion brûlante entre Tristan et Iseult s’insère mal dans la pièce… mais en écrivant cette phrase, je ne peux m’empêcher de me demander s’il ne s’agit pas de la fatalité de cette époque que de se faire l’écho édulcoré des mythes qu’on s’acharne à vouloir interpréter.
Ainsi, le spectacle n’est pas dépourvu de pertinence qui s’articule autour des manifestes difficultés modernes à se (re)construire. Et la thématique architecturale d’être tout à-propos : l’espace à bâtir qui permet de se retrouver en se coupant juste assez du monde, les étages anglais qui se confondent avec histoires – auxquelles l’actrice affirme vouloir prendre part, afin de se sentir vivante –, la question des matériaux, de la lumière aussi sont autant de métaphores pour figurer la quête de l’Occident.
Or après avoir assisté, la veille, au magnifique Tauberbach d’Alain Platel, le monde de Maxwell m’a semblé dépourvu d’ampleur ; son tissu, bien que visiblement travaillé, a surtout pour fonction de nous rappeler en quoi nous sommes désormais en perte de sens, errant entre un passé supposé nous éclairer mais qu’on utilise parfois très mal, et les valeurs néolibérales qui sont le théâtre d’un manque criant de poésie. Mais ne le savions-nous pas déjà ? C’est un peu, après tout, ce que les manuels de mathématiques nous répètent depuis des siècles : qu’une ligne, c’est aussi une longueur sans largeur.