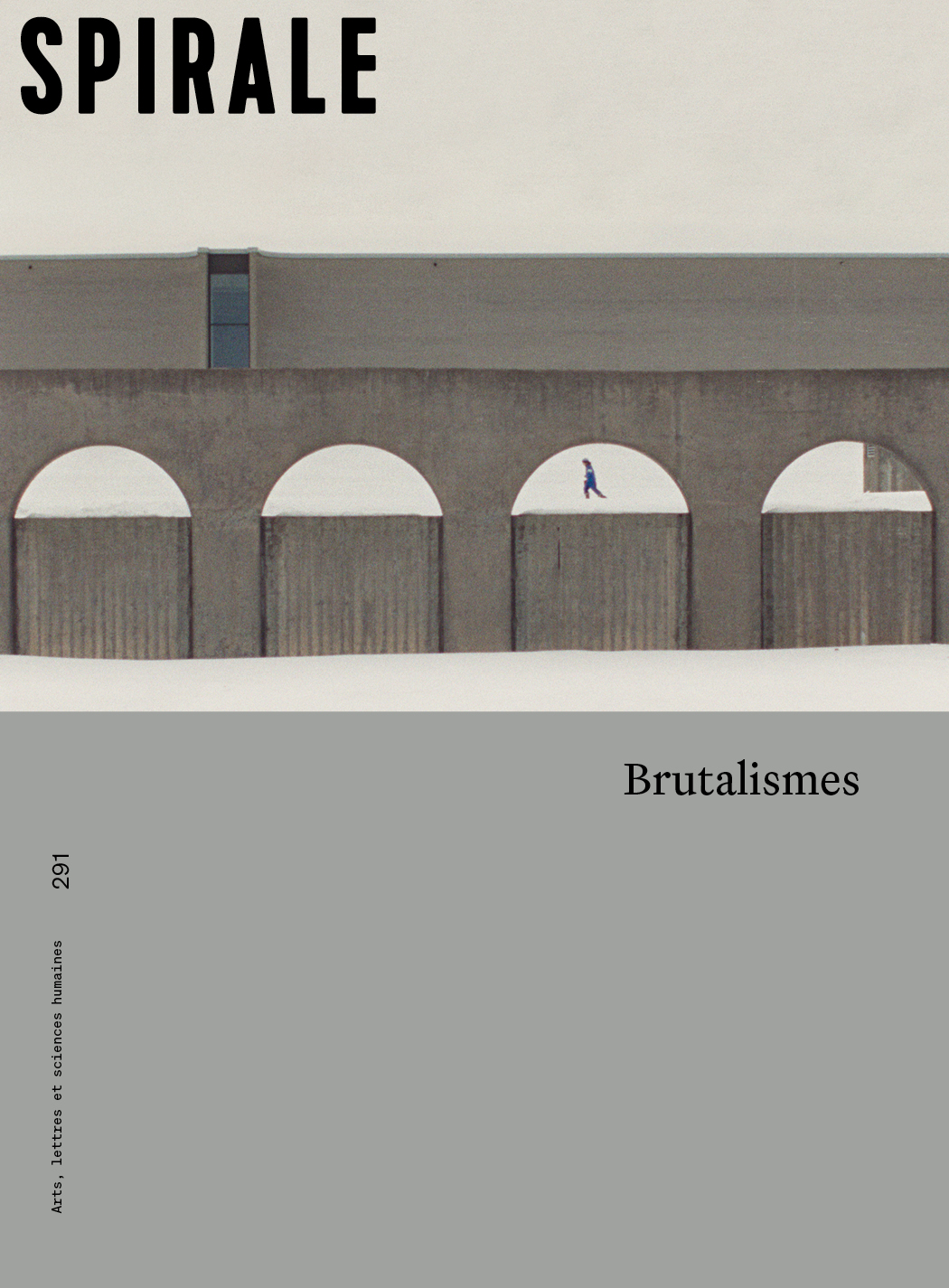Entretien conduit par Khalil Khalsi avec Nastassja Martin, auteure de Croire aux fauves, Verticales, 2019.
///
Jamais sa route n’aurait dû croiser celle de cet ours, lui-même égaré, dans les plis du Kamtchatka. Mais par le biais de ses lectures, de ses rencontres, de ses terrains d’anthropologie situés de part et d’autre du détroit de Béring, quelque chose en elle s’était depuis longtemps mis dans l’expectative de cet en-dehors du monde. Ses amis évènes, éleveurs de rennes de l’Extrême-Orient russe devenus chasseurs-pêcheurs à la chute de l’empire, l’appelaient déjà « miedka », mi-femme mi-ourse, lorsqu’elle leur racontait ses nuits peuplées de fauves. Aussi ce corps-à-corps avec la bête, mâchoire contre piolet, incarne-t-il cette tectonique des modes d’existence où rêve et veille, esprit et matière, humain et autre qu’humain se percutent et ouvrent une faille à partir de laquelle l’être grandit et se raccorde au monde. Croire aux fauves (Verticales, 2019) est le récit, pour le moins puissant, que Nastassja Martin livre de sa reconstruction ontologique après cet événement qui fait déborder le sens. Aujourd’hui, cette ancienne étudiante de Philippe Descola, l’auteur de l’ouvrage-phare Par-delà nature et culture (Gallimard, 2005), est une voix qui compte dans l’anthropologie de la nature ; ce champ de recherche œuvre à réhabiliter notre manière de nous relier aux autres vivants, et ce, en nous plaçant vis-à-vis des autres cosmologies dites « non-modernes », dont les populations qui les pratiquent font très souvent les frais de notre prétendue modernité. Entretien.
Khalil Khalsi : Tout au long de Croire aux fauves, et suite à votre rencontre avec l’ours, vous transcrivez votre impression d’être exactement à la frontière entre les mondes — humain et autre qu’humain, ici-bas et au-delà. Mais plus loin, vous avez peur que ce statut de miedka soit intenable, voire invivable. Aujourd’hui, diriez-vous que vous êtes parvenue à une forme d’équilibre entre les mondes ?
Nastassja Martin : C’est dans mon travail que je parviens à négocier cet équilibre. Ne pouvant statuer sur les mondes qui me traversent et que je traverse, je peux au moins le faire sur la posture que j’ai à y tenir, celle de chercheuse. Il s’agit de laisser le sens ouvert, en se sachant tout le temps sur la corde raide… Le monde tel qu’il est en train de se transformer insuffle cette nouvelle exigence à ma posture, qui n’est pas toujours facile à tenir, notamment au sein de la science et surtout en anthropologie, puisque je prends le parti de renoncer à produire un savoir stable sur telle ou telle population. Mais ç’aurait été aussi une autre solution de facilité que de s’abstenir de l’ambition heuristique des sciences humaines pour simplement faire de la littérature, au prétexte qu’il serait impossible de restituer le savoir de manière objective. La science n’est plus à l’abri de la perméabilité des mondes, et en même temps une autofiction qui ne dit rien du monde au-delà de soi-même n’est à mon sens pas viable. J’essaie donc de produire quelque chose à la médiane.
K.K. : En quoi consiste, concrètement, une telle posture d’équilibriste ?
N.S. : Je vais probablement osciller entre livres anthropologiques et récits littéraires. Je sais qu’après Croire aux fauves, je ne pourrai plus écrire de monographies érudites de la même manière ; le recours à l’écriture littéraire est d’une efficacité assez redoutable, surtout pour la description. Dans des ouvrages plus anthropologiques, comme la suite des Âmes sauvages que je suis en train de rédiger actuellement, le rapport à la littérature et à la subjectivité ne sera jamais mis au ban, bien sûr. Et notre mission, en tant que chercheur.se.s, est bien de restituer à la société civile les petits fragments de choses que l’on a compris du monde ; mais plutôt que de recourir à des procédés de vulgarisation, je trouve cela plus productif de chercher des formes accessibles par d’autres biais moins intellectualisants. Les mots peuvent avoir une résonance incroyable pour faire passer des idées, si ce n’est des mondes. Et je trouve cela tellement important que mon voisin en montagne, qui garde des vaches, ait pu lire mon livre et se laisser émouvoir par des idées qui, si elles avaient été écrites exclusivement à l’attention de mes pair.e.s universitaires, n’auraient pas pu le toucher.
K.K. : Le titre de votre récit, Croire aux fauves, dit toute la complexité de ce qui serait aujourd’hui votre engagement dans le chantier épistémologique qu’impose le changement climatique. Mais ce choix de titre n’est certainement pas anodin au vu d’une discipline comme l’anthropologie qui s’institue justement par opposition à la croyance…
N.S. : Le titre s’adresse précisément aux anthropologues comme une invitation à réfléchir à ces notions. Un tel choix aurait pu être effectivement assez risqué pour moi, en tant que spécialiste de la discipline ; mais je suis sauvée par le mot « fauve », qui dans l’étymologie française a complètement échoué à définir un objet stable à travers le temps. « Fauves » étaient les animaux recensés par les anciens traités de chasse, puis c’étaient les bêtes de « sang noir », ensuite les grands prédateurs, enfin tout qui était sauvage, à la lisière de l’humain, jusqu’à ce que cela subvertisse toute l’Histoire de l’art avec une mauvaise interprétation du terme par le fauvisme. « Fauve » est une catégorie qui englobe tout ce que l’on n’arrive pas à contenir. Et c’est cela qui m’intéresse : la puissance métamorphique de ce concept et sa capacité à déborder la brèche au moment même où l’on essaie de l’arrêter. Ce qui rend alors légitime l’idée du « croire », de croire en cette zone qui nous oblige à être plus exigeant.e.s à la fois sur le plan existentiel et intellectuel, car c’est là que les choses se brouillent, se rénovent et se réengendrent.
K.K. : Votre travail d’anthropologue semble s’établir dans une forme de résonance avec l’Autre. C’est d’abord avec les Gwich’in que vous avez expérimenté votre premier choc en voyant que cette population d’Alaska était aux prises avec une apocalypse que vous avez très rapidement vue comme annonciatrice de celle des modernes — ce que vous expliquez dans votre ouvrage Les âmes sauvages. Face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska (La Découverte, 2016). Se peut-il que l’avenir de l’anthropologie réside justement dans la subjectivité assumée du/de la chercheur.se ?
N.S. : Absolument. L’objectivité, a fortiori en sciences humaines, est un mythe si l’on pense qu’elle existe en tant que telle. Ce qui fait que l’on peut comprendre un autre monde, c’est qu’il y a quelque chose de ce monde en soi-même, quelque chose qui rende le dialogue possible, sinon nous ne pourrions rien dire des autres. Pour changer le monde, il faudrait d’abord changer la manière dont on raconte des histoires sur ce monde — c’est une exigence politique. D’où la nécessité d’assumer sa subjectivité ; ce qui ne signifie pas de ne plus pouvoir créer d’outils heuristiques, mais simplement de se redonner le droit de retranscrire ces histoires au plus près de ce qu’elles ont été dans le réel de l’expérience. C’est effectivement ce dont je me suis rendu compte au contact des Gwich’in en Alaska : pensant écrire une monographie sur leur manière animique de se relier au monde, je me suis rendu compte que le véritable objet d’étude, c’était ce qui arrivait dans cette rencontre entre eux et moi — moi et mes préjugés, ma pensée, mes affects. Et c’est cela, le processus créatif ; renoncer à une forme d’en-soi du monde pour s’intéresser à ce qui se crée dans la zone liminaire.
K.K. : En tant que critique du naturalisme, dans la lignée de Descola, vous avez à cœur d’interroger l’ontologie moderne. Il s’agit entre autres de remettre en question le binarisme des catégories duelles ; vous dites alors que votre rencontre avec l’ours est celle du « mythe » avec la « réalité », du « jadis » avec l’« actuel », et enfin du « rêve » avec l’« incarné »…
N.S. : On est tenté de penser que le rêve est une nuisance nocturne qu’il faut couvrir, alors que chez les animistes, il informe le quotidien et permet de s’y positionner. La question de l’incarnation au réveil ouvre au dialogue entre le diurne et le nocturne. La nuit, l’âme part à la rencontre d’autres corps pour, au matin, revenir avec d’autres dispositions et les intégrer en soi-même, puis s’orienter dans la journée à venir… Le rêve est très lié au Temps du mythe, de la spéciation, ce temps où l’on se donne le moyen, par le dialogue, de redéfinir les limites interspécifiques. Le rêve est un retour à cet état-là où les dispositions physiques et corporelles comptent beaucoup moins que dans la veille. Cela nous est totalement incompréhensible, pour nous modernes, si ce n’est inutile, car nous vivons dans un monde stabilisé. Il est beaucoup plus facile par exemple de rêver lorsque l’on est loin de ce monde-là, de soi, de sa zone de confort. Pour bien rêver, il faut se décaler, accepter de perdre tout ce qui nous rassure pour arriver à se mettre dans une ouverture relative à ce qui se passe au-dehors, à ouvrir une faille en nous. Une approche animiste du rêve reviendrait à rompre avec l’idée sociologique du rêve, qui ne ferait que rejouer certaines scènes, et au sein duquel de véritables rencontres d’âmes ne peuvent advenir : le rêve chez nous n’est qu’un huis-clos entre nos projections et nous-mêmes.
K.K. : Qu’est-ce que cela implique au niveau de la recherche scientifique ?
N.S. : En tant que modernes, nous avons délaissé l’imagination comme voie de compréhension du monde ; cela pose la question de la responsabilité des sciences à l’origine impérialistes, telles que l’anthropologie qui, étudiant les autres populations comme représentatives de ce qu’aurait été l’enfance de la modernité, aura tôt fait de leur ordonner de dépasser leurs techniques d’appréhension du monde jugées arriérées. Et voici que nous cherchons dans le lointain des fragments de nous-mêmes, ce qui d’ailleurs est un non-dit de l’anthropologie. Sans retomber dans le darwinisme appliqué au social, il faudrait à mon sens tenir ensemble les ontologies et les rapports historiques ; s’il y a une telle résonance entre les populations dites « non-modernes » et nous-mêmes, c’est parce qu’il y a quelque chose de commun qui s’éveille en nous à leur contact. Car il ne faudrait pas se leurrer : si nous étudions d’autres manières de voir le monde, c’est pour repositionner la nôtre aussi. En tant qu’anthropologues, nous portons, certes, le stigmate de la colonisation, mais nous devrions l’accepter ; et au lieu de jeter l’éponge, il faudrait plutôt essayer de faire mieux en mettant sur le devant de la scène des sociétés qui sont confrontées aux effets délétères du changement climatique sans avoir participé aux conditions de production de la modernité. Science et projet politique n’ont en fait jamais été désolidarisés, mais il faudrait aujourd’hui pouvoir l’assumer et en faire une éthique.
K.K. : Lors de votre séjour chez les Gwich’in, vous vous êtes rendu compte que le changement climatique avait rendu leur savoir obsolète, mais nature et animisme s’adaptent de toute façon en s’hybridant mutuellement. Serait-ce la réponse qu’en tant que modernes nous devrions apporter au devenir du monde ? Je reconnais la complexité de cette question…
N.S. : (Rires) Effectivement, ce n’est pas du tout évident… Mais la modernité a fait beaucoup trop de dégâts, notre rapport aux non-humains est dégradé depuis trop longtemps. Par opposition, les populations animistes entretiennent des relations quotidiennes avec les animaux qui les entourent, elles peuvent donc aller s’abreuver à des puits ontologiques invisibilisés, certes, mais qui sont présents. Peut-être devrions-nous plutôt créer autre chose, en bricolant par exemple les ontologies les unes avec les autres, comme ce que font les animaux : raccorder ce segment de relation-ci avec ce segment de relation-là. Il faudrait peut-être commencer par se rendre compte et prendre acte du fait que notre émancipation, notre démocratie passe par l’exploitation de territoires, de populations et de ressources, tant humaines que non-humaines et matérielles, qui sont en périphérie de la modernité. Je ne pense pas qu’il faille procéder à une dé-mondialisation tous azimuts — nous connaissons les dérives notamment populistes que cela pourrait engendrer —, mais plutôt trouver une façon de re-situer notre dépendance matérielle sans pour autant en perdre les mises en relation possibles. Faire en sorte que les échanges et les hybridations des ontologies continuent de se faire pour créer du « plus de monde », la garantie d’un monde commun habitable.