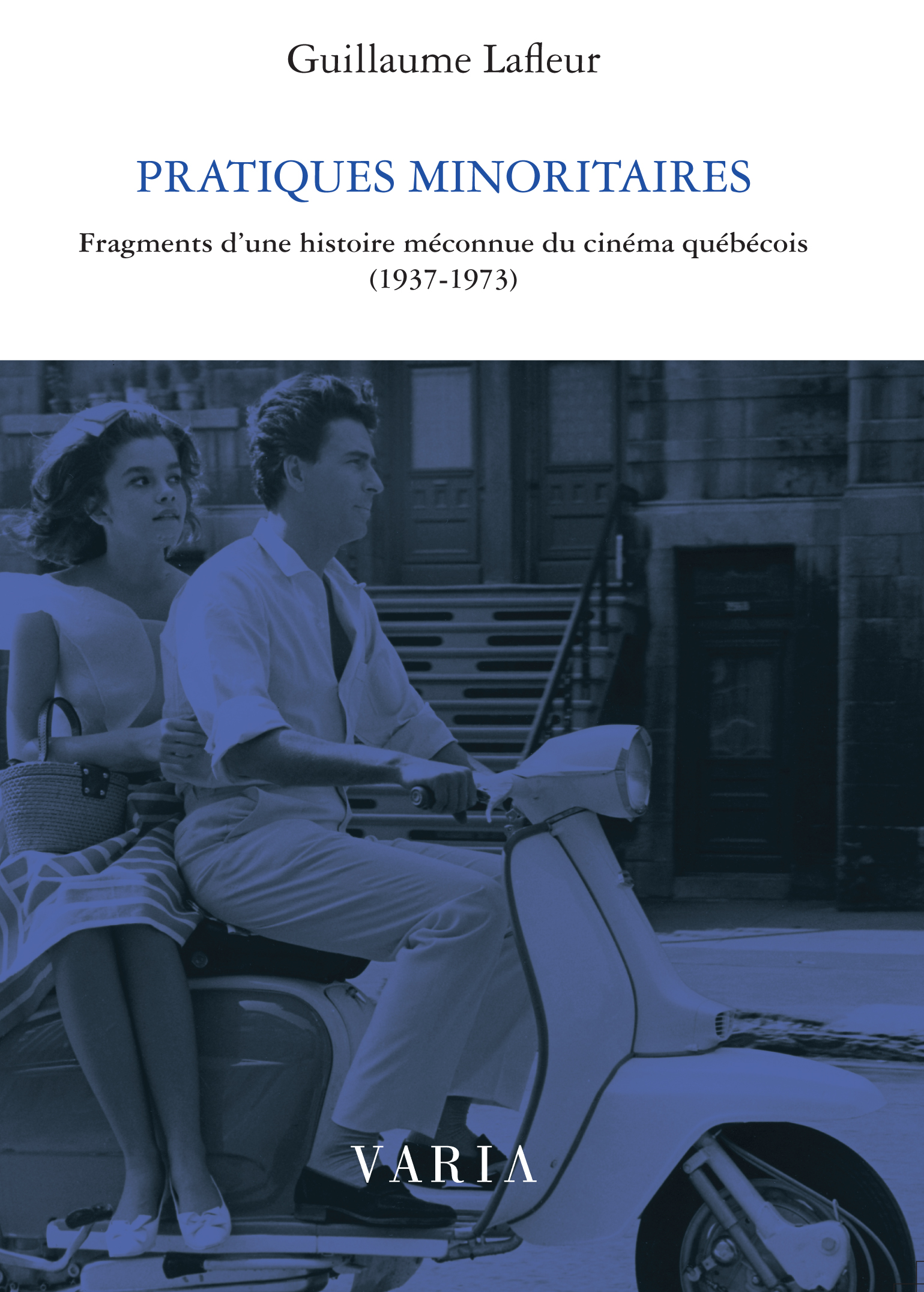Passim
Mise en scène et chorégraphie de François Tanguy, son d’Eric Goudard et François Tanguy, lumière de François Fauvel, Marek Havlicek et François Tanguy.
Avec Laurence Chable, Patrick Condé, Fosco Corliano, Muriel Hélary, Vincent Joly, Carole Paimpol, Karine Pierre et Jean Rochereau.
Un spectacle du Théâtre du Radeau présenté du 27 au 31 mai 2015 à Espace GO dans le cadre du Festival TransAmériques.
///
Passim serait une «étonnante archéologie de l’instant». Étonnante, certes, pour quiconque découvre, tel a été mon cas, le travail de François Tanguy. C’est une scène abandonnée, voire endormie, sombre et surchargée qui accueillait le public du FTA en première nord-américaine, et qui semblait s’étendre jusqu’à l’infini. Les (vieilles) planches étaient remplies de quelques dizaines de tableaux de toutes formes qui, dès le premier mot du spectacle – «Regardez !» –, se sont animés pour ne plus retourner à l’état d’inertie.
Et c’est là que réside la virtuosité de l’œuvre : dans le brouhaha des tableaux, dans ce tourbillon constant des choses qui entrainent dans leur mouvement les comédiens qu’on voit probablement plus juchés sur le mobilier que posés sur le sol. Leur jeu, souvent burlesque, rime en ce sens avec un état d’équilibre précaire, contraste intéressant avec l’ambiance lente et solennelle qui est créée dès le départ ; tantôt soldats (nombreux), tantôt travestis, ils s’agitent beaucoup, parfois au risque de se casser la gueule, ce qui n’est pas sans s’accompagner d’un certain humour. Pour ma part, je n’ai pu m’empêcher de voir, dans toute cette agitation, dans toute cette absurdité aussi, quelque chose qui ressemblait au film Le roi et l’oiseau de Paul Grimault et Jacques Prévert.

Photos : Brigitte Enguerand
Rappelons que passim signifie ça et là, en de multiples endroits, bref partout. Les presque innombrables tableaux, tels des pans de l’histoire européenne – et donc de la culture occidentale –, composent une sempiternelle suite désordonnée d’événements au centre desquels se retrouvent les classiques de la littérature (Molière, Shakespeare, Kleist, Ovide, Flaubert, Euripide, Woolf, etc.) et de la musique (Beethoven, Schubert, Rachmaninov, Sibelius, Gluck, etc.). Une archéologie qui, entre les mains de Tanguy, prend la forme d’un bricolage, art postmoderne s’il en est qui déclare, faut-il l’évoquer une fois de plus, la fin des grands récits.
Il en est un, pourtant, que plusieurs semblent avoir décelé comme fil conducteur de Passim : l’Holocauste. Comme si l’artiste voulait ici dire que malgré tant de splendeur, les choses peuvent vite tourner au cauchemar. D’où d’ailleurs les tout derniers mots de la pièce, tirés de l’œuvre de Paul Celan : «nous creusons dans le ciel / Une tombe où l’on n’est pas serré», qui constituent le point d’orgue au spectacle pendant lequel les instants de grande beauté finissent tous par s’effondrer, ce qu’incarne, au risque de me répéter, le corps chambranlant des interprètes qui (se) bâtissent tant bien que mal des scènes bancales jamais dépourvues de poésie ou, pour reprendre l’inspirante formule de Didi-Huberman, «un corps toujours déplacé et décalé, à la façon d’un rébus ou d’un rêve».
«L’acteur doit tenir les seuils», croit le maître d’œuvre de ce projet ; tant de cadres, de portes, d’entrées et de sorties, ce qui le pousse à «passer à travers les formes qu’il visite». Cela se fait ici principalement en français, mais aussi en italien, en espagnol, en anglais, puis en allemand.
Les mots cassent la magie, se plaignaient certains au sortir du spectacle. Ils occupent effectivement une place incertaine dans ce gigantesque capharnaüm ; parfois étouffés par la musique au lyrisme exalté ou par un accessoire venant obstruer (probablement volontairement) la voix des comédiens, parfois d’une profondeur telle qu’on est tenté de se demander s’il n’y a au fond que ça qui compte, les mots se questionnent eux-mêmes, semble-t-il, sur leur propre valeur.
Mais le spectacle vient surtout dire l’invention, ou plutôt la possibilité de s’inventer un espace avec ces choses et ces mots qui traînent ça et là dans le fouillis du monde. En ce sens, Passim est un songe. Ou un mauvais rêve, c’est selon. Qui peut laisser perplexe. Or si «les cauchemars ne sont pas de mauvais rêves, mais les bonnes descriptions d’un état du monde qui nous hante tous et, malheureusement, finit presque toujours par nous rattraper» (Didi-Huberman), à nous de mieux disposer (de) nos matériaux pour s’assurer des réveils moins brutaux.