Langue rouge. Hommage à France Théoret
Un hommage placé sous le signe de l’amitié littéraire et organisé en l’honneur de la poète, romancière, nouvelliste et essayiste France Théoret aura lieu le 4 juin, à 19h, à la Maison des écrivains, dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal. L’événement se veut une traversée, large et ample, qui donnera voix aux moments essentiels d’une œuvre poétique des plus singulières.
Poètes et artistes de toutes générations viendront témoigner de ce travail et de cet imaginaire sans compromis, ayant marqué durablement la littérature et la poésie québécoises ainsi que le paysage culturel et intellectuel des trois dernières décennies, de Bloody Mary (1979), livre-phare, à L’été sans erreur (2014), puis au récent Va et nous venge (2015), et de la revue La barre du jour au journal Les Têtes de pioche et au Magazine Spirale. L’hommage aura lieu en présence de l’auteure. Durée : 1h15
Participant.e.s : Carole David, Martine Audet, José Acquelin, Annie Lafleur, Véronique Cyr, Kim Doré, Pol Pelletier, Rodney Saint-Éloi, Louise Marois, Louise Dupré, Nicole Brossard, Chloé Savoie-Bernard et Élise Turcotte liront sur scène des textes significatifs de l’auteure, tout en évoquant à l’occasion leur rencontre avec ses mots et son imaginaire.
Cette activité de la Maison de la poésie de Montréal est organisée en partenariat avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises, à l’Université de Montréal.
Nous publions pour l’occasion une entrevue avec l’auteure, qui retrace l’essentiel de son parcours littéraire, récompensé en 2012 par le prix Athanase-David du Gouvernement du Québec.
///
Vous écrivez dans Entre raison et déraison (1987) : «Il n’y a pas pire bruit que celui de la classe moyenne.» Venez-vous de la classe moyenne ? Comment avez-vous pu, à l’époque, entrer au collège classique ?
France Théoret : La classe moyenne m’obsède encore. Dans ma famille, on disait qu’on était de classe moyenne ; aujourd’hui, on dit que toute la population est de classe moyenne, exception faite des ultrapauvres. Après la onzième année, je n’ai pu choisir le cours classique, mes parents disant qu’ils n’avaient pas d’argent. J’ai donc fait l’École normale, puis j’ai enseigné une année au primaire à l’âge de 17 ans. J’ai ensuite décidé que c’en était fini : j’allais compléter les quatre dernières années de cours classique. Je vivais dans le plus parfait dénuement, dans une extrême précarité, lors des deux dernières années de cours classique et des deux premières années d’université. Je ne mangeais pas tous les jours ; je travaillais tout le temps. En Philosophie II, j’ai, par l’entremise d’une amie, rencontré Marcel Saint-Pierre et, plus tard, Nicole Brossard. À l’université, j’étais dans la même classe que Nicole et nous étions réunis autour de la naissance de La barre du jour, en 1965.
J’ai commencé à enseigner au cégep, en 1968. C’était urgent, monétairement. J’ai également suivi une scolarité de maîtrise. Je voulais m’inscrire au doctorat de troisième cycle à Paris. Aujourd’hui, la légende veut que des masses de Québécois allaient étudier à Paris, mais les gens qui s’y rendaient véritablement se comptaient en nombre restreint. J’avais été acceptée deux ans auparavant par Roland Barthes. Or, je ne lui avais pas écrit, et, lorsque je suis arrivée à Paris, le séminaire était fermé pour cause d’homophobie. C’était l’automne 1972 ; Barthes avait été attaqué en raison de son homosexualité. Je suis alors allée chez Greimas, dont le séminaire était ouvert.
Tant de gens fréquentaient ce séminaire : ils étaient assis partout, dans les fenêtres, ils se tenaient debout ; tous écoutaient le maître. En réalité, je me suis fourvoyée en choisissant Greimas, c’était à l’époque où il cherchait à vérifier sa méthode par la logique mathématique, alors que j’allais à Paris pour étudier la littérature. J’aurais été plus heureuse si j’étais allée chez Gérard Genette, mais je ne le connaissais pas à ce moment-là. Je suis demeurée en France deux ans et j’ai bien vu, lors de la deuxième année, que je n’aboutirais à rien chez Greimas. Au cours de cette année-là, je me suis mise à écrire «pour vrai» et à envoyer continuellement des textes au Québec. La scolarité m’a servi à quelque chose. Plus tard, je me suis inscrite au doctorat à Sherbrooke avec Joseph Bonenfant.
La question de l’apprentissage est-elle le fil conducteur de vos études ? Quelle impulsion vous a poussée à insister pour vous inscrire au collège classique ?
FT : Déjà, vers l’âge de 11 ou 12 ans, je voulais écrire. Il fallait que je passe par des études de lettres.
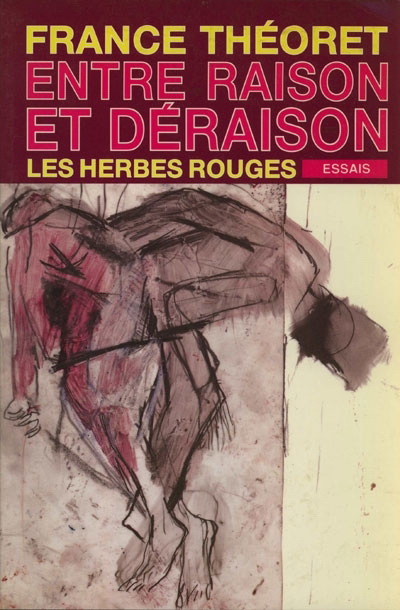
Vous écrivez dans Entre raison et déraison : «Qu’est-ce à dire d’un projet d’écriture qui s’obstine à dire comment se fait l’apprentissage ?» Qu’est-ce qui ouvre pour vous la question du désir d’apprendre par l’écriture, à la sortie de l’enfance ?
FT : Ça a pris beaucoup de temps. J’ai beaucoup écrit pour ensuite jeter les choses au panier. J’avais une extrême difficulté à prendre au sérieux ce que j’écrivais. Je voulais apprendre, je voulais écrire, mais je n’établissais peut-être pas le lien entre les deux. Longtemps, j’ai pensé qu’à un certain moment on avait appris. L’image qui m’était projetée de l’adulte était celle de quelqu’un en maîtrise de son propre savoir, en maîtrise de ce qu’il fait. Je pensais naïvement que je serais éventuellement en maîtrise de l’écriture et que j’aurais ainsi quelque chose sur quoi tabler. Je ne connaissais alors pas beaucoup de poètes, ceux que l’on voyait de loin, à partir de mon milieu, étaient considérés comme des lunatiques.
On aura l’impression que j’invente des termes du XIXe siècle, mais, à l’époque, on disait vraiment que c’était des gens en contrôle de rien, hors de la réalité, qui vivaient dans la lune, dans la rêverie constante. J’ai cessé de penser cela lorsque j’ai commencé les réunions à La barre du jour vers l’âge de 23 ans ; ce fut une rupture avec le milieu où je suis née et la culture urbaine que j’ai connue dans les quartiers Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Henri.
Quelle était la source d’insatisfaction au départ qui vous a engagée vers l’écriture ?
FT : Je n’avais pas du tout conscience de ce genre de questions. L’écriture, pour moi, c’était d’abord raconter des choses qui n’étaient surtout pas de mon propre monde.
La fiction plus que la poésie, alors ?
FT : La fiction inventait des histoires. C’était ça, écrire, à l’époque.
Comment avez-vous fait le chemin de vos premiers essais d’écriture jusqu’à la poésie ?
FT : Avec La barre du jour, j’ai appris la préséance du signifiant sur le signifié, la forme et non le fond ou le contenu. Au départ, j’abordais toutes les choses par le fond. C’était ça, des histoires, finalement : raconter des contenus. A La barre du jour, il était question de la différence entre deux poésies, la traditionnelle et la formaliste : celle qui nous importait était la poésie formaliste. Celui qu’on préférait, c’était Mallarmé. J’étais passionnée par ce qu’on faisait parce que c’était, je le sentais, de la vraie littérature, mais je n’étais pas passionnée par mon propre travail d’écriture. J’ai écrit des poèmes, et de nombreuses ébauches de textes pour le panier. Je trouvais que je n’arrivais jamais suffisamment au blanc, mais arriver au blanc, finalement, c’est arriver à la page blanche. C’était pour moi complètement noir ou blanc – c’est le cas de le dire ! –, c’est-à-dire une lutte pour effacer le texte au profit de la forme, ce qui ne m’allait pas. Cependant, j’ai appris la chose la plus importante comme écrivaine, à savoir ce qu’est un signifiant. Au collège classique et à l’université, on ne nous parlait jamais de ces termes ou de littérature contemporaine. Ça a été très important de comprendre ce que c’est qu’un travail formel, et de ne pas revenir en deçà, par la tentation des histoires.
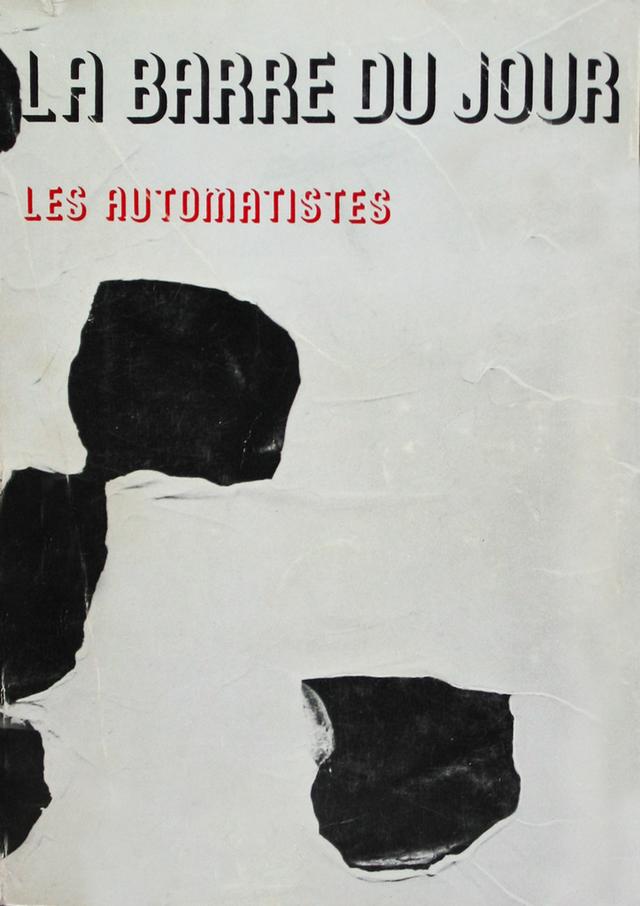
Nicole Brossard dit que l’une de ses découvertes à l’intérieur du groupe qui était le vôtre à l’époque c’est, par l’intermédiaire de Marcel Saint-Pierre, le surréalisme dissident, c’est-à-dire les surréalistes moins connus en dehors de Breton et d’Éluard. Est-ce, pour vous aussi, le moment où vous découvrez une écriture plus marginale ?
FT : J’ai découvert Antonin Artaud et Claude Gauvreau. J’ai rencontré Gauvreau au moment d’un numéro spécial de La barre du jour sur les Automatistes. J’étais chargée de monter le dossier et d’aller le rencontrer. Il était vraiment très impressionnant. Je l’écoutais, et cela me satisfaisait beaucoup. J’ai été passablement muette. Je lisais énormément Artaud ; c’est lui qui, avec Gauvreau, a tout déclenché de mon travail littéraire. J’étais à l’université à ce moment ; c’était autour de 1965 et 1966.
Vous êtes toujours demeurée fidèle à Artaud et à Gauvreau, même si, comme vous l’écrivez dans Va et nous venge (2015), votre grande amie Louky Bersianik les jugeait misogynes. L’opposition à Louky Bersianik était-elle un ferment pour tenir encore davantage à ces œuvres ?
FT : Peut-être pas tenir davantage, mais lorsque l’écriture ne va pas bien, que la pensée n’arrive pas à s’orienter, je prends des livres d’Artaud ou des livres de Gauvreau, je lis pendant une heure ou deux, et je continue. Ce sont des écrivains majeurs dans ma façon d’aborder la littérature. Cela dit, c’est en lisant Virginia Woolf, en 1970, que je me suis mise à la table d’écriture. Elle m’a fait passer à l’acte d’écrire et à l’idée de tenir à ce que j’écrivais. Au sujet des femmes qui écrivent pour leurs tiroirs, c’est-à-dire qui ne montrent pas leurs textes, Woolf affirme trouver cela malsain. Ou est-ce moi qui ai interprété cela ? Aller sur la place publique, c’est s’exposer, et ce geste seul est très dur. En tout cas, cela l’a été pour moi.
Est-ce que la critique a parfois cristallisé quelque chose au sujet de vos textes, comme par exemple à propos de vos premiers recueils ?
FT : Je pense qu’à l’époque, il y avait un climat particulier d’ouverture, même chez des hommes comme Joseph Bonenfant, Philippe Haeck et Michel Beaulieu, qui avaient le goût d’entendre des textes semblables. Il y avait certainement une écoute.
Y a-t-il d’autres figures aussi importantes que Gauvreau et Artaud pour vous lorsque vous écrivez ? Elfriede Jelinek, peut-être ?
FT : C’est venu plus tard. Les débuts sont tellement importants. Et ce n’est pas pour rien que je n’ai jamais quitté ces auteurs. Ensuite, il y a eu Jelinek, oui : un réel plaisir dans la forme, dans sa façon d’être en colère, de nous faire rire, de faire jaillir la pensée à partir du langage.
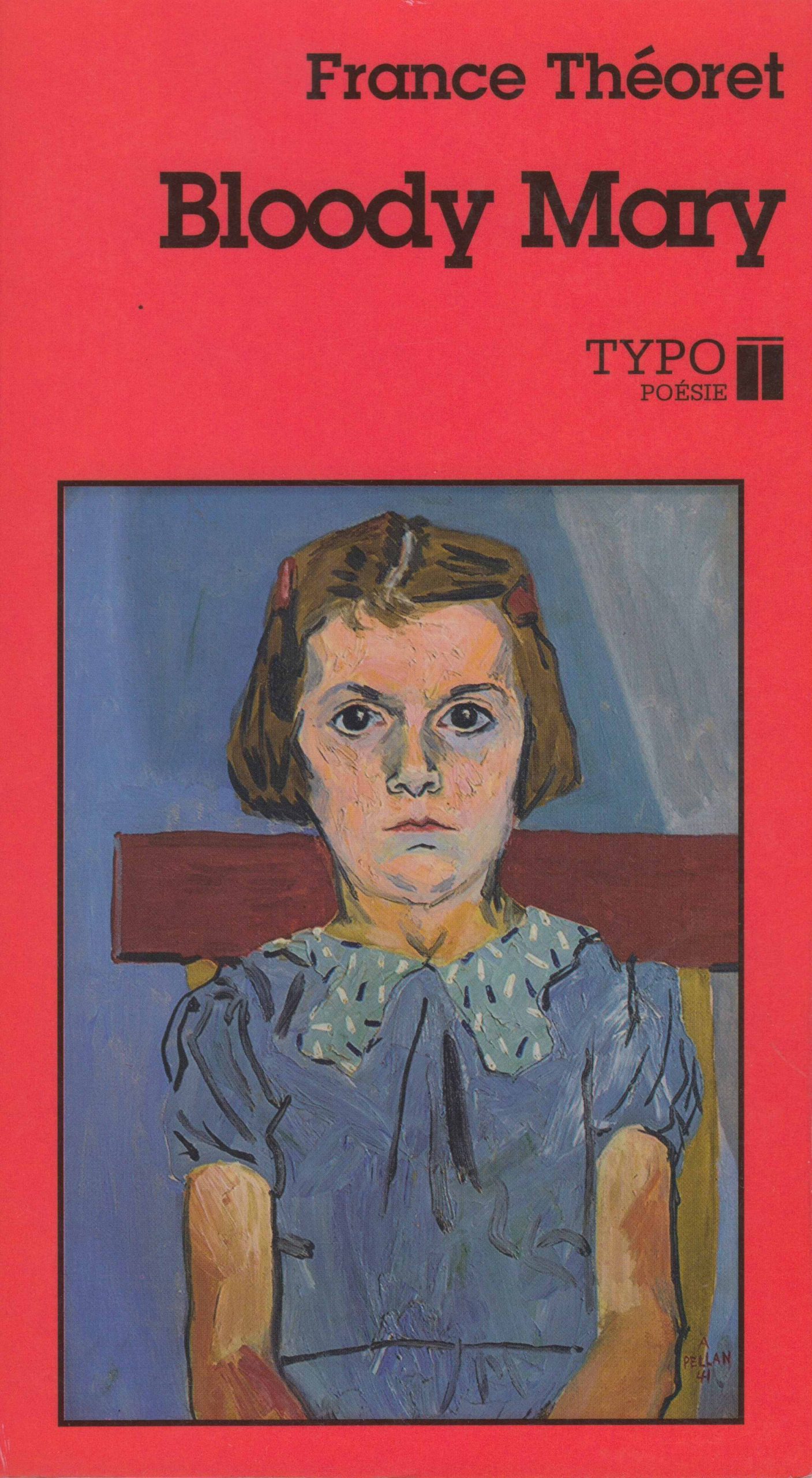
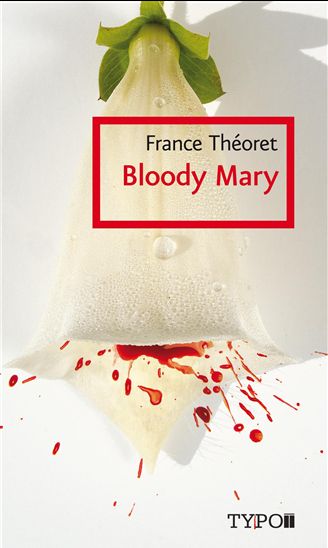
Dès Bloody Mary (1979), on perçoit dans votre écriture une colère, voire une certaine violence, aussi bien sur le plan thématique que au niveau du traitement de la langue. Faites-vous «violence» au langage ?
FT : Je n’aime pas lorsqu’on dit que mes livres sont des «cris». Je pense que je n’utilise pas le verbe «crier» et je ne parle pas de «cri». Il s’agit d’un effet que le texte peut produire, pas ce que le texte dit. Je parle de la violence, surtout de la violence psychique.
Dans Entre raison et déraison, vous évoquez, avec Julia Kristeva, le fait qu’on écrit «pour ne pas mourir de peur». Cela nous greffe à quelque chose qui est véritablement une sorte de moteur, quelque chose de presque impudique aussi.
FT : Dans Une voix pour Odile (1978), il y a un court récit qui s’intitule «Le livre de la peur». La peur a été la passion la plus puissante de ma vie. La passion veut dire se mouvoir ; la peur est ce qui me meut en premier. Il y a ce sentiment de ne pas habiter le monde. La peur est là, elle me bouge. Où que je sois et quoi que je fasse, le monde ne m’appartient pas, ne m’a jamais appartenu.
Dans Bloody Mary, vous écrivez : «Avant toujours j’écris le couteau». C’est une image forte.
FT : Pendant les dix premières années d’écriture, j’ai lu mes textes à haute voix en les écrivant. Il fallait que je les entende, que ça claque, que ce soit brutal. Il fallait que je dise cette brutalité que je vivais et que j’avais longtemps vécue, mais formellement, transformée par le signifiant. J’étais à l’école de l’avant-garde : on appelait ainsi le groupe autour de La barre du jour avant qu’on ne passe à la «nouvelle écriture». Toutefois, j’ai vraiment commencé à écrire à l’époque où je suis devenue féministe. Le féminisme en soi est un contenu, une idée, une pensée ; de plus, c’est une forme. Ça a été ma deuxième avant-garde. J’aimerais, et c’est ce que dit Zoé dans Va et nous venge, qu’il y ait maintenant une troisième avant-garde, un mouvement de rupture, que je ne vois malheureusement pas venir. Nous sommes mûrs pour quelque chose d’aussi important que Refus global, dans la littérature, voire dans toutes les zones culturelles.
Le féminisme a été une façon de me penser comme femme. J’ai tout de suite eu l’intuition que ce mouvement serait différent de celui des suffragettes, notamment parce que nous abordions la question du corps, question importante pour les formalistes également. Les suffragettes, de même que les féministes qui les ont précédées, n’ont jamais produit ou été accompagnées par un mouvement d’écriture. Dans les années soixante-dix, il y a eu divers mouvements idéologiques, dont les mouvements stalinien et maoïste ; ceux-là avaient déjà une idée de ce qu’était leur littérature : le réalisme socialiste. Or, j’avais l’intuition qu’avec cette deuxième avant-garde qu’était le féminisme s’ouvrait un domaine d’exploration de la pensée.
J’ai, à un certain moment, essayé de définir l’«écriture au féminin» ; j’employais le terme «écriture» dans le sens de Barthes, mais cette formule n’a jamais été adoptée largement. Je pressentais qu’il y aurait un mouvement d’écriture qui serait concomitant au féminisme. Il y avait là un espace de recherche qui demandait à travailler le signifiant, le texte, le langage, l’écriture, et qui s’élaborait sous la forme de fragments. Tout mouvement d’écriture rassemble ce qui appartient d’abord à la périphérie. Je crois que le travail central visait à créer une écriture, un art poétique, qui fraierait un chemin autre, différent, à partir d’éléments contradictoires. Je voyais bien que tout ce qui pouvait venir du marxisme à cette époque ne serait que du réalisme socialisme et qu’il n’y aurait pas d’innovation. Je pensais qu’il y avait de l’inédit du côté des femmes.

Par rapport à l’autobiographie ou encore à l’écriture formaliste, la fiction, comme dans Va et nous venge, permet-elle de dire autre chose ?
FT : Ça a été très difficile d’aborder la narration, d’aller plus loin que le fragment, parce que j’avais le sentiment de renier la littérature. Le formalisme m’a appris que la littérature est de l’ordre du signifiant et qu’il faut y venir d’une manière ou d’une autre. En travaillant le formalisme, j’ai bien vu qu’il y avait toute une mise à plat du langage, et un travail vers la reconstitution matérielle de chaque mot.
J’ai critiqué le formalisme qui redisait parfois la même chose, qui piétinait. À certains moments, c’était vraiment la catastrophe, parce que nous étions très sévères les uns avec les autres, nous étions extrêmement surmoïques. Il y avait un absolu ! J’arrivais mal à dégager ce que j’avais appris, soit cette préséance du signifiant, de tout le reste ; je cherchais un cheminement que je ne trouvais pas. Il a fallu des lectures, d’autres essais d’écriture. La grande rupture s’est produite lorsque je suis passée du fragment à la narration. Avec le formalisme tel que nous le pratiquions, la narration, c’était antinomique.
Est-ce que c’était autour d’un projet d’écriture en particulier ?
FT : Mon premier texte continu a été L’homme qui peignait Staline (1989) et, encore, il n’est pas très long. J’ai abordé la narration à ce moment-là.
Il est paradoxal que tout votre travail en soit un d’appropriation, y compris de la langue, mais que, en même temps, vous demeuriez toujours à l’extérieur, comme s’il y avait une sorte d’obstination du corps à demeurer au-dehors de l’apprentissage, de l’appropriation.
FT : Cette obstination, c’est mon état de corps. J’ai toujours voulu accompagner ce que j’écrivais, depuis Bloody Mary, de la connaissance, ou, de façon plus modeste, d’une connaissance partielle. J’ai souvent essayé de me lancer dans l’écriture sans savoir ce que j’écrivais ; certains textes ont précisément l’air de premiers jets, de textes qui appartiennent à la pulsion, comme on disait à l’époque. J’ai accompagné ces textes d’une réflexion – appelons cela philosophie ou théorie.
Cela rejoint-il la question de la rationalité dont vous parlez souvent dans vos essais ?
FT : Oui, je ne suis pas capable d’aller très loin dans des textes où je me laisse aller complètement. Quand ça ne va pas, il faut, à un certain moment, que je comprenne, que je sache où je m’en vais. Mais, lorsque j’écris, ça se déplace, et j’ai le sentiment qu’avec Va et nous venge, mon dernier roman, j’ai apporté quelque chose de neuf dans ce que j’écris, quelque chose de différent, parce que, mis à part le récit au sujet de Louky Bersianik, ce sont des histoires complètement inventées. Je suis dans le même sillon qu’auparavant, mais il y a maintenant des déplacements. La narration appelle à me resituer devant une histoire. Je n’écris pas tantôt féministe et tantôt femme. Je ne pense pas à des identités collectives quand j’écris, et surtout pas à des identités partitives ou partielles.
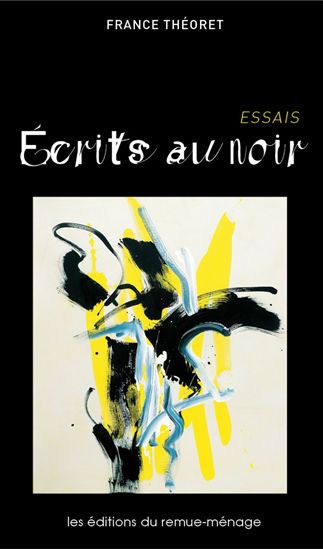
Dans Écrits au noir (2009), vous dites : «J’ai toujours aimé l’histoire littéraire.» Vous avez fait paraître en collaboration une anthologie marquante, Les grands poèmes de la poésie québécoise, et vous avez également enseigné au collège pendant un certain temps. À cet égard, vous avez déjà écrit que, il n’y a pas si longtemps, il fallait insister pour enseigner un corpus québécois au niveau collégial.
FT : Ce n’était certainement pas une priorité. Il y a eu une époque heureuse, dans l’enseignement au collégial, où on était vraiment libres de nos choix, et donc d’enseigner aussi la littérature québécoise.
Qu’avez-vous enseigné ?
FT : De la littérature québécoise, j’en ai enseigné beaucoup. À l’automne 1970, il ne fallait pas parler d’œuvres révolutionnaires. Prochain épisode était déjà au programme ; j’ai dit aux étudiants que je n’étais pas supposée enseigner cette œuvre, en raison des événements d’Octobre. Je leur ai demandé s’ils voulaient que je leur enseigne tout de même. Que pensez-vous qu’ils ont répondu ? C’était un «oui» ! J’ai aussi enseigné Jacques Renaud, et Le cassé n’a pas passé facilement…
Chez Jacques Renaud et Gérald Godin, par exemple, se joue un rapport singulier entre langue et littérature. Ce type d’écriture apparaît au début des années soixante, et La barre du jour, à laquelle vous participez activement, est fondée en 1965. Quel était alors votre sentiment sur ces écrivains ?
FT : J’étais déjà indépendantiste à ce moment, et, bien sûr, je les lisais. C’était très bien ; je trouvais osé d’écrire des textes semblables. Je ne l’ai jamais écrit nulle part, le personnage principal du Cassé de Renaud est un bum qui bat sa blonde. Celle-ci s’en va, revient ; elle demeure toujours soumise à lui. À l’époque, si je trouvais le personnage masculin violent, j’étais plus critique envers la société que je pouvais l’être envers lui.
En même temps, c’était aussi un personnage aliéné…
FT : Oui, un personnage aliéné, très aliéné. Son aliénation à lui, je la voyais, et j’occultais sa violence. Le joual ne me gênait pas du tout. C’était une exploration du langage, et dans la mesure où c’en était une, je pouvais aimer des textes de Godin, et en même temps adorer La charge de l’orignal épormyable de Gauvreau. Il ne s’agissait pas du ressassement de la représentation. Je critiquais plutôt ceux qui ne cessaient, et qui, il faut bien le dire, ne cessent de répéter une idée ancienne de la représentation.
Avec le joual, on retrouve, au début des années soixante, une certaine curiosité par rapport au travail d’écriture. Vous n’avez jamais eu vous-même d’inclination par rapport au joual ?
FT : Non, mais j’utilisais des mots en joual au début. Les religieuses parlaient bien ; or, dans ma famille, une bouilloire, on appelait ça un canard. Beaucoup de mots provenaient du langage paysan ou du joual. J’ai eu l’idée à un certain moment d’une traversée du langage, de mêler ce langage paysan et joual à un langage autre. J’aurais écrit quelque chose ressemblant à un roman d’apprentissage. Heureusement que je ne l’ai pas fait, car je pense qu’il aurait fallu les vieilles outres traditionnelles. Et qu’aurait montré ce roman ? Qu’en fait je ne voudrais plus jamais utiliser le joual ? Renier le langage de mes origines ? Non, je crois que la langue crée des ouvertures, des chemins.
Dans vos romans et vos récits, il n’y a pour ainsi dire pas de dialogue.
FT : Jamais ! Pour moi, c’est le roman traditionnel, le dialogue. Je pense que je n’en ferai jamais. Je sais qu’il y a des romans contemporains qui ne sont que dialogues. C’est fascinant, et ça l’est d’autant plus que je n’y ai pas beaucoup touché. Si je pouvais me mesurer mieux à cela, peut-être que j’écrirais pour le théâtre.
La question de la langue parlée n’est donc pas un enjeu dans votre œuvre ?
FT : La façon dont on se parle, c’est un enjeu, mais pas sous la forme de dialogue. Je préfère entremêler des paroles indirectes et des fragments de réflexion.
Dans Entre raison et déraison, vous dites : «Je n’ai pas de langue pour écrire l’amour. Je n’ai pas reçu cette langue de l’amour, mais celle du devoir et de la reconnaissance envers qui m’a donné la vie, toutes les vies, sous toutes leurs formes.» Cela rejoint l’absence de dialogue : comme la langue parlée, l’amour n’est pas beaucoup représenté, et ce, même dans votre poésie. C’est un parti pris que de ne pas construire l’œuvre, dans une certaine mesure du moins, autour de cette question, alors que pour Gaston Miron, par exemple, et chez bien d’autres écrivains encore, il s’agit d’une question absolument centrale, une question qui obsède littéralement le texte. On a l’impression que dans votre œuvre la question s’est déplacée.
FT : C’est une question grave que je me suis posée. La sexualité n’est pas toujours heureuse dans mes livres non plus. Vous me prenez au dépourvu avec cette question… Je suis de la période où il n’y avait que ça, des chansons d’amour ! Il n’y avait que ça d’intéressant dans la vie des adolescentes de mon époque. L’amour, il n’y avait que ça ! J’étais du lot, moi aussi. Personne ne m’a mise à l’extérieur du cercle. À un moment donné, j’ai seulement été saturée d’entendre les chansons d’amour. Quand on a 15 ans, on entend aussi les chansons d’amour écrites 20 ans auparavant. C’était toujours des chansons terribles. L’amour, d’abord, ça exige quelqu’un d’autre.
Je pense que mes interrogations sont davantage d’ordre existentiel, de l’ordre de la conquête de la subjectivité, du sujet parlant, du sentiment de la perte toujours à surmonter. Qu’est-ce que les gens espèrent ? Une fin heureuse. Que ça finisse bien, qu’il y ait une rencontre, et que cela laisse une belle consolation par rapport à des pensées tristes. Disons que des écrivains comme Beckett m’ont aussi beaucoup influencée : chez lui, il n’est jamais vraiment question d’amour. Je crois que j’ai été saturée par les langages d’amour et que je n’en ai trouvé aucun. Le mot qui me vient, c’est qu’il y a eu des choses plus urgentes à traiter. L’urgence, c’était de traiter des questions de langage et de subjectivité, de questions existentielles, donc.
Sur la question du rapport à la langue, chez vous, cela ne va pas, semble-t-il, jusqu’à une sorte de souffrance de langage, une souffrance provoquée par le fait de ne pas maîtriser la langue, comme chez Miron, par exemple.
FT : S’il y a un déchirement, chez moi, vous y touchez. Je n’ai pas seulement une conception féministe de la pensée, je suis aussi une militante. La militante doit penser à espérer. Il y a un aspect du texte qui ne peut pas être complètement noir. Si je n’étais pas une militante, il est probable que la souffrance prendrait une dimension beaucoup plus grande. Je suis quelqu’un de profondément divisé. La négativité, c’est le coup de sonde. Je ne peux pas me livrer entièrement à ces abîmes-là ; je n’ai pas connu la folie comme Artaud et Gauvreau. J’ai donc aussi ce désir militant, qui passe par une forme de recherche, par différentes voix, par des savoirs. Je me suis par exemple réconciliée avec la représentation et j’ai ensuite vu que cela s’écrivait également dans des œuvres contemporaines, comme chez Annie Ernaux, Christine Angot et Herta Müller. Dans mes derniers livres, je mets en situation des personnages d’après ma connaissance des mœurs, de la politique, de la sociologie, de l’anthropologie. Je travaille à partir de ce que je connais dans les sciences humaines, et non à partir d’une idée toute faite. J’essaie de dire dans Va et nous venge des choses sur les mœurs québécoises, en espérant mettre l’accent sur des mythologies, des clichés, des stéréotypes oubliés, qu’on n’a pas l’habitude de voir et de lire.
Miron avait, par exemple, toujours cette arrière-pensée que le langage le trahissait au moment où il l’utilisait. Le langage a-t-il, chez vous, basculé du côté d’un savoir raisonnablement assumé, porté, défendu ? Dans la dernière section de La nuit de la muette (2010), vous traitez de la question du langage comme problème social, mais cette question ne semble pas toucher votre subjectivité : il ne s’agit pas d’un «vertige» de langue.
FT : Miron était admirable lorsqu’il parlait de son aliénation et de sa non-possession du langage, mais il en parlait d’une façon maîtrisée. De cette non-maîtrise, il faisait de la maîtrise. C’était un thème important au début des années 1980 : se diriger vers la non-maîtrise. Moi, je me trouvais d’emblée dans la non-maîtrise ; il fallait plutôt que je cherche la maîtrise ! J’étais un peu dans la position de Miron ; d’ailleurs, c’est ce que j’écris dans Écrits au noir : ce qu’il dit par rapport à l’écriture, je pourrais le dire par rapport aux femmes. Je peux concevoir qu’il dise qu’il n’aimait pas écrire, tout en disant qu’il aimait avoir écrit. Partir de cette non-maîtrise et aller vers la maîtrise exige une concentration extraordinaire. On ne sait pas au départ, mais en cours d’écriture il faut savoir sur tous les plans.
D’ailleurs, moi, je n’ai pas le sentiment de vivre en poésie. Je pense que Miron vivait en poésie. Il avait toujours un petit papier sur lui et il était toujours en train de réécrire. Ses fameux vers «en souffrance», il les reprenait constamment. Quand il réussissait à formuler quelque chose, c’était toujours pour le mieux. Il avait une bonne oreille, il savait s’écouter. Pour ma part, j’ai des phases de poésie, des moments où j’ai le désir et le commencement d’une écriture en poésie. Si je veux m’asseoir pour écrire un poème, cela n’ira pas.
Dans sa vie insupportable, un an avant sa mort, Marina Tsvetaeva a dit qu’elle n’écrivait plus de poésie, qu’elle ne pouvait plus le faire, elle qui n’a presque jamais été publiée de son vivant… Peut-on voir le côté insupportable de cela ? Pendant les vingt dernières années de sa vie, elle n’a jamais eu l’occasion de publier. Qu’en serait-il sans l’occasion de publier ? Elle a dit, un an avant sa mort — elle est une autre suicidée — qu’elle ne vivait plus en poésie. Parfois, je me questionne sur les états de poète. Il y a des gens qui ont vraiment vécu en poésie. Je crois que Gauvreau vivait en poésie. Miron aussi, d’une certaine manière, avec ses petits papiers… Les poèmes, je peux en écrire ; des mots me viennent à l’oreille, avec une certaine présence et insistance. Mais ça peut aussi ne pas être bon du tout. J’éprouve toujours le besoin de faire des mises au point sous la forme d’un art poétique. J’en ai publié dans La nuit de la muette et dans L’été sans erreur (2014). Je suis en train d’écrire ce que j’intitule carrément «Art poétique». Il faut toujours que je me demande où j’en suis en poésie, et comment je fuis l’intime.
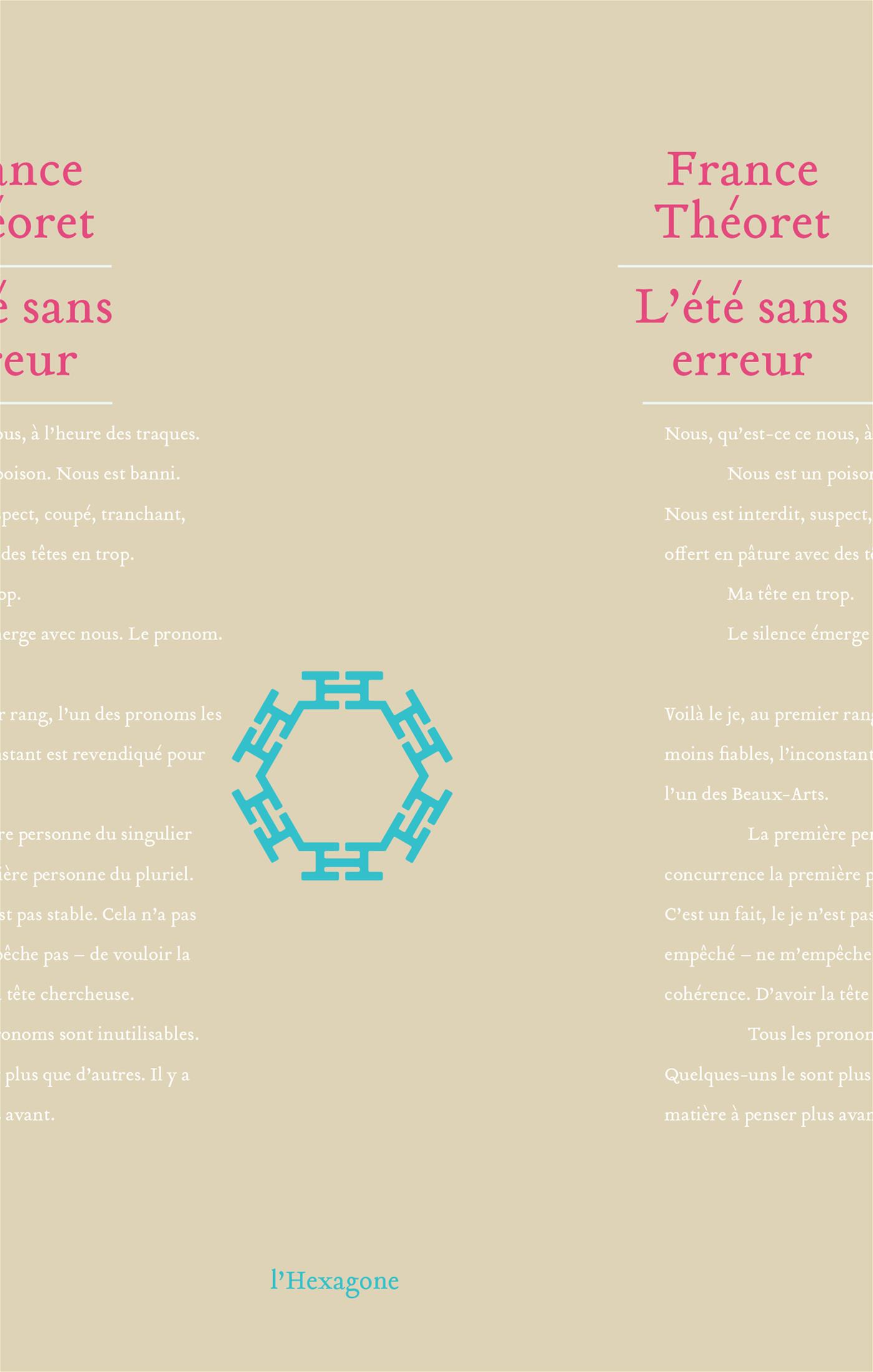
L’été sans erreur, c’est un titre très dense. Comment trouvez-vous vos titres, dont celui-ci en particulier ? On y sent un souci d’exactitude, mais on y trouve aussi une dimension un peu ironique. Dans certains recueils, vous parlez d’une fascination pour la scène «ratée». Y a-t-il un désir d’exposer la faille, d’aller là où le miroir est fêlé ?
FT : L’été sans erreur fait allusion au narratif, à ce qui est raconté, une saison remplie d’erreurs. J’aimerais passer un été sans faire d’erreur. Je vais répondre en parlant de l’idéologie dominante : je trouve qu’on cherche partout les winners, les gagnants, et, moi, c’est dans la faille que je cherche des choses. Nous habitons une drôle de société, de ce point de vue, et le monde littéraire y est inclus. J’essaie de connaître le monde dans lequel je vis, alors je n’y échappe pas.
Il y a chez vous un sujet fort, un «je» qui s’affirme, même s’il est marqué par le ratage. Ce sujet n’est cependant jamais fixé.
FT : Le sujet est toujours en mouvement : cela provient aussi de la modernité. Le sujet en mouvement n’est pas fixé à une époque, dans un caractère, dans des actions et des paramètres.
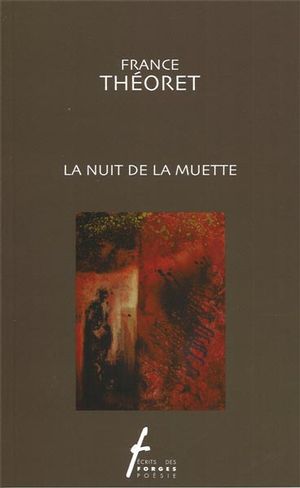
Est-ce que ce mouvement pourrait expliquer la récurrence du thème de la marche dans votre œuvre ? Ce motif est premier, particulièrement dans la poésie. Dans le même sens, votre œuvre travaille beaucoup la négativité, mais en même temps, dans La nuit de la muette, on trouve ces vers : «je vais marcher sur des trottoirs / où la promesse me tient».
FT : Quand j’ai écrit «La marche», je n’étais pas encore une lectrice de Nietzsche. Le philosophe pense en marchant : ça dit tout. J’avais eu la même expérience. Quand on se met à penser en marchant, des moments lumineux émergent.
Qu’est-ce qui se joue de particulier dans La nuit de la muette ? Vous y écrivez que «le poème découvre la marche». Il semble y avoir un investissement particulier de ce que signifie marcher, avancer.
FT : Il faudrait que je dise un mot sur le titre. Le sentiment d’être muette, je l’ai encore très souvent. Louky Bersianik me parlait elle aussi souvent du fait qu’elle était muette. Quand je participe à des rassemblements, comme en 2012 par exemple, lors du Printemps érable, je me suis jointe aux manifestants ; cet anonymat non seulement ne me pèse pas, mais a quelque chose de libérateur et de mémorable.
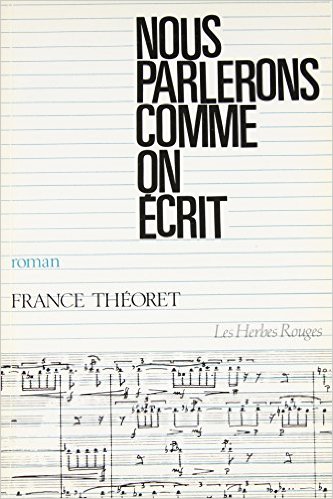
Il y a d’autres scènes significatives de marches, dans votre œuvre, comme dans Nous parlerons comme on écrit (1982) où vous décrivez le travail d’une serveuse dans un bar. Il y a aussi ces préposées aux bénéficiaires et ces infirmières qui se déplacent sans cesse dans le foyer pour personnes âgés de Va et nous venge. La marche est-elle également liée à une forme de travail ?
FT : Tout à fait : il y a la marche libre et la marche non libre. Mais oui, sans doute que chez moi le travail a remplacé l’amour [rires]. Gauvreau disait — et je l’ai toujours gardé en tête — qu’il y avait le travail-corvée et le travail-passion. Je me suis promise très jeune que je vivrais pour le travail-passion. Le travail-corvée, je l’ai connu dans les commerces où j’ai commencé à travailler à l’âge de huit ans. Je le connaissais encore à 20 ans, le travail-corvée. Je me disais qu’une émancipation venait par le travail. À l’époque où je voulais travailler, tout n’était pas ouvert aux femmes. C’est assez fascinant de lire l’histoire des femmes et du travail.
Le travail, pour moi, a toujours eu un aspect émancipateur très fort. Le travail devait amener à la passion, à me tenir dans la passion. Le travail aliénant, c’est le travail dont parle Marx. Encore là, ce n’est pas parce qu’on fait un travail manuel que ce n’est pas un travail émancipateur. Mon personnage d’Élisabeth, préposée aux bénéficiaires dans Va et nous venge, le prouve. J’essaie de toujours écrire de façon incarnée.
Vous écrivez dans Entre raison et déraison que vous privilégiez l’incarnation, mais par l’action : «Une amie aimait rappeler que les femmes fétichisent moins l’œuvre d’art. J’aimerais qu’il en soit longtemps ainsi. Écrire pour connaître. Le plaisir vient de la formule. Écrire est une modalité d’action. Je ne souhaite écrire que les textes auxquels j’aurai été contrainte». Écrire devient ainsi une action au sens fort. Cela rejoint aussi le rapport à l’action du sujet militant, c’est-à-dire le besoin profond d’inscrire l’activité militante dans une action, qui n’est pas du tout de la littérature engagée, ou de l’ordre d’une instrumentalisation de la littérature. Ce serait davantage la littérature comme action puissante, au sens large du terme. Votre œuvre échappe en ce sens au cynisme, ce qui rejoint la question de la promesse. D’où naît ce que vous appelez votre militantisme ?
FT : Cela ne vient pas du tout d’une tradition familiale. J’avais beaucoup aimé les idées de Simone de Beauvoir sur les femmes et la question économique, mais c’est plutôt le livre La politique du mâle de Kate Millett qui a été à l’origine de mon militantisme féministe : sans doute que j’étais alors mûre dans ma pensée. La politique du mâle est une déconstruction systématique du patriarcat, avec beaucoup de rigueur. Je n’ai pas pu faire abstraction de cela. Un changement est survenu. Virginia Woolf m’a ouvert les portes de l’écriture au cours des mêmes années.
Pour terminer cet entretien, une question au sujet de vos derniers recueils. Comment le passage de la prose au vers s’est-il fait dans votre œuvre poétique ? C’est tout de même assez récent.
FT : J’en suis étonnée moi-même. La prose, c’était le fragment, les poèmes en prose de Baudelaire, par exemple. À un moment donné, j’ai souhaité que la poésie se livre avec une nouvelle clarté, et le vers est venu. Les écueils sont les mêmes. Il faut travailler la langue, œuvrer frontalement, ouvrir le sujet. D’où l’importance de la forme et de l’usage des mots.


